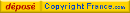Le dÃĐveloppement durable en Europe : reprÃĐsentations d’une idÃĐologie contradictoire
Michelle VAN WEEREN
Face à lâÃĐtat alarmant de la planÃĻte et aux inÃĐgalitÃĐs sociales toujours croissantes, les sociÃĐtÃĐs europÃĐennes semblent avoir trouvÃĐ la rÃĐponse adaptÃĐe.
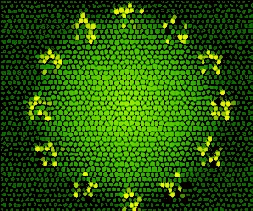 Concept trÃĻs en vogue sur le continent europÃĐen, le dÃĐveloppement durable sâimpose aujourdâhui aux pouvoirs publics et privÃĐs comme un outil opÃĐrationnel censÃĐ donner les lignes directrices qui permettraient de trouver un nouveau modÃĻle de gestion plus respectueux de lâenvironnement et de lâhumain. Lâapproche se veut complÃĻte et intÃĐgrÃĐe : il sâagit dâun dÃĐveloppement qui se ne soucierait plus uniquement de la gÃĐnÃĐration des richesses, mais ÃĐgalement de la prÃĐservation des ressources naturelles et de lâamÃĐlioration des rapports sociaux. Autre nouveautÃĐ : lâidÃĐe du long-terme et de la solidaritÃĐ intra-gÃĐnÃĐrationnelle doit dÃĐsormais ÃĐgalement Être prise en compte dans les dÃĐcisions sâinscrivant dans une dÃĐmarche de dÃĐveloppement durable. Il sâagit donc, pour reprendre la dÃĐfinition officielle, dâun ÂŦ dÃĐveloppement qui rÃĐpond aux besoins du prÃĐsent sans compromettre la capacitÃĐ des gÃĐnÃĐrations futures de rÃĐpondre aux leurs[1] Âŧ.
Concept trÃĻs en vogue sur le continent europÃĐen, le dÃĐveloppement durable sâimpose aujourdâhui aux pouvoirs publics et privÃĐs comme un outil opÃĐrationnel censÃĐ donner les lignes directrices qui permettraient de trouver un nouveau modÃĻle de gestion plus respectueux de lâenvironnement et de lâhumain. Lâapproche se veut complÃĻte et intÃĐgrÃĐe : il sâagit dâun dÃĐveloppement qui se ne soucierait plus uniquement de la gÃĐnÃĐration des richesses, mais ÃĐgalement de la prÃĐservation des ressources naturelles et de lâamÃĐlioration des rapports sociaux. Autre nouveautÃĐ : lâidÃĐe du long-terme et de la solidaritÃĐ intra-gÃĐnÃĐrationnelle doit dÃĐsormais ÃĐgalement Être prise en compte dans les dÃĐcisions sâinscrivant dans une dÃĐmarche de dÃĐveloppement durable. Il sâagit donc, pour reprendre la dÃĐfinition officielle, dâun ÂŦ dÃĐveloppement qui rÃĐpond aux besoins du prÃĐsent sans compromettre la capacitÃĐ des gÃĐnÃĐrations futures de rÃĐpondre aux leurs[1] Âŧ.
MalgrÃĐ lâunanimitÃĐ apparente avec laquelle toutes les parties concernÃĐes semblent avoir adoptÃĐ cette nouvelle idÃĐologie, il sâavÃĻre quâil existe des diffÃĐrences dans lâinterprÃĐtation et la mise en pratique du ÂŦ DD Âŧ selon le groupe social auquel lâon appartient. Ces diffÃĐrences semblent en partie Être dues à la confusion gÃĐnÃĐrale qui rÃĻgne autour de ce concept parfois perçu comme contradictoire. Confusion qui laisse naturellement une marge de manÅuvre et une libertÃĐ dâinterprÃĐtation considÃĐrable à ces nouveaux acteurs de la durabilitÃĐ.
Afin dâillustrer cette idÃĐe, observons lâattitude vis-Ã -vis du dÃĐveloppement durable de trois groupes sociaux trÃĻs distincts.
Le dÃĐveloppement durable des ONG ÃĐcologistes
En premier lieu, les ONG ÃĐcologistes : ces acteurs pionniers qui ont promu des idÃĐes liÃĐes à la durabilitÃĐ environnementale auprÃĻs des instances officielles et du grand public dÃĻs les annÃĐes 60. Contrairement à ce quâon pourrait penser, leur vision ÃĐcologiste du dÃĐveloppement durable est loin dâÊtre homogÃĻne.
Il existe en effet, à lâintÃĐrieur de la pensÃĐe ÃĐcologiste, diffÃĐrents degrÃĐs de militantisme et par consÃĐquent dâadhÃĐsion à un dÃĐveloppement durable officiel, en lien avec la dÃĐfinition du rapport Brundtland citÃĐe ci-dessus, oÃđ le dÃĐveloppement ÃĐconomique reste le prÃĐalable à tout dÃĐveloppement social et environnemental, ou plutÃīt à un dÃĐveloppement durable qui bouleverse vÃĐritablement les modÃĻles de production et de consommation des sociÃĐtÃĐs modernes. Pour mettre au clair ces diffÃĐrences, on parle parfois de la distinction entre une durabilitÃĐ ÂŦ forte Âŧ ou ÂŦ faible Âŧ. Dans ce dÃĐveloppement durable tellement prisÃĐ, sâagit-il de prÃĐserver lâintÃĐgritÃĐ des ÃĐcosystÃĻmes pour leur valeur intrinsÃĻque, indÃĐpendante de lâutilitÃĐ pour lâhomme, ou suffit-il de garantir la durabilitÃĐ des services que ces ÃĐcosystÃĻmes nous rendent ? La plupart des textes officiels, accords internationaux et lignes de conduite entrepreneuriales penchent vers cette seconde approche, oÃđ lâhomme est au centre des enjeux du dÃĐveloppement durable. Câest lâUnion Internationale pour la Conservation de la Nature, un vaste rÃĐseau environnementaliste international, qui a prÃĐparÃĐ le chemin pour lâinstitutionnalisation de ce dÃĐveloppement durable anthropocentriste. Mais un certain nombre dâautres organisations plus militantes promeuvent une toute autre vision du dÃĐveloppement durable, basÃĐe sur lâaffirmation que nos modes de consommation et de production sont dÃĐvastateurs pour la planÃĻte et quâil nous faudrait un refondement complet de notre modÃĻle ÃĐconomique pour ÃĐviter la catastrophe.
Sâajoute à ces diffÃĐrences initiales que certaines ONG ÃĐcologistes ont vu leur conception du dÃĐveloppement durable ÃĐvoluer dans le dialogue avec leur nouveaux partenaires, que ce soit les institutions internationales qui reconnaissent dÃĐsormais lâimportance de leur rÃīle dans la politique environnementale internationale, ou les entreprises qui, en contrepartie dâun soutien financier, bÃĐnÃĐficient de la visibilitÃĐ positive induite par un partenariat avec une ONG.
Lâattitude des ONG ÃĐcologistes vis-à -vis du dÃĐveloppement durable est donc loin dâÊtre sans ambiguÃŊtÃĐ. Certains posent mÊme la question de leur lÃĐgitimitÃĐ dans la promotion de ce dernier dans un monde oÃđ le concept semble Être devenu consensuel. Cependant il serait une erreur dâoublier lâimportance du travail institutionnel de lâUICN ou des contestations militantes des ONG plus radicales comme Greenpeace ou Friends of the Earth dans la prise de conscience globale. Aujourdâhui, peut-Être que le travail le plus important dans la dÃĐfense du dÃĐveloppement durable, concept dÃĐsormais adoptÃĐ par des acteurs divers à convictions trÃĻs variables, est la sauvegarde de son intÃĐgritÃĐ. Quelles entitÃĐs seraient mieux placÃĐes pour assurer cette tÃĒche que les ONG ÃĐcologistes ?
Le dÃĐveloppement durable des entreprises
En deuxiÃĻme lieu : les entreprises. Ces cibles des accusations ÃĐcologistes dâune mauvaise gestion environnementale et sociale ont fini par adopter le consensus autour du dÃĐveloppement durable qui en est le rÃĐsultat. NÃĐanmoins, on observe que lâentrÃĐe en jeu du monde des affaires reste largement modelÃĐe par des intÃĐrÊts privÃĐs et ne peut pas Être perçu comme un vÃĐritable changement du paradigme ÃĐconomique, qui reste caractÃĐrisÃĐ par la croyance inÃĐbranlable dans la croissance ÃĐconomique et le progrÃĻs technique, comme câest le cas depuis la PremiÃĻre RÃĐvolution industrielle.
Une enquÊte menÃĐe parmi un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises au QuÃĐbec (Gendron, 2001[2]) confirme cette idÃĐe. Si la plupart des chefs dâentreprise reconnaissent lâimportance des enjeux environnementaux et sociaux, le conflit potentiel avec la recherche du profit nâest pas pour autant senti. Ils affirment faire de leur mieux pour intÃĐgrer le dÃĐveloppement durable dans leur processus de dÃĐcision, mais soulignent leur faible marge de manÅuvre confrontÃĐe aux contraintes de la compÃĐtitivitÃĐ, ce qui confirme que les industriels dâaujourdâhui sont loin dâavoir quittÃĐ le paradigme ÃĐconomique dominant. Une situation qui nâest pas susceptible de changer tant que les ÃĐcoles de commerce europÃĐennes nâintÃĻgreront pas les notions de responsabilitÃĐ sociale et environnementale dans lâensemble de leurs formations, mais continuent à proposer uniquement des master spÃĐcialisÃĐs du dÃĐveloppement durable. Cela conduit inÃĐvitablement à une situation oÃđ les entreprises, ontologiquement conçues comme des entitÃĐs ÃĐconomiques et lÃĐgales isolÃĐes et non-ancrÃĐes dans leur environnement, doivent crÃĐer des dÃĐpartements spÃĐcialisÃĐs dÃĐdiÃĐs à la diminution de leurs effets nÃĐgatifs sur leur environnement ÃĐcologique et social. Ces dÃĐpartements, qui emploient naturellement les spÃĐcialistes de dÃĐveloppement durable mentionnÃĐs ci-dessus, portent souvent le nom ÂŦ RSE Âŧ : ResponsabilitÃĐ Sociale des Entreprises. Il sâagit dâun concept souvent expliquÃĐ comme la dÃĐclinaison du dÃĐveloppement durable pour les entreprises, et du fait de sa base volontaire et de son manque de clartÃĐ, il laisse beaucoup de libertÃĐ aux firmes pour lâafficher en fonction de leurs propres interprÃĐtations.
Lâengagement par une firme dans une dÃĐmarche de ÂŦ RSE Âŧ se concrÃĐtise souvent par la publication de rapports de dÃĐveloppement durable, la consultation des parties prenantes (stakeholders) dans les processus de dÃĐcision ou encore lâinitiation de partenariats avec des ONG. Cela trouve souvent une origine dans un souci dâimage et dâavantage concurrentiel. Il nâen reste pas moins que certaines actions positives se font, mÊme sâil sâagit souvent de solutions appliquÃĐes quâaux ÃĐlÃĐments les plus visibles du processus de production, dont le cÅur reste profondÃĐment non-durable.
Un autre facteur qui mÃĐrite lâattention est la privatisation du dÃĐveloppement durable par des agences privÃĐes comme lâOrganisation Internationale de Standardisation (ISO), qui ÃĐdite (entre autre) des normes pour encadrer la gestion sociale et environnementale des firmes. Les certifications ISO, Ã lâabri de tout contrÃīle ÃĐtatique et sans valeur juridique, sont sans aucun doute un atout de compÃĐtitivitÃĐ pour les entreprises, mais leurs impacts sur la protection de lâenvironnement sont souvent moins mesurables.
Le dÃĐveloppement durable de lâUnion europÃĐenne
En troisiÃĻme lieu : les institutions europÃĐennes, que lâon ne peut naturellement pas exclure dâune analyse des reprÃĐsentations du dÃĐveloppement durable en Europe. Ces gardiennes du marchÃĐ unique europÃĐen et de la prospÃĐritÃĐ ÃĐconomique des Etats membres ont ÃĐgalement fini par intÃĐgrer le dÃĐveloppement durable dans leurs textes et directives. Deux remarques peuvent Être faites concernant lâinterprÃĐtation institutionnelle europÃĐenne du dÃĐveloppement durable.
PremiÃĻrement, et ce nâest pas surprenant ÃĐtant donnÃĐ que le dÃĐveloppement durable trouve pour lâinstant sa place uniquement dans le domaine du soft law, lâUnion europÃĐenne sâavÃĻre incapable dâadopter une politique de dÃĐveloppement durable cohÃĐrente, efficace et homogÃĻne qui sâappliquerait sur lâensemble de son territoire. Les Etats membres, rÃĐticents à voir leur souverainetÃĐ remise en cause, considÃĻrent souvent que la protection de lâenvironnement relÃĻve de leur compÃĐtence nationale et veulent ÃĐviter toute ingÃĐrence europÃĐenne en la matiÃĻre. Lâenvironnement est en effet le domaine le plus sujet aux infractions de non-transposition du droit communautaire.[3]
DeuxiÃĻmement, le dÃĐveloppement durable prÃĐconisÃĐ par lâUnion europÃĐenne reste largement dominÃĐ par une vision nÃĐolibÃĐraliste du dÃĐveloppement, oÃđ la croissance ÃĐconomique, la libre-concurrence et le progrÃĻs technique sont dÃĐsignÃĐs comme les principaux mÃĐcanismes dâune stratÃĐgie de durabilitÃĐ, stratÃĐgie dont lâenjeu reste par ailleurs de caractÃĻre ÃĐconomique. En effet, dans ses documents et textes officiels, les objectifs sociaux ou environnementaux viennent toujours en complÃĐment de lâobjectif ÃĐconomique : si lâUE veut par exemple Être pionniÃĻre dans les technologies dâÃĐco-efficacitÃĐ, câest avant tout pour renforcer la compÃĐtitivitÃĐ des entreprises europÃĐennes.
La culture dans le dÃĐveloppement durable
Quelles conclusions peut-on tirer de ces observations ?
Tout dâabord quâil existe une multiplicitÃĐ dâinterprÃĐtations et de concrÃĐtisations du concept du dÃĐveloppement durable, ce qui ne contribue pas à son efficacitÃĐ. Comme certains chercheurs le soulignent[4], chacun sâest trÃĻs rapidement appropriÃĐ du concept sans laisser le temps à une thÃĐorie cohÃĐrente de se former. Personne ne sait aujourdâhui exactement ce qui se cache derriÃĻre ce nouvel objectif partagÃĐ par tous, ce qui laisse la libertÃĐ Ã chacun dây attacher lâinterprÃĐtation qui lui convient le mieux.
LâambiguÃŊtÃĐ inhÃĐrente au terme sâobserve surtout dans la contradiction entre la durabilitÃĐ ÂŦ forte Âŧ et ÂŦ faible Âŧ, et entre le ÂŦ dÃĐveloppement Âŧ et le ÂŦ durable Âŧ. Car comment le dÃĐveloppement, caractÃĐrisÃĐ dans notre conception europÃĐenne par une croissance ÃĐconomique toujours plus forte, peut-il Être compatible avec la durabilitÃĐ ÃĐcologique, surtout dans les pays en dÃĐveloppement ? Comment la durabilitÃĐ peut-elle à la fois dÃĐsigner la continuitÃĐ de la production du capital humain (à substituer au capital naturel disparaissant) et le changement des modes de production pour prÃĐserver au mieux ce capital naturel ?
Si lâon veut vÃĐritablement trouver un modÃĻle de dÃĐveloppement durable, il semble que le premier changement à effectuer avant de pouvoir inventer des modes de production et de consommation plus durables sera avant tout un changement culturel. Les maniÃĻres dont on aperçoit aujourdâhui le monde dans lequel lâon vit et voulons vivre ne vont pas dans le sens dâun paradigme de dÃĐveloppement durable[5] : la recherche effrÃĐnÃĐe de croissance ÃĐconomique par nos gouvernements en crise, notre dÃĐsir pour un quotidien toujours plus confortable et ÂŦ connectÃĐ Âŧ, rythmÃĐ par les lancements de la nouvelle version de tel ou tel gadget ÃĐlectronique, et les habitants des pays en dÃĐveloppement impatients de copier ses modes de consommation et de production, tout cela ne laisse pas beaucoup dâespoir pour un avenir durable. Un dÃĐveloppement vÃĐritablement durable nÃĐcessiterait une rÃĐvolution collective de nos mentalitÃĐs, rÃĐvolution qui sera avant tout profondÃĐment culturelle.

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-