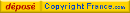« Trepalium »
Travail trouve son origine dans le latin trepalium qui ûˋtait un outil de torture … la chose n’appelle guû´re d’autre commentaire que « tu gagneras ton pain û la sueur de ton front « . De cette incontournable torture rûˋpondant û la contrainte « naturelle » du « bosse ou crû´ve », l’humain est passûˋ, poussûˋ par le goû£t du profit (que font ses employeurs) puis par peur de l’ennui d’ûˆtre face û face avec soi-mûˆme û l’adoration de la torture qu’il subit et, partant, des tortionnaires qui la lui infligent. Vûˋritable victime du syndrome de Stockholm, l’humain en est venu û pervertir son instinct de conservation au point de diviniser son ûˋpuisement et l’exploitation de sa propre et pûˋrissable personne : qui n’a entendu, un jour, un superbe hableur jouer au paradoxe puûˋril du « moi, je me repose en travaillant » ou encore « moi, les vacances me fatiguent ». Pourtant, de tels « poseurs » sont lûˋgion. Cela en dit long sur l’efficacitûˋ rûˋelle du frimeur en question.
Parallû´llement on a vu apparaûÛtre la revendication de « fatigue dûˋlassante » : que ce soit par le sport ou par des loisirs intellectuellement « stimulants. » C’est ainsi que s’est dûˋveloppûˋe l’industrie du loisir fatigant qui vend de l’effort musculaire û ceux qui se trouvent trop statiques. Travail et loisirs ont perdu leurs frontiû´res, leurs repû´res. Quand se repose-t-on ? Quand se divertit-on ? Quand s’adonne-t-on û la production ? Industrie et consommation des loisirs, sûˋrieux bien entendu, semblent devoir complûˋter une journûˋe de voluptueux travail oû¿ l’on a « rûˋalisûˋ son ego profond ». On est loin du « tu gagneras ton painãÎ »!
La chose peut atteindre une sorte de comble avec « l’emploi-spectacle » ã ce spectacle que l’on prûˋtend donner aux autres de sa propre valeur. Spectacle qu’en fait on se joue pour soi-mûˆme. C’est ainsi que pour tant de gens ã avec les effets dûˋsastreux que l’on connaûÛt bien dûˋsormais quand survient le chûÇmage ã « travail » ou « emploi » sont devenus synonymes d’identitûˋ. Lugubre rûˋduction de l’ûˆtre û sa seule partie exploitable par l’entreprise, par la sociûˋtûˋ. Oû¿ est donc passûˋ le reste de cette personne? A-t-elle ûˋtûˋ lobotomisûˋe? Qu’on ne prûˋtende pas que c’est lû tout son ûˆtre ! La seule partie rentable et quantitativement exploitable, la partie vendable et affichable en ûˋchange d’une maigre illusion d’identitûˋ.
Identitûˋs « mangûˋriales »
Cette tendance û rûˋduire l’humain û sa face sociale s’inscrit dans un certain nombre de pratiques vestimentaires, de langage ou autres qui constituent une sorte de mythologie managûˋriale. On a, ûÏû et lû , ûˋtudiûˋ ponctuellement les codes vestimentaires, codes de comportement, jargons et gestuelles d’entreprise ou actes de soumission et d’humiliation (genre saut û l’ûˋlastique etc.). Il est vrai qu’outre les diffûˋrentes formes de la « tyrannie du sûˋrieux » les concepts managûˋriaux sont innombrables et constituent une somptueuse mythologie partiellement autonome par rapport aux autres mythologies contemporaines.
Contentons-nous de ces quelques exemples des modes managûˋriales nûˋes û la fin du XXû´me siû´cle : Le « re-engineering » ou comment faire mieux avec moins. Le « yield management » ou adapter la demande û l’offre plutûÇt que l’inverse. Aprû´s le rû´gne de la demande qui pilotait plus ou moins l’offre, voici le rû´gne de l’offre qui voudrait bien dûˋterminer la totalitûˋ de la demande… entre autres par une manipulation des tarifs incitatifs. Cette pratique ûˋtait au dûˋpart parfaitement utile et justifiable pour les denrûˋes pûˋrissables, peu û peu elle s’est ûˋtendue aux services puis aux transports (un siû´ge sur un vol commercial est effectivement aussi une denrûˋe pûˋrissable). Mais le problû´me tient au fait que c’est devenu un mode de pensûˋe pour tous les secteurs, une nouvelle maniû´re de voir le commerce, l’ûˋchange, le monde, la sociûˋtûˋ.
On en voit quelque peu les effets les plus pevers, les moins cachûˋs, dans la construction aûˋronautique ou le bûÂtiment avec les catastrophes financiû´res ou autres bien connues dûˋsormais. Pensons aux exemples qui, en un temps qui n’est pas si lointain, ont dûˋfrayûˋ la chronique : Boeing et sa surproduction tactique organisûˋe, ou ces immeubles jamais occupûˋs de premiû´re main et qui se dûˋtûˋriorent, vides de tout occupant, tout comme ces centres commerciaux ou ces zones industrielles vides, dûˋsespûˋrûˋment vides. Le but consiste û vendre, û ûˋcouler des produits non stockables, comme une place de transport, un temps d’occupation dans un espace commercial ou industriel, mais, et c’est plus nouveau, ce peut ûˆtre ûˋgalement une idûˋe qui n’a de pertinence que pendant un court laps de temps ã en politique ou en marketing-communication entre autres).Oû¿ sont les limites? Quelles nouvelles moeurs peuvent donc en dûˋcouler? Les dûˋcennies û venir rûˋpondront.
Le travail c’est la santûˋ ?
Vraiment ? Il est alarmant de voir que le lavage de cerveau ambiant conduit certains û ûˋvoquer le rûÇle « protecteur » du travail. Surtout lorsque c’est un mûˋdecin qui parle. Or ce sont lû souvent propos de mûˋdecins . Mûˋdecins qui sont ou devraient avoir ûˋtûˋ, en principe, aux premiû´res loges pour connaûÛtre les mûˋfaits des maladies professionnelles de celles qui sont (aprû´s des dûˋcennies d’indiffûˋrence ou de mensonge opiniûÂtre de la part de l’Acadûˋmie et du patronat) enfin reconnues comme telles et toutes celles, les plus nombreuses, qui ne parviendront jamais, ou au prix de quels efforts, û jouir de ce statut.S’il est vrai qu’un excû´s de sûˋdentaritûˋ peut nuire aux gros mangeurs-buveurs-fumeurs, un excû´s d’activitûˋ physique a de tout temps abrûˋgûˋ la vie des travailleurs manuels. Ce n’est pas une dûˋcouverte. Les dûˋcolleteurs de betterave et les ouvriers du bûÂtiment n’ont jamais fait de vieux os, ou alors dans des conditions d’invaliditûˋ que nul n’envie. Pas plus que telle ou telle profession ou activitûˋ bûˋnûˋvole trû´s physique, trû´s exposûˋe ou de sauvetage ãÎ sapeurs pompiers et tant d’autres. N’insistons pas sur les mineurs, les ouvriers agricoles victimes des engrais, dûˋsherbants et insecticides, les ouvriers de l’amiante ou autres tristes ûˋvidences. Et le mûˆme mûˋdecin-vedette (trû´s prisûˋ sur les radios et chaûÛnes de tûˋlûˋvision) de poursuivre en montrant la dure rûˋalitûˋ de la retraite qui sort le travailleur de son cocon de protection qu’est l’entreprise pour le prûˋcipiter dans la dure rûˋalitûˋ extûˋrieure. D’ajouter encore, sans vergogne, que la retraite est nocive car elle signifie l’arrûˆt de toute activitûˋ intellectuelle. Position assez « divertissante » tout de mûˆme que celle-ci avant mûˆme que de nous permettre de la considûˋrer comme choquante voire odieuse, car elle suppose d’admettre que le travail fasse systûˋmatiquement penser, voire mûˆme seulement permette encore de tenter de penser. Voilû qui est original.
C’est pour le moins inattendu quand on a eu ã comme ce fut mon cas ã pour mission de prendre en main des adultes en cours de carriû´re (re)venus û l’universitûˋ pour une reprise d’ûˋtudes : c’est un bonheur que de les entendre soupirer d’aise lorsqu’ils constatent qu’ils peuvent enfin penser, rûˋflûˋchir, tout dire sans contrainte et sans crainte de n’ûˆtre pas « conforme », sans la menace de n’ûˆtre « plus du tout », sans craindre d’ûˆtre niûˋ ou reniûˋ par l’entreprise : ce qui, in fine, signifie se condamner û se nier soi-mûˆme : c’est en tout cas ce û quoi les DRH invitent les futurs licenciûˋs au moment des « adieux » : « C’est par la faute de gens comme vous que l’entreprise est en difficultûˋ au point de devoir licencier des salariûˋs trop coû£teux comme vous ». Culpabiliser les employûˋs en les accusant d’ûˆtre eux-mûˆmes cause de leur propre infortune, il fallait oser ! C’est pourtant une routine quotidienne qu’il est convenable de taire et qui soulû´ve toujours û l’heure actuelle des questions incrûˋdules de la part de mes interlocuteurs quand je l’ûˋvoque.
Que l’entreprise soit un lieu oû¿ l’on pense (au sens de crûˋation de pensûˋe) ne m’avait pas vraiment frappûˋ, û observer mes semblables ou ce qu’il en reste au terme de quelques lavages de cerveau, si l’on excepte quelques cas rares au sein des professions rûˋputûˋes critiques ou intellectuelles… et encore, une analyse fine devrait s’imposer. Qu’un mûˋdecin puisse faire l’ûˋloge du travail et de cette rûˋsignation abrutissante qu’il implique ! Patronat et corps mûˋdical mûˋdiatique jouent dans la mûˆme cour. Demandez aux grands chefs cuisiniers d’oû¿ ûˋmanent les rares lettres de critique, de regrets qui leur sont adressûˋes. Ils rûˋpondent qu’elles viennent toutes de riches mûˋdecins et plus particuliû´rement de leurs ûˋpouses qui n’omettent jamais de signaler qu’elles accepteraient de « pardonner la faute » si on les invitait gratuitement û constater l’amûˋlioration. Il s’agit lû de rien moins que de 90% des courriers reûÏus par les grands chefs .
Que « travailler » c’est « paraûÛtre »
Eloge ou non par le corps mûˋdical, les effets pervers de cette idolûÂtrie sont innombrables : on connaûÛt les mûˋthodes immondes auxquelles peuvent recourir les DRH au moment des licenciements. On connaûÛt ûˋgalement les situations de dûˋtresse que vivent les personnels licenciûˋs au trûˋfonds de leur ego avec le cortû´ge de comportements aberrants : l’image du cadre qui ne rentre pas chez lui pendant plusieurs jours alors qu’il y est attendu par femme et enfants qui l’aiment et ne demandent qu’û l’entourer est si galavaudûˋe qu’elle n’ûˋmeut plus. Moins connues sont les dûˋvastations identitaires chez ceux qui n’ont en fait pas besoin financiû´rement d’un emploi ã la femme au foyer d’un milieu trû´s aisûˋ n’en est pas le seul avatar, loin de lû . Qui n’a pas de « raison sociale » ûˋchangeable sur le marchûˋ du « paraûÛtre socialement utile » n’ose plus se regarder dans le miroir. Il faut avoir une activitûˋ, si possible, gratifiante, en tout cas l’idûˋal professûˋ par les baba-cools de « vivre pour vivre » ou mieux « live to love and love to live » est perûÏu de nos jours comme la pire des dûˋchûˋances sociales. Peut-on honnûˆtement prûˋtendre que c’est un progrû´s de la personne humaine que de faire passer son honneur et son ûˆtre par une forme quelconque de lûˋgitimation, a fortiori par celle que donnerait, paraûÛt-il, le travail ? Il faut espû´rer que l’ûˆtre humain est infiniment plus que ce qu’il est en mesure d’ûˋchanger û la bourse des valeurs de la fatigue, sur les enchû´res de l’abrutissement servile. Quel pourcentage des tûÂches qui s’offrent û ceux qui quûˆtent un emploi sont gratifiantes ? Quel pourcentage, en revanche, de travaux abrutissants sans la moindre possibilitûˋ d’ûˋlûˋvation ni mûˆme de valorisation aux yeux des proches ou des contemporains au sens large ?
Faut-il avoir recours au caricatural portrait de ceux que les Amûˋricains nomment « workaholic » (calquûˋ sur alcoolique) ã droguûˋs du travail qui ne savent rien faire d’autre que de gagner de l’argent, de « monter des opûˋrations », de se tuer û la tûÂche par peur de l’ennuiãÎ
par peur de la vie. Par peur d’eux-mûˆmes et de leur vide intûˋrieur.
« Travailler pour vivre » … « vivre pour travailler » …
On devine l’ûˋtendue du malaise. Pas besoin d’une grandiose dûˋmonstration pour signaler û notre attention l’ûˋtendue des ravages causûˋs par cette idolûÂtrie du travail. « Travailler pour vivre et non vivre pour travailler » a ûˋtûˋ aujourd’hui, et c’est folie, totalement inversûˋ. Le travail est utile, certes, il doit ûˆtre respectûˋ tant pour l’accomplir que pour le partager d’ailleurs ; mais lorsqu’il devient un « must û la mode » le risque est grand que s’en empare les gens « û la mode », autrement dit, comme c’est aujourd’hui le cas, ceux qui en ont le moins besoin, ceux qui n’en ont le dûˋsir (ce qui n’est pas le besoin) que par conformisme, stratûˋgie de lutte contre l’ennui, technique de fuite de soi, thûˋrapie individuelle, collective ou de couple. Ce faisant ils mettent les autres au chûÇmage. Quelle tristesse de voir le « travail » mondain semer la misû´re dans les rangs des classes modestes. Sans doute voudra-t-on voir dans ce propos une analyse simpliste des tensions ûˋconomiques. Il est nûˋcessaire de rappeler qu’il ne s’agit dans cet essai que de traiter de l’imaginaire, des pulsions et des reprûˋsentations, pas des masses ûˋconomiques.
On ne niera pas que les organisateurs, les gestionnaires voient un certain avantage, tirent un profit rûˋel d’une situation mentale telle que celle que cette idolûÂtrie permet. Les relais sont assurûˋs par les mûˋdias et une intelligentsia ennuyûˋe donc parfaitement dûˋvote. Qui serait assez fou pour oser se rûˋclamer d’un anticlûˋricalisme fervent quand le dieu se nomme « Travail » et son Eglise « Entreprise » ? Ainsi, le culte du travail est, de nos jours, devenu la seule « Vûˋritûˋ » incontestûˋe.

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-