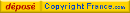Anciens contre modernes ?
Comment miser ? Prûˋsent ou patrimoine ? C’est tout un programme de travail qui semble s’imposer û notre gûˋnûˋration quand on constate l’opposition des deux clans qui s’affrontent tant dans la presse spûˋcialisûˋe que dans les couloirs des ministû´res : les adorateurs du patrimoine (sur l’air de « ah c’ûˋtait le bon temps mais tout fout le camp ») et les adulateurs d’un prûˋsent hyper-post-moderniste porteur des lendemains qui chantent (sur l’air de « miroir mon beau miroir, nous n’avons jamais ûˋtûˋ aussi beaux et intelligents »). Dans un camp on cûˋlû´bre sans pudeur ni discernement le « tout nouveau tout beau ». Dans l’autre on n’hûˋsite pas û se rûˋclamer de la perte de la postûˋritûˋ, û porter un deuil ûˋternel des chefs-d’éuvre d’antant.
On sait ce que l’on peut faire dire au passûˋ. On l’a vu ûˆtre mis au service dãinnombrables enjeux contemporains, des plus futiles ou frivoles aux plus sûˋrieux ou rentables, des plus innocents aux plus machiavûˋliques (manipulations identitaires, tribales, claniques, indûˋpendantistes, universalistes, populistes… ). L’industrie des legs du passûˋ ou celle de son dûˋnigrement est vite devenue une nouvelle filiû´re ûˋconomique. Une chose est sû£re, cependant, elle n’aura jamais les moyens de l’innocence dont elle entend se parer.
En un siû´cle de nombrilisme acharnûˋ, de profusion de publications, de communication dans toutes les directions, de substitution de la quantitûˋ û la qualitûˋ, de substitution de la profusion û la sûˋlection, quel souci devrait-on, on nous pose la question, avoir de la postûˋritûˋ ã autrement dit de la valeur avûˋrûˋe, de ce qui « a fait ses preuves » ? Quel serait, dans ces nouvelles conditions, le bon usage du passûˋ ? Quel serait le bon usage de la mûˋmoire collective et des rapports quãentretient la personne individuelle avec la « gestion » de celle-ci et les reprûˋsentations qu’elle permet ?
Le patrimoine, sous toutes ses formes, sera saluûˋ par les uns comme riche, diffûˋrent, crûˋateur, donc, en dûˋfinitive utile û lãesprit humain et û lãûˋlûˋvation de sa spiritualitûˋ ou de sa crûˋativitûˋ ; par les autres il sera sanctionnûˋ, stigmatisûˋ comme artisan de la stûˋrilitûˋ et du conformisme des ûˋcoles et des acadûˋmismes, gûˋnûˋrateur de rûˋflexes sûˋlectifs fleurant l’ostracisme (quand on ne l’accuse pas de racisme-universalisme-colonialisme), marquûˋ par une û´re qui, bien moins gûˋnûˋreuse que la nûÇtre, fut, elle, nourrie de la « pensûˋe unique » des flagellants ã repentants donc parfaits ã prûˆts û accueillir toutes les cultures du monde pourvu qu’elles ne soient pas occidentales. La nostalgie guindûˋe des uns affronte le repentir spectaculairement gûˋnûˋreux des autres. Pas de place pour un « juste milieu » sans passion. Telle fut la fin du XXû´me siû´cle. On a mûˆme assistûˋ û des luttes acharnûˋes entre les « partisans » d’un occidentalisme patrimonial arrogant et ceux d’un pan-culturalisme adulant les « cultures du monde » (comprenez : tout pourvu que ce ne soit pas occidental). Mais pourquoi devrait-on s’enticher de telles caricatures? Le monde rûˋel (et son histoire) dans sa diversitûˋ est-il trop complexe pour les esprits simplistes des harangueurs des maûÛtres du spectacle, des hûˋrauts de la parole et de la politique ? Parole de ceux qui, tout û la hûÂte de » communiquer », ne s’accordent pas le temps de l’ûˋtude, ni de la pensûˋe, encore moins celui que requiert l’esprit de nuance..
Le passûˋ, pour une de ces factions, est rûˋputûˋ sale, l’avenir, lui, est ancrûˋ sur les forces prûˋsentes dans l’homme du prûˋsent « moderniste », bon, propre… si possible « rûˋvolutionnaire » – mais on n’en est pas trop sû£r. Les lendemains, dûˋcidûˋment, c’est certain, vont chanter.
Lû encore opinion et dogme se sont subtituûˋs au goû£t, û la culture et û la mise en éuvre des principes de sûˋlection sans lesquels ã il convient hûˋlas de le rappeler ã il n’y a ni beau, ni laid, ni progrû´s, ni « rûˋgrû´s », ni mûˆme regret. Le Monde, alors, s’en ûˋtait fait l’ûˋcho.
Le pouvoir, la politique et le monde de l’art ont tout au long de l’histoire connu de nombreuses convergences û dûˋfaut d’une longue histoire d’amour. Ce n’est que rûˋcemment (fin du XXû´me siû´cle) que la confusion organisûˋe de main de maûÛtre est parvenue û gommer les frontiû´res non seulement entre les avenues et les goû£ts du pouvoir mais aussi entre l’art et ce qui « n’en est pas » ã ce dans quoi il faut inscrire la « marchandise ».
Temporalitûˋ cyclique vs temporalitûˋ linûˋaire
Rappel
Mircea Eliade, dans Le mythe de l’ûˋternel retour souligne, aprû´s avoir rappelûˋ l’opposition formelle qui existe entre temps cyclique (rûˋversible, dit primitif) et temps linûˋaire irrûˋversible (qui donne sa conscience tragique au « civilisûˋ »), souligne la co-existence de fait, au sein de nos mentalitûˋs, de ces deux rûˋgimes du temps dans nos vies modernes qui, si elles sont bien conscientes de l’irrattrapable passûˋ, n’en sont pas moins cycliquement rythmûˋes par une sûˋrie de dates anniversaires, fûˆtes privûˋes, sociales, laû₤ques, religieuses ou para-religieuses.
Europe – Amûˋrique
Toutefois, par-delû ce mixte des consciences du temps qui fait la mentalitûˋ de l’homme contemporain, des diffûˋrences apparaissent entre les rives des ocûˋans au céur de ce qu’on pourrait pourtant croire n’ûˆtre qu’une seule et mûˆme culture : celle dite « occidentale ».
Lû oû¿ l’Amûˋrique s’applique û fabriquer, û ûˋdifier, û construire, s’inventer parfois, une histoire, l’Europe s’acharne û rûˋ-ûˋcrire la sienne, les siennes faudrait-il dire tant ses facettes sont diverses. Dans les deux cas, l’histoire ainsi est devenue « performative » : dire suffit û faire exister. Comme la justice qui « dit » le bien tel qu’il est convenu par le droit.
Il en va de mûˆme du discours mythique, car ce qui le distingue du discours lûˋgendaire ou du discours de fiction c’est que ce qu’il dit est vrai. Qu’il dit qu’il dit vrai. Non pas tant parce que ce le fut, un jour, in illo tempore, mais parce que c’est rûˋpûˋtûˋ, perpetuûˋ, donc vrai de tout temps.
Les mentalitûˋs historiques peuvent jouer et jouent de fait, selon les longitudes, sur les deux tableaux : aussi bien faire advenir dans le prûˋsent, en construisant son ûˆtre, que faire advenir dans les consciences en ûˋcrivant un passûˋ parmi tous les possibles.
C’est sur ce fond de dûˋcor chamarûˋ que se jouent les affrontements ûˋvoquûˋs ci-dessus, entre « anciens » et « modernes » avec leurs jeux et enjeux de mûˋmoires : mûˋmoire pour ûˆtre, mûˋmoire pour devenir ou pour se rassurer d’avoir ûˋtûˋ.
Exister c’est possûˋder une mûˋmoire
Car, en dûˋfinitive exister c’est possûˋder mûˋmoire « rûˋcupûˋrer le passûˋ, signale Eliade, est trû´s important » il ajoute nûˋanmoins, ce qui nuance la chose, que « le retour existentiel û l’origine, bien que spûˋcifique de la mentalitûˋ archaû₤que, ne constitue pas une conduite propre û cette mentalitûˋ. »
Il n’y a pas plus de mûˋrite ou de valeur dans une rûˋorganisation une peu maladive d’un passûˋ obsûˋdant que dans une frûˋnûˋsie d’innovation pas toujours structurûˋe ni bûˋnûˋfique.
D’ailleurs l’Amûˋrique s’est mise, elle aussi, dans la seconde partie du XXû´me siû´cle, û l’art de la rûˋ-ûˋcriture arrangûˋe du passûˋ ; les mûˋmoires d’Henry Kissinger ont fait l’objet de mainte expertise critique en dûˋnonûÏant les falsifications et entorses. En matiû´re d’histoire on n’est jamais si bien servi que par soi-mûˆme. Il faut toujours organiser la confusion û son profit !
Les histoires falsifiûˋes
Les manuels d’histoire falsifiûˋe « au nom de la cause », marxiste ou autre, sont bien connus et nombre d’ouvrages s’en sont ûˋmus, en France particuliû´rement, avec la remise en cause de la cûˋlû´bre et, jusque lû , prestigieuse Ecole des Annales puis avec les griefs formulûˋs par Rûˋgine Pernoud ou Jacques Le Goff jusqu’au plus rûˋcent Historiquement correct de Jean Sûˋvilla. Le mouvement s’est inversûˋ et la mûˋfiance a fait suite û l’enthousiasme qui avait permis, comble de la confusion en la matiû´re, dans les annûˋes 1980 û 2000 û des romanciers, fussent-ils talentueux et trû´s conscientieux dans la prûˋparation de leurs « toiles de fond », de passer aux yeux du grand public pour d’authentiques chercheurs ou historiens.
N’est, par contre, pas en voie de disparition cette autre mode (pas plus fondûˋe historiquement – mûˆme si elle se pare de rigueur, elle aussi) qui consiste û dûˋnigrer les fondements de la civilisation occidentale. C’est une autre histoire, semble-t-il autrement mieux orchestrûˋe que celle de la falsification historique, c’est ici celle de toute une culture exposûˋe nue û toutes les entreprises de culpabilisation. Certes les bricolages de l’histoire y ont contribuûˋ ; le rûÇle et l’image souvent bien simpliste que l’on voudrait attribuer ne serait-ce qu’aux Croisades ou û l’Inquisition n’en ûˋtant qu’un modeste exemple.
L’auto-dûˋnigrement de l’Occident
Au tout dûˋbut du XXIû´me siû´cle la mode n’ûˋtait plus û « donner dans le rûˋtro » comme dans les annûˋes 1970, elle est passûˋe û une forme d’autodûˋnigrement constant qui, û brû´ve ûˋchûˋance, devait, en toute logique, conduire l’occidental (tel les « Bourgeois de Calais » de l’imagerie historique) û remettre les clûˋs de la citûˋ û tout conquûˋrant qui se prûˋsenterait – peu importe lequel finalement (les diffûˋrentes paranoû₤a qui s’affrontent sur le sujet des « cultures menaûÏantes » ne pû´chent pas par dûˋfaut de diversitûˋ : de la si redoutûˋe dûˋferlante de la « sous- »culture amûˋricaine jusqu’aux ûˋpouvantables pûˋrils des intûˋgrismes de tous bords, qu’il soient islamistes ou autres…)
Quoi qu’il en soit, toutes ce alternatives « dûˋlivreront » le malheureux europûˋen de son ûˋprouvante culpabilitûˋ, de sa faute originelle d’ûˆtre nûˋ aux sources mûˆme de l’ »occident » et de sa culture, de toutes les cultures, si l’on en croit les imprûˋcateurs professionnels, la plus haû₤ssable.
Avouons que ce caricatural autodûˋnigrement, un tel rejet de sa propre culture, rûˋvû´le un rapport bien ûˋtrange û la mûˋmoire et û son rûÇle. La mûˋmoire est, û vrai dire, terriblement dangereuse, il faut bien le reconnaûÛtre, il semble, û bien y regarder, qu’elle n’ait pas bonne presse de nos jours. Elle peut mûˆme aller jusqu’û nous empûˆcher de voir la « nouveautûˋ » chû´re et chic et follement originale lû oû¿ on aimerait bien nous vendre (sans qu’on prenne garde) des vieilleries (û peine) rûˋnovûˋes : et ce aussi bien en matiû´re commerciale que dans le monde des arts ou dans celui de la politique.
Enfin, dûˋfaut suprûˆme, la mûˋmoire ûˋtablit, fonde, ancre une tradition rassurante (mais bien peu lucrative) qui est incontestablement pûˋtrie de savoir-faire et de techniques ûˋprouvûˋes, de celles qui durent, qui ont fait leurs preuves. On comprend la mûˋfiance, le mûˋpris, quand ce n’est pas la haine qu’elle peut suciter chez les gens de mode, qu’ils soient camelots, manipulateurs, tribuns, marchands…
L’aventure de la mûˋmoire
Changer la mûˋmoire – pour quel « profit » ?
Un individu dûˋpourvu de mûˋmoire est un individu anormal, hors norme, et finalement asocial. Un groupe collectivise sa mûˋmoire pour en faire une lûˋgende collective : jamais vraie, jamais fausse non plus ; groupe et individu assument la fonction de repû´re de cette mûˋmoire. Mais, et je viens de le dire, elle peut ûˆtre parfois sciemment falsifiûˋe. Or, prûˋcisûˋment, nous avons pu assister û la mise en éuvre d’une volontûˋ de rûˋduire la mûˋmoire, de l’ûˋteindre, de la dûˋvaloriser au point qu’on paraûÛt vouloir organiser l’amnûˋsie.
Est-ce afin de mieux vendre les productions contemporaines – et je ne vise pas ici que l’art ? Ou y a-t-il d’autres enjeux ? L’enseignement de l’histoire et de la philosophie ont ûˋtûˋ, û de nombreuses reprises, la bûˆte noire des totalitarismes.
Glorieux passûˋ
La mûˋmoire, au cours de l’Histoire a connu de fort beaux siû´cles voire millûˋnaires : Antiquitûˋ et Moyen Age en ont perfectionnûˋ les techniques et les artifices au plus haut point. Puis vint dû´s le XIIIû´me siû´cle une plus large diffusion de l’ûˋcrit, puis, plus tard, la Renaissance, l’imprimerie ensuite, ont permis d’y avoir moins recours jusqu’û ce qu’elle soit enfin, au XVIû´me siû´cle, identifiûˋe û la sottise par de beaux esprits comme Montaigne ou Rabelais. « Quoi de plus ordinaire qu’un sot douûˋ de mûˋmoire ? », peut-on lire, en substance, sous leur plume. Puis le XIXû´me siû´cle la redûˋcouvrit, en creux cette fois, par ses merveilleuses facultûˋs d’oubli sûˋlectif donc d’oubli « signifiant ». Il fallut alors ûˋtudier les techniques et les ruses de cette partie du moi qui, û notre insu, « gûˋrait » l’oubli de maniû´re si efficace et si dynamique.
Retour dûˋrangeant
Mais voilû qu’on voulut gûˋnûˋraliser cette pratique, ce phûˋnomû´ne individuel, au groupe, et de parler alors d’inconscient « collectif », puis û la totalitûˋ de la race humaine, on peut, certes, suivre C.G. Jung sur le terrain des structures archûˋtypales de l’imaginaire ou de la pensûˋe humaine. De lû û envisager l’organisation d’un oubli collectif au mûˆme titre que l’organisation de cûˋrûˋmonies du souvenir … il y avait un pas. Et quel pas !
Instrumentalisation de la « mûˋmoire »
Pourtant, û certains ûˋgards, aujourd’hui c’est d’amnûˋsie collective, organisûˋe, dûˋlibûˋrûˋe, qu’il conviendrait de parler. Peut-on encore parler de mûˋmoire, de conscience collective ou d’inconscient collectif. Il y a dûˋcûˋrûˋbration. Il faudrait parler d’inconscience collective : de torpeur. Quel meilleur terreau pour semer les graines de toutes les formes de rûˋvisionnisme … et pas seulement de la variûˋtûˋ qui nie l’Holocauste.
Oser parler de « devoir » ?
Examinons cette petite formule qui passe pour belle, louable ou au pire anodine : le « devoir de mûˋmoire ». En creux, un tel « devoir » dit « de mûˋmoire » ouvre tout aussi bien la porte û son envers : le devoir d’oubli. Et cela est rûˋellement effrayant. On imagine trû´s bien quels services cette dûˋmarche bien passûˋe dans les moeurs peut rendre, comment elle pourra permettre de redorer les blasons respectifs des camps du Goulag ou de DachauãÎ La notion mûˆme de devoir appliquûˋe û la mûˋmoire fait frûˋmir. Qui dûˋcrû´te que le devoir de mûˋmoire (donc d’oubli, inversement) doit se porter sur tel objet plutûÇt que sur tel autre ? Qui lave qui ? Avec quelle lessive ?
Certes il fut bien dûˋnoncûˋ ûÏû et lû un risque de dûˋrive tel qu’on peut craindre que le soi-disant devoir de mûˋmoire ne soit qu’un moyen d’entretenir le brasier des haines, des revanches et des vendettaãÎ Mais est-ce bien lû le plus grave pûˋril en ce domaine ?
Que la facultûˋ personnelle, corporellement personnelle devienne l’objet d’un devoir est plus qu’inquûˋtant. Pire, le fait que ûÏa ne scandalise personne porte û justifier le vocable de « torpeur » dont j’usais plus haut de maniû´re qu’on aurait voulu voir excessive. Que lire donc dans un dûˋnigrement du passûˋ et du patrimoine qui s’accompagne d’une gigantesque coulpe qui se bat sur toutes sortes de poitrines au point de n’accepter le passûˋ que pour s’en culpabiliser ? Qu’y voir sinon un vaste refus de soi-mûˆme, de sa culture, de ses propres origines, de ses ancûˆtres, de ce que l’on est, en toute responsabilitûˋ ?
A se croire parfait, l’imprûˋcateur, le donneur de leûÏons, tolû´re mal la rûˋalitûˋ approximative dont nous provenons tous en rûˋalitûˋ et dont nous sommes faits. Coulpes et culpabilisations montrent bien le dûˋcollage, le dûˋcalage entre le mensonge idûˋologique entretenu par les maûÛtres de l’unique pensûˋe correcte et le rûˋel tout de complexitûˋ et de nuance dont ils sont, comme vous et moi, faits.
De lû , encore la confusion
Cette intolûˋrable contradiction ã perte du principe de rûˋalitûˋ dit-on ailleurs ã les conduit, gens de mode, gens du monde et de parole, gens du battage et de la propagande, û renier bruyamment tout ce dont, de fait, ils procû´dent, ce dont ils sont pûˋtris, faûÏonnûˋs. De cette schize morbide naûÛt le marasme, la confusion des valeurs et des rûˋfûˋrences qui commence û ûˆtre clairement dûˋplorûˋe en ce petit dûˋbut frileux de XXIû´me siû´cle. Il en aura fallu du temps !
Ainsi, ce grand bruit en faveur de l’hypercontemporain, inversement proportionnel û la valorisation du passûˋ et du patrimonial, n’est qu’un avatar d’un mouvement bien plus vaste que traduisent clairement les discours que tiennent tant d’intellectuels autoproclamûˋs, drapûˋs dans leur pseudo-intelligence et leur bien rûˋelle maûÛtrise des autres et du monde, prodigues en imprûˋcations, en fait mal dans leur vie, dans leur peau, dans leurs dûˋsirs, dans leurs valeurs, dans leur foi et qui propagent avec tapage des propos « suicidaires ». En tout cela ce qui fait d’abord dûˋfaut c’est l’honnûˆtetûˋ donc, finalement, la modestie, cette forme la plus dûˋnigrûˋe qui soit de l’intelligence, la vraie. Mais, la mode de l’efficacitûˋ agressive (qui dicte nos valeurs) veut que l’homme de modestie soit un ratûˋ par « manque d’ambition », voyons !
Toutefois les effets de ces modes et de la confusion qui en dûˋcoule quant û la juste (?) place du passûˋ et de la crûˋation contemporaine sont dûˋvastateurs, tant moralement que socialement. L’imprûˋcateur, û trop se valoriser lui-mûˆme, s’essouffle, se prend vite û s’exûˋcrer comme ûˋtant indûˋfectiblement redevable de quelque chose û des parents, des ancûˆtres, une tradition lourde et longue. Il se prend aussi û se vouloir plus pur encore, plus parfaitement autonome afin de justifier l’insolence de ses imprûˋcations. Il en vient trû´s vite û dûˋsirer entraûÛner tous ceux qui n’y peuvent mais dans ce vomissement des valeurs qui l’ont fait et nous ont tous faits, peu ou prou.
C’est ainsi qu’on en arrive û priver tous ceux qui en dûˋpendent aussi bien que ceux qui y aspirent d’un systû´me de valeurs et de rûˋfûˋrences trû´s prûˋcieux et auquel ils souscrivent sincû´rement, sans lequel ils ne sauraient vivre, qui leur est, tout û la fois, harmonie, motivation et source de crûˋativitûˋ.
Aspects mimûˋtiques : la « table rase » est derriû´re
La voluptûˋ que l’on est supposûˋ ûˋprouver û l’auto-dûˋnigrement, ou au moins au dûˋnigrement de ses propres valeurs se voit ainsi doublûˋe du plaisir de voir tous ceux qui aspiraient û enfin parvenir û les partager ûˆtre privûˋs de leur but, frustrûˋs de leur espoir. Pire, ils sont conduits û voir l’idûˋal qu’ils s’ûˋtaient donnûˋ ûˆtre mûˋprisûˋ : « si je vois les « grands », les « nantis », auxquels j’ai compris qu’il fallait que je ressemble, se mettre û vomir, û baffouer ce û quoi j’avais cru devoir aspirer, ce que je croyais ûˆtre leur grandeur, la qualitûˋ de leur culture, vers quoi donc faut-il donc dûˋsormais que je tende ? »
Les bourgeois anti-bourgeois (et ils sont lûˋgion dans « certaine » gauche bourgeoise encanaillûˋe) ont plus nui au peuple puis aux idûˋaux du socialisme que tous les aristocrates de l’ancien Rûˋgime ou les exploiteurs capitalistes des XIXû´me et XXû´me, car, eux, la canaille bourgeoise, c’est au nom du peuple qu’ils ont nui au peuple ajoutant l’abjection û l’usurpation ?
Ebranler les structures morales, esthûˋtiques et mentales d’une sociûˋtûˋ expose û de lourdes responsabilitûˋs. Il faut avoir de fortes motivations pour s’y attaquer. Faut-il croire que ceux qui, du fond de leurs salons philosophico-politiques, s’y s’ont adonnûˋ, avec tant d’ardeur pendant les dûˋcennies passûˋes avaient de telles motivations.

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-