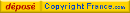Benjamin CLAVû
 Les mutations actuellement û lãéuvre dans le monde de la culture sont intimement liûˋes û une crise gûˋnûˋrale de notre sociûˋtûˋ, voire, si lãexpression est encore pertinente, de la civilisation europûˋenne. Nous traversons actuellement une pûˋriode particuliû´rement trouble qui ne peut se rûˋduire û de simples problû´mes ûˋconomiques.
Les mutations actuellement û lãéuvre dans le monde de la culture sont intimement liûˋes û une crise gûˋnûˋrale de notre sociûˋtûˋ, voire, si lãexpression est encore pertinente, de la civilisation europûˋenne. Nous traversons actuellement une pûˋriode particuliû´rement trouble qui ne peut se rûˋduire û de simples problû´mes ûˋconomiques.
Il semble ainsi trû´s complexe de saisir cet esprit du temps, dãen comprendre les origines et dãen expliquer les principes fondamentaux. Lãune des principales raisons de notre incapacitûˋ û comprendre notre ûˋpoque rûˋside certainement dans le fait que les outils de rûˋflexion dont nous disposons et les grilles de lecture que nous exploitons sont les produits de ces bouleversements. Il serait tentant dãinterprûˋter cette ûˋvolution û travers le prisme du clivage gauche-droite ; malheureusement, chaque pûÇle de cette opposition concentre un ensemble de contradictions (tout particuliû´rement en France) qui ne permettent quãune explication extrûˆmement simpliste et rûˋductrice du rûˋel.
Lãéuvre de Philippe Muray tente justement de donner une explication aux multiples contradictions de notre ûˋpoque. Lãûˋcrivain sãest tout dãabord attachûˋ au dûˋbut des annûˋes 1990 û dûˋmontrer le dûˋveloppement dans nos sociûˋtûˋs dãun rejet de la nûˋgativitûˋ, du Mal. Lãobservation de cet ô¨ Empire du Bien ô£[1] repose sur une approche ô¨ sociûˋtale ô£ de notre civilisation ; la lûˋgû´retûˋ des exemples citûˋs (le dûˋveloppement des terrasses chauffûˋes comme symptûÇme de la dûˋgûˋnûˋrescence et de lãinfantilisation dãun monde qui nãassume pas ses dûˋcisions), lãhumour et lãagressivitûˋ employûˋs amû´nent gûˋnûˋralement le lecteur û sãinterroger sur le degrûˋ de sûˋrieux de lãauteur. Ce dernier fait ûˋvoluer sa thûˋorie de la modernitûˋ au fil de ses observations[2] et parvient au tournant du XXIû´me siû´cle au concept dãû´re hyperfestive.
Ce nûˋologisme dûˋsigne une ûˋpoque qui se caractûˋrise par lãeffacement des diffûˋrences entre temps de loisir et temps de travail ; la fûˆte devient continue.[3] Cãest par la suite lãensemble des divisions et contradictions qui reprûˋsentaient le moteur des sociûˋtûˋs historiques qui est supprimûˋ, dãoû¿ lãabsurditûˋ de cette ûˋpoque post-historique. Philippe Muray dessine une sociûˋtûˋ qui fûˆte sa victoire par un discours dãautocûˋlûˋbration tout en rûˋanimant des forces historiques disparues depuis longtemps pour se convaincre de la justesse et du courage de son combat. LãHomo Festivus est un personnage conceptuel qui dûˋsigne le nouvel homme moderne qui se rûˋalise dans la fûˆte. Philippe Muray justifie lãemploi de ces nûˋologismes. [4]
Ainsi, lãéuvre de Philippe Muray se revendique avant tout comme littûˋraire. Lãûˋcrivain dûˋveloppe un mode de rûˋflexion empirique qui sãattache surtout û la question de la perte de sens ; il sãappuie pour cela sur une ûˋtude attentive de lãûˋvolution de la langue franûÏaise. Philippe Muray partage la conception ambitieuse et anti-idûˋologique de la fiction littûˋraire comme moyen de comprûˋhension du rûˋel ; cãest dans cette mûˆme ambition quãil collabore dans les annûˋes 1990 avec Milan Kundera ou Michel Houellebecq au sein de lãAtelier du Roman.
Comme nous venons de le voir, cette approche littûˋraire du rûˋel dûˋpasse les clivages politiques traditionnels, ce qui a bien sû£r dûˋconcertûˋ les mûˋdias dans leur classification politique de lãauteur. Ce dernier a collaborûˋ avec toutes sortes de revues, quãelles soient monarchistes (Immûˋdiatement) ou communistes (LãIdiot international). Le grand public retiendra surtout son assimilation par Daniel Lindenberg en 2002 au mouvement des ô¨ nouveaux rûˋactionnaires ô£. Les intellectuels ainsi dûˋsignûˋs se rûˋclament des idûˋes des Lumiû´res, mais refusent lãûˋvolution actuelle de la sociûˋtûˋ qui exploiterait selon eux un idûˋal de progrû´s pour mener û bien une terrible rûˋgression. En tant que critiques de la modernitûˋ, il sãagit en effet de rûˋactionnaires de la nouveautûˋ, donc de nouveaux rûˋactionnaires.
Nous tenterons ici de rendre compte du concept de festivisation, qui consiste û transformer le monde selon un idûˋal hyperfestif. Nous tenterons plus particuliû´rement dãobserver les principales transformations de la conception de la culture dans nos sociûˋtûˋs occidentales. Pour cela, afin dãûˋviter de rûˋduire ce travail û un simple commentaire de texte de lãéuvre de Philippe Muray, nous nous appuierons sur des auteurs de sciences humaines susceptibles dãûˋclairer les concepts de lãûˋcrivain. Enfin, il convient de rappeler lãambition limitûˋe de ce travail, le format de cet exercice ne nous permettant quãun survol de la question et un choix dãauteurs totalement subjectif (quel penseur nãa pas ûˋcrit sur la question de la culture ?). Nous ne pourrons rendre compte de lãensemble du problû´me de lãûˋvolution de la culture ; ainsi par exemple les consûˋquences de lãûˋvolution technique sur le rapport aux éuvres ne seront pas abordûˋes.
Nous ûˋtudierons tout dãabord dans une premiû´re partie la crise de civilisation responsable de bouleversements de la conception europûˋenne, puis nous ûˋtudierons le rûÇle central des contre-cultures et enfin dans une troisiû´me partie nous tenterons dãexposer les principes gûˋnûˋraux de lãû´re hyperfestive.
Redûˋfinition de la culture
Dûˋclin de la conception franûÏaise
Publiûˋ en 1987, La dûˋfaite de la pensûˋe dãAlain Finkielkraut souligne les divisions intellectuelles qui sûˋparent la France du monde germanique au tournant du XIXû´me siû´cle. Les idûˋes des Lumiû´res franûÏaises provoquent alors en Allemagne la rûˋaction de penseurs tels que Johann Gottfried Herder, qui oppose aux idûˋes de Nation et dãuniversalisme la notion de Volksgeist, une forme de gûˋnie national propre û chaque pays. LãAncien Rûˋgime ûˋtait fondûˋ sur un droit divin qui instituait une hiûˋrarchie de naissance ; la Nation reprûˋsente au contraire lãexpression dãune communautûˋ volontaire dãindividus rûˋgie par un idûˋal juridique dont elle sera lãauteur. La culture dãune telle nation ne se construit donc pas en puisant dans ses racines mais en tendant au contraire vers un idûˋal universaliste.
A lãopposûˋ de cette vision, ô¨ avec le romantisme allemand, tout se renverse : dûˋpositaires privilûˋgiûˋs du Volksgeist, juristes et ûˋcrivains combattent en premier lieu les idûˋes de loi culturelle ou de loi idûˋale. Sous le nom de culture, il ne sãagit plus pour eux de faire reculer le prûˋjugûˋ er lãignorance, mais dãexprimer, dans sa singularitûˋ irrûˋductible, lãûÂme unique dont ils sont les gardiens. ô£[5] Dans ce systû´me de pensûˋe sans rûˋfûˋrentiel commun û lãensemble des individus, lãhumanitûˋ se conjugue au pluriel.
Vers la fin du XIXû´me siû´cle, lãidûˋal rûˋpublicain sãimpose dans les milieux intellectuels franûÏais. Ce nationalisme parfois virulent entend dûˋfendre un ô¨ gûˋnie franûÏais ô£ ; cependant, si ce concept repose sur les racines (notamment intellectuelles) du pays, il tend vers un universalisme accessible û tous, comme lãillustre le modû´le dãassimilation rûˋpublicain.[6] Cette idûˋologie est û double tranchant : elle explique en grande partie le rayonnement culturel de la France, mais justifie ûˋgalement son expansionnisme colonial. Ce modû´le rûˋpublicain sãoppose frontalement au pangermanisme qui souhaite faire entendre le droit naturel de son peuple. Le nazisme dûˋveloppe cette perspective essentialiste en prûÇnant la supûˋrioritûˋ de la race aryenne, ce qui entraûÛne lãEurope dans la Seconde Guerre mondiale.
Cette derniû´re reprûˋsente par la suite un traumatisme sans prûˋcûˋdent pour lãEurope. La barbarie û lãéuvre durant le conflit (notamment la Shoah) interroge lãOccident. La culture a ûˋtûˋ portûˋe au stade de valeur suprûˆme par les ûˋlites europûˋennes, et pourtant elle nãa pu empûˆcher le dûˋsastre de la guerre. Comme lãexprime George Steiner dans ses Notes pour une redûˋfinition de la culture, ô¨ de quelle grande utilitûˋ la grande tradition humaniste a-t-elle ûˋtûˋ aux opprimûˋs de la collectivitûˋ ? De quel secours face û la montûˋe de la barbarie ? Quel poû´me immortel a jamais enrayûˋ ou tempûˋrûˋ le rû´gne de la terreur, alors que tant lãont chantûˋ ? Et allons plus loin : ceux pour qui un poû´me, un systû´me philosophique, un thûˋorû´me reprûˋsentent, en derniû´re instance, la valeur suprûˆme, ne prûˆtent-ils pas la main aux lanceurs de napalm en feignant de les ignorer, en cultivant une luciditûˋ dûˋsabusûˋe ou un commode relativisme historique ? ô£[7]
Le conflit reprûˋsente ainsi une cûˋsure dans la reprûˋsentation europûˋenne de la culture. Aprû´s des siû´cles de Progrû´s, la civilisation europûˋenne est en faillite et on cesse dûˋsormais de lãassocier û une culture devenue coupable.
La trahison dãaprû´s-guerre et le retour au relativisme culturel
Les premiû´res annûˋes dãaprû´s-guerre sont marquûˋes par la nûˋcessitûˋ dãune reconstruction paisible et rûˋflûˋchie de lãEurope reposant sur une meilleure entente entre les peuples. On aurait alors pu voir en ce nouveau dûˋpart un espoir de renaissance de la culture europûˋenne en tentant de comprendre les mûˋcanismes intellectuels ayant amenûˋ un pays de pensûˋe comme lãAllemagne û engendrer une telle barbarie. Malheureusement, il sãest peu û peu dessinûˋ ce quãAlain Finkielkraut considû´re comme une ô¨ trahison ô£ intellectuelle en Europe, et tout particuliû´rement en France, par le biais des sciences humaines.
A cette pûˋriode, lãanthropologue Claude Lûˋvi-Strauss produit des travaux pour lãUnesco qui rûˋvolutionnent la reprûˋsentation institutionnelle de la culture. Alain Finkielkraut souligne ce basculement idûˋologique. [8]
Cette critique de lãuniversalisme sãaccompagne ainsi dãune valorisation de lãenvironnement traditionnel dont les individus sont issus. Ce relativisme culturel triomphe jusque dans les institutions culturelles, ce qui nãest pas sans consûˋquence[9]. Ainsi, les successeurs des fondateurs de lãUnesco ô¨ continuent dãinvoquer avec emphase la culture et lãûˋducation, mais û la culture comme tûÂche (Bildung), ils substituent la culture comme origine, et ils inversent le cheminement de lãûˋducation : lû oû¿ ûˋtait le ô¨ je ô£, le ô¨ nous ô£ doit advenir ; au lieu de se cultiver (et ainsi de sortir de son petit monde), il faut dûˋsormais retrouver sa culture, entendue comme ô¨ lãensemble de connaissances et de valeurs qui ne fait lãobjet dãaucun enseignement spûˋcifique et que pourtant tout membre dãune communautûˋ sait ô£ (Unesco, Confûˋrence de Mexico sur les politiques culturelles, 1982). Cela mûˆme que la pensûˋe des Lumiû´res appelle lãinculture ou le prûˋjugûˋ. ô£[10]
George Steiner observe ûˋgalement le poids de cette remise en question des normes occidentales sur la conception civilisatrice de la culture[11].
La culpabilitûˋ post-coloniale explique sans doute en grande partie lãintûˋrûˆt grandissant des Occidentaux pour les ô¨ cultures du monde ô£. On assiste ainsi û partir des annûˋes 1970 au dûˋveloppement de nouveaux genres artistiques rûˋservûˋs aux peuples sous-dûˋveloppûˋs. Malheureusement, si ces nouvelles formes dãart sont officiellement traitûˋes avec autant de respect que les productions europûˋennes, on constate quãelles sont systûˋmatiquement lãexpression dãun mode de vie traditionnel et ne sont que trû´s rarement liûˋes û une activitûˋ de la pensûˋe. Il sãagit ainsi davantage de disciplines impliquant une expression du ô¨ naturel ô£, avec par exemple le succû´s de nombreuses danses traditionnelles. Renouant avec la tradition romantique, le public occidental recherche une spiritualitûˋ propre û ces peuples ûˋloignûˋs de la rationalitûˋ europûˋenne. Ce comportement aux intentions louables parvient û dûˋvaloriser la culture occidentale tout en niant aux autres peuples la capacitûˋ de crûˋation dãune éuvre de pensûˋe. Cette labellisation des éuvres exotiques correspond ûˋgalement û une ûˋvolution consumûˋriste du rapport du public û la culture ; le relativisme culturel est largement entretenu par une industrie culturelle visant û dûˋtruire toute hiûˋrarchie autre que la sienne.
Cependant, un des aspects fascinants de cette trahison intellectuelle est quãelle est justement le fait des Occidentaux. Comme le montre George Steiner, le relativisme culturel engendrûˋ par cette culpabilisation exprime lãextraordinaire capacitûˋ critique (et, en lãoccurrence, autocritique) de la rationalitûˋ europûˋenne[12].
Retour au naturel
Cornûˋlius Castoriadis estime ûˋgalement que la culture europûˋenne a ûˋtûˋ victime de son succû´s, de sa luciditûˋ : ô¨ tout se passe comme si, par un curieux phûˋnomû´ne de rûˋsonance nûˋgative, la dûˋcouverte par les sociûˋtûˋs occidentales de leur spûˋcificitûˋ historique achevait dãûˋbranler leur adhûˋsion û ce quãelles ont pu et voulu ûˆtre, et, plus encore, leur volontûˋ de savoir ce quãelles veulent, dans lãavenir, ûˆtre. ô£[13]
La culture europûˋenne reposait sur cet idûˋal qui consistait û transformer lãhomme en ce quãil nãûˋtait pas encore et ainsi û lui procurer une certaine dignitûˋ. La rûˋgression intellectuelle de la seconde partie du XXû´me siû´cle conforte au contraire lãindividu dans sa propre mûˋdiocritûˋ, comme le souligne lãûˋcrivain Renaud Camus :
ô¨ La culture nãest plus ce qui sortait lãhomme de lui-mûˆme, elle est ce qui le confirme en son ûˋtat ; non plus un idûˋal û poursuivre, mais le simple relevûˋ plus ou moins objectif des curiositûˋs rûˋelles et des pratiques les plus rûˋpandues, en matiû´re de loisir. De mûˆme que les dictionnaires dãusage, ayant renoncûˋ û prendre leurs exemples dans la littûˋrature et û fournir les ûˋlûˋments dãun dûˋbat normatif, se contentent dãindiquer û lãusager ce quãest lãusage en effet, de mûˆme les instruments mûˋdiatiques dãinformation culturelle, ayant renoncûˋ û offrir û leurs lecteurs ou auditeurs les moyens dãaccû´s û ce que ces auditeurs ne sont pas encore, mais pourraient devenir, leur tendent, par une tautologie toute semblable, le pauvre miroir de ce quãils sont dûˋjû , aprû´s enquûˆte de marchûˋ. ô£[14]
Les politiques culturelles sont en France largement influencûˋes par ce renversement intellectuel. La politique initiûˋe par Andrûˋ Malraux est ainsi critiquûˋe pour son idûˋalisme. Ce dernier tentait dãamener les FranûÏais û sãûˋlever vers les éuvres, et cela grûÂce û une transcendance quasi-mystique. A lãinstar de Jean Vilar, Malraux espûˋrait dûˋmocratiser lãart, cãest-û -dire le rendre accessible au plus grand nombre, mais sans pour autant remettre en question la qualitûˋ de contenus exigeants et ûˋlitistes. Cette conception classique de la culture a ûˋtûˋ mise û mal par des intellectuels pointant lãûˋchec (du moins partiel) de telles politiques. Comme le souligne Jean-Louis Harouel, Malraux et Vilar mûˋconnaissaient le rûÇle primordial de lãûˋcole dans la dûˋmocratisation de la culture ; sous la IIIû´me Rûˋpublique, lãûˋcole primaire avait ainsi permis dãoffrir une culture classique û un trû´s grand nombre de FranûÏais de toutes classes sociales[15].
Ministre des Affaires culturelles de 1971 û 1973, Jacques Duhamel prend acte de lãûˋchec de la dûˋmocratisation culturelle et de lãidûˋalisme de Malraux ; il prûˋfû´re adopter une conception anthropologique de la culture, en soulignant le rûÇle de celle-ci dans le quotidien des FranûÏais (le concept de ô¨ dûˋveloppement culturel ô£). On assiste ainsi û un glissement sûˋmantique, le ô¨ culturel ô£ se substituant û la culture traditionnelle. Jack Lang confirmera plus tard cette perspective en favorisant (entre autres) les pratiques amateurs ainsi quãen reconnaissant la valeur dãarts autrefois considûˋrûˋs comme mineurs (la musique rock ou la bande-dessinûˋe).
Selon Renaud Camus, la valorisation contemporaine du naturel reflû´te une vûˋritable crise de civilisation quãil traduit par une opposition entre ûˆtre et paraûÛtre : ô¨ Le paraûÛtre est du cûÇtûˋ de la civilisation. Cãest le moins quãil puisse faire, puisque cãest lui qui lãa crûˋûˋe. Lãhomme est sorti de la barbarie le jour oû¿ il a commencûˋ û se soucier du regard de lãautre sur lui, et de lãopinion quãon pouvait entretenir û son sujet, en face. Lãhomme est sorti de la barbarie le jour oû¿ il sãest regardûˋ dans un miroir, ou dans le cours, Narcisse, dãune onde claire. Lãhomme est sorti de la barbarie le jour oû¿ il est sorti de lãûˆtre : il voulait voir de quoi lãûˆtre avait lãair, vu de lãextûˋrieur. ô£[16]
Dãoû¿ une dûˋfense du style et donc de lãart : ô¨ le style est toujours un tremblement du sens ã quelque chose en plus, et quelque chose en moins. Le paraûÛtre est un tremblement du moi ã une mise en branle de la personne, la mise en avant dãun retrait, la mise en exergue du peu de rûˋalitûˋ. Lãûˆtre sans paraûÛtre est un roc, une pierre, un stûˋrûˋotype, un insûˋcable. ParaûÛtre et culture arrondissent les angles, disloquent lãego, bathmologisent le discours, introduisent un doute sur le degrûˋ de sûˋrieux du discours. ô£[17]
Pour lãûˋcrivain, cette rûˋgression se traduit dans le monde de lãûˋducation par une valorisation de lãenfant, dont lãûˋducation est contre-nature : ô¨ la grande loi y est celle du ô¨ naturel ô£ – non pas le naturel de longue conquûˆte, celui que confû´rent lãaisance acquise, la timiditûˋ vaincue, lãexercice de soi ou le style, mais le naturel ô¨ naturel ô£, le naturel tautologique, celui que donnent la nature et la culture qui se fait passer pour nature, la culture dans lãacceptation la plus pûˋjorative du terme, la culture inconsciente de soi, la culture non interrogûˋe, le simple ô¨ environnement culturel ô£.ô£[18]
Nombreux sont les auteurs qui pointent du doigt une infantilisation gûˋnûˋralisûˋe de la sociûˋtûˋ. Il est intûˋressant de constater la multiplicitûˋ des raisons invoquûˋes pour expliquer ce phûˋnomû´ne, que ce soit le systû´me capitaliste pour des auteurs gauchistes[19] ou lãinterventionnisme de lãEtat pour des penseurs libûˋraux[20]. Lãanalyse nûˋo-marxiste et conservatrice de Christopher Lasch[21] semble davantage û mûˆme de rendre compte des ravages de lãûˋducation libûˋrale, concernant notamment les classes populaires. Depuis la mort de lãintellectuel amûˋricain, cette critique a ûˋtûˋ reprise et dûˋveloppûˋe en France par Jean-Claude Michûˋa[22], sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Ainsi, la seconde partie du XXû´me siû´cle a vu se dessiner en Occident – et tout particuliû´rement en France – une rûˋvolution intellectuelle qui a enterrûˋ lãidûˋal civilisationnel europûˋen. GrûÂce û lãappui des sciences humaines, et notamment de lãanthropologie, le relativisme culturel a pu triompher au céur dãinstitutions autrefois vouûˋes û la dûˋfense des idûˋes des Lumiû´res. Sous des intentions louables (le complexe dãune domination culturelle qui par le passûˋ a pu ûˆtre sanglante), ces intellectuels ont rejetûˋ tout universalisme et enfermûˋ les peuples autrefois sous-dûˋveloppûˋs dans des caricatures mûˋprisantes. Comme nous le verrons plus tard, ces penseurs qui se rûˋclamaient de la gauche franûÏaise ont permis par leur discours anti-normatif la fragmentation de la sociûˋtûˋ traditionnelle prûˋexistante ; ils reprûˋsentent ainsi les ô¨ idiots utiles ô£ de la pensûˋe libûˋrale. Observons dans la partie qui suit le processus expliquant la part dãabsurditûˋ de la culture contemporaine que Cornelius Castoriadis dûˋsigne comme une ô¨ montûˋe de lãinsignifiance ô£.
 en fûˆte pimpantes commû´res
en fûˆte pimpantes commû´res 
 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-