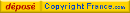La montûˋe de lãinsignifiance
Culture classique et culture bourgeoise
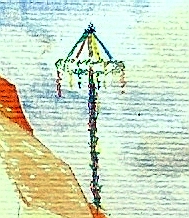 Lãéuvre de Pierre Bourdieu est aujourdãhui essentielle pour comprendre la question de la transmission de la culture. A partir des annûˋes 1960, le philosophe nûˋo-marxiste sãest efforcûˋ de dûˋmontrer les mûˋcanismes û lãéuvre dans la reproduction sociale des classes privilûˋgiûˋes, et pour cela de concevoir la culture comme un outil de domination. Le choix de cet objet dãûˋtude sãexplique sans doute par la trajectoire personnelle de lãintellectuel : issu dãune famille modeste du Bûˋarn, Bourdieu a pu observer lors de son arrivûˋe û Paris û lãEcole Normale le fossûˋ qui le sûˋparait de ses camarades bourgeois parisiens[23].
Lãéuvre de Pierre Bourdieu est aujourdãhui essentielle pour comprendre la question de la transmission de la culture. A partir des annûˋes 1960, le philosophe nûˋo-marxiste sãest efforcûˋ de dûˋmontrer les mûˋcanismes û lãéuvre dans la reproduction sociale des classes privilûˋgiûˋes, et pour cela de concevoir la culture comme un outil de domination. Le choix de cet objet dãûˋtude sãexplique sans doute par la trajectoire personnelle de lãintellectuel : issu dãune famille modeste du Bûˋarn, Bourdieu a pu observer lors de son arrivûˋe û Paris û lãEcole Normale le fossûˋ qui le sûˋparait de ses camarades bourgeois parisiens[23].
Ecrit conjointement avec Jean-Claude Passeron en 1970, La Reproduction entend dûˋmontrer le rûÇle jouûˋ par le systû´me scolaire dans la reproduction sociale. Les classes supûˋrieures auraient imposûˋ û lãûˋcole des codes et valeurs qui favoriseraient leur succû´s ; les classes populaires seraient au contraire confrontûˋes û un ûˋchec dãautant plus pervers quãil sãimposerait naturellement û eux. Le rûˋcit de la rûˋussite scolaire ne serait donc quãune mystification bourgeoise particuliû´rement habile :
ô¨ Instrument privilûˋgiûˋ (ãÎ) qui confû´re aux privilûˋgiûˋs le privilû´ge suprûˆme de ne pas sãapparaûÛtre comme privilûˋgiûˋs, [ce rûˋcit] parvient dãautant plus facilement û convaincre les dûˋshûˋritûˋs quãils doivent leur destin scolaire et social û leur dûˋfaut de dons ou de mûˋrite, quãen matiû´re de culture la dûˋpossession absolue exclut la conscience de la dûˋpossession. ô£[24]
Il rûˋsulte de ce constat une conception extrûˆmement nûˋgative de la culture classique (et notamment de lãapprentissage du latin) qui amû´ne le sociologue û parler de ô¨ gaspillage ostentatoire dãapprentissage ô£ û propos ô¨ de lãacquisition des langues anciennes conûÏue comme une initiation, nûˋcessairement lente, aux vertus ûˋthiques et logiques de lãhumanisme.ô£[25] A lãinstar des anthropologues de lãaprû´s-guerre, Bourdieu se focalise sur les rapports de force rûˋsultant des pratiques culturelles mais nãaccorde absolument aucune valeur û la culture en soi. Le sociologue prûˋfû´re lãobjectivitûˋ et la neutralitûˋ des matiû´res scientifiques û lãenseignement des humanismes, coupables selon lui de reprûˋsenter la culture lûˋgitime. Lãhistorien Paul Veyne sãoppose û cette critique de la culture bourgeoise [26].
Paul Veyne soutient ainsi le point de vue de Renaud Camus et considû´re la culture comme un idûˋal rarement atteint ; si le choc esthûˋtique du public face û lãéuvre demeure une fiction, il lui procure cependant une fiertûˋ[27].
Nous pouvons de nos jours observer a posteriori les bienfaits du modû´le de lãûˋducation classique en France. Jean-Claude Michûˋa regrette lãancienne ûˋcole rûˋpublicaine qui nãûˋtait pas encore totalement adaptûˋe aux besoins du systû´me capitaliste : ô¨ on aurait le plus grand mal, par exemple, û dûˋduire la dûˋcision dãenseigner le latin, le grec, la littûˋrature ou la philosophie, des contraintes particuliû´res de lãaccumulation du Capital. En rûˋalitûˋ, chacun voit bien quãune culture classique rûˋellement maûÛtrisûˋe, nourrie, par exemple, des modû´les du courage antique ou des chefs dãéuvre de lãintelligence critique universelle, avait au moins autant de chance de former des Marc Bloch et des Jean Cavaillû´s, que des spectateurs sans curiositûˋ intellectuelle ou des consommateurs disposûˋs û collaborer sur tous les modes au rû´gne sûˋduisant de la marchandise. ô£[28]
Les diffûˋrentes rûˋformes de lãûˋducation inspirûˋes par les travaux de Bourdieu ont menûˋ û un appauvrissement gûˋnûˋral des savoirs (symbolisûˋ par la question du baccalaurûˋat, pour lequel le gouvernement fixe des objectifs de rûˋussite et non de contenu) sans pour autant rûˋduire les inûˋgalitûˋs de classes. Bourdieu a malgrûˋ lui accûˋlûˋrûˋ la ô¨ modernisation ô£ du systû´me ûˋducatif en lãadaptant aux exigences du marchûˋ et en supprimant des matiû´res ô¨ bourgeoises ô£ susceptibles de former lãesprit critique des ûˋlû´ves.[29] Jean-Claude Michûˋa explique ce phûˋnomû´ne contradictoire : ô¨ dans un premier temps, on proclame que lãEcole nãest dûˋjû rien dãautre quãun outil au service de la reproduction du Capital. Aprû´s quoi, fort de cette radicalitûˋ apparente, on peut exiger, au nom de lãanti-capitalisme lui-mûˆme, la disparition de tout ce qui constitue en rûˋalitûˋ un obstacle û lãextension du rû´gne de la marchandise. Cãest lû le procûˋdûˋ constant des gardes rouges du Capital. ô£[30]
La contre-culture libûˋrale
Dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx dûˋcrit le fonctionnement de la dynamique rûˋvolutionnaire du capitalisme : ô¨ la bourgeoisie ne peut exister sans rûˋvolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, cãest-û -dire lãensemble des rapports sociaux. ô£ Jean-Claude Michûˋa souligne la justesse de cette analyse : ô¨ le capitalisme est par dûˋfinition un systû´me social auto-contestataire et la dissolution permanente de toues les conditions existantes constitue son impûˋratif catûˋgorique vûˋritable. ô£[31]
Cette perspective permet de comprendre lãessor û partir des annûˋes 1960 dãune contre-culture opposûˋe û la culture lûˋgitime bourgeoise. Selon le philosophe, ce mouvement que lãon associe communûˋment û mai 68 (et û tort, car il ne reprûˋsente pas lãensemble de lãûˋvû´nement) aurait exprimûˋ une volontûˋ dãaffranchir le marchûˋ dãarchaû₤smes tels que le gaullisme ou le PCF [32].
Publiûˋ en France en 2006, Rûˋvolte consommûˋe : le mythe de la contre-culture, de Joseph Heat et Andrew Potter, repose sur une thû´se semblable : les mouvements de contre-culture ont ûˋtûˋ totalement incapables de ô¨ changer le systû´me ô£ pour la simple raison quãils reprûˋsentent en rûˋalitûˋ le moteur de ce systû´me. Ces diffûˋrents courants (principalement les hippies, les punks puis les altermondialistes) ont bûÂti leur contestation sur lãidûˋe que la sociûˋtûˋ de consommation impose un mode de vie conformiste aux consommateurs. Or, le systû´me capitaliste a en rûˋalitûˋ un fort besoin de renouvellement du marchûˋ (besoin qui sãest, il est vrai, fortement accûˋlûˋrûˋ avec le temps), dãoû¿ le rûÇle primordial dãespaces de contestation permettant lãûˋmergence de nouveaux modes de consommation.[33]
Le secteur artistique se caractûˋrise de nos jours par une paradoxale institutionnalisation de ces contre-cultures. La conception de lãacadûˋmisme a considûˋrablement ûˋvoluûˋ depuis le XIXû´me siû´cle ; le succû´s dãéuvres û prûˋtentions subversives est dûˋsormais incontestable, comme le constatait Pierre Jourde il y a quelques annûˋes[34].
Ce constat semble sãappliquer tout particuliû´rement û lãart contemporain, lãanti-acadûˋmisme sãûˋtant imposûˋ dans cette discipline comme la norme depuis maintenant de nombreuses dûˋcennies. Lãinstitutionnalisation de lãanti-acadûˋmisme nãest pas sans consûˋquence pour les éuvres ; la subversion affichûˋe se rûˋduit bien souvent û une provocation gratuite et vide de sens, comme lãexplique Dany-Robert Dufour[35]
Les critû´res dãapprûˋciation dãune éuvre sont devenus relativement flous, la conception classique de lãart et du beau nãayant plus aucune pertinence de nos jours. Les collectionneurs formant le marchûˋ de lãart contemporain parviennent û spûˋculer sur des éuvres dont la valeur est uniquement fixûˋe par ce mûˆme marchûˋ en fonction de leur potentiel commercial[36]. Ce fonctionnement ûˋconomique trû´s ûˋtrange ne fait que renforcer lãabsurditûˋ du secteur de lãart contemporain ; il est ainsi tentant dãopûˋrer un parallû´le entre ce non-art et le non-argent spûˋculatif qui le finance.
Lãabsurditûˋ de notre ûˋpoque se rûˋvû´le ûˋgalement û la multiplication des figures dãoxymores. Philippe Muray interprû´te ces expressions comme la manifestation dãune rûˋsolution gûˋnûˋrale des contradictions et ainsi de la fin de lãHistoire[37]
Nous essaierons dans la partie suivante dãexposer les principes fondamentaux de ce que Philippe Muray dûˋsigne comme ô¨ lãû´re hyperfestive ô£, soit le rû´gne dãun nouveau genre humain, lãHomo Festivus, lãhomme qui se rûˋalise dans la fûˆte.
 en fûˆte pimpantes commû´res
en fûˆte pimpantes commû´res 
 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-