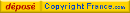Lâanimation culturo-festive de lâespace urbain
Il est indÃĐniable quâà cÃītÃĐ de lâembourgeoisement des quartiers populaires en Occident, les nouveaux habitants continuent à vivre dans lâillusion, savamment entretenue par les municipalitÃĐs, de participer à une vie de quartier. Dans ce sens, le discours sur le quartier-village va de pair avec la crÃĐation dâÃĐvÃĐnements culturo-festifs censÃĐs reprÃĐsenter cette communion thÃĐÃĒtralisÃĐe, cette convivialitÃĐ recrÃĐÃĐe de toute piÃĻce. Du quartier populaire, lâacteur principal de la gentrification â le nÃĐo-bourgeois se dÃĐmarquant de la haute bourgeoisie et de ses codes â ont conservÃĐ (idÃĐalisÃĐ) cette simplicitÃĐ.
Le ministÃĻre de Jack Lang a marquÃĐ une rupture dans les politiques culturelles françaises. Le rÃīle dÃĐvolu à la culture à la sortie de la guerre, nÃĐ dâune entente entre gaullistes et communistes dans le sillage du Conseil national de la RÃĐsistance, celui dâun ÂŦ art ÃĐlitaire pour tous Âŧ, a ÃĐtÃĐ abandonnÃĐ lors des annÃĐes Lang au profit dâune politique de divertissement[33], alors que le terme de culture est intimement liÃĐ au concept dâÃĐducation et dâÃĐlÃĐvation[34].
AprÃĻs les lendemains qui chantent, des lendemains en chanson
Le culturo-festif est le fruit de la politique culturelle suivant le chemin de lâÃĐconomique. Sous lâÃĻre Malraux, le domaine culturel est encore marquÃĐ par la raretÃĐ (Åuvres du passÃĐ et grandes Åuvres du prÃĐsent, dÃĐfinition ÃĐtroite de la culture). Les Maisons de la culture ne peuvent ainsi proposer quâune consommation individuelle de la culture. Câest dâailleurs le but affichÃĐ : le choc esthÃĐtique, soit la relation dâun individu et dâune Åuvre. Cette premiÃĻre phase de la politique culturelle se caractÃĐrise ainsi par un processus dâaccumulation individuelle. NÃĐanmoins, Malraux reprÃĐsente la culture bourgeoise traditionnelle, ce qui le dispose peu à entrevoir les nouveaux enjeux dÃĐvolus à la culture : sâil conçoit que la culture apporte le ÂŦ supplÃĐment dâÃĒme Âŧ nÃĐcessaire à la civilisation capitaliste, il nâentend pas quâelle doive pour cela Être massifiÃĐe. Son ÃĐchec pour transformer ses Maisons de la culture en cathÃĐdrales modernes tient dans ce point.
Les Maisons de la culture ne peuvent ainsi proposer quâune consommation individuelle de la culture. Câest dâailleurs le but affichÃĐ : le choc esthÃĐtique, soit la relation dâun individu et dâune Åuvre. Cette premiÃĻre phase de la politique culturelle se caractÃĐrise ainsi par un processus dâaccumulation individuelle. NÃĐanmoins, Malraux reprÃĐsente la culture bourgeoise traditionnelle, ce qui le dispose peu à entrevoir les nouveaux enjeux dÃĐvolus à la culture : sâil conçoit que la culture apporte le ÂŦ supplÃĐment dâÃĒme Âŧ nÃĐcessaire à la civilisation capitaliste, il nâentend pas quâelle doive pour cela Être massifiÃĐe. Son ÃĐchec pour transformer ses Maisons de la culture en cathÃĐdrales modernes tient dans ce point.
Pour transformer les ÃĐquipements culturels en ces nouveaux temps, lâaccumulation doit Être intensive et collective. Pour cela, lâaction culturelle doit trouver un nouveau marchÃĐ. La critique soixante-huitarde de la culture allait offrir lâoccasion de toucher le plus grand nombre : il faut dÃĐsormais lier culture et vie quotidienne dans une optique capitaliste. Ainsi à partir des annÃĐes 1970, lâÃĐquipement culturel acquiert la fonction idÃĐologique de ÂŦ reproduction des rapports de domination politico-idÃĐologique Âŧ[35]. Pour rÃĐpondre à cette nouvelle fonction, les planificateurs urbains intÃĻgrent lâÃĐquipement socio-culturel au centre de leurs prÃĐoccupations afin dâencadrer le temps libre et de transmettre les valeurs et les reprÃĐsentations de la sociÃĐtÃĐ ; lâintÃĐriorisation de celles-ci permettant de nourrir lâillusion dâune sociÃĐtÃĐ sans classe (apparente) :
ÂŦ Les ÃĐchanges et les brassages que les ÃĐquipements collectifs sont censÃĐs favoriser ne visent pas à mettre fin à la sÃĐgrÃĐgation sociale, mais à faire croire que cette fin est possible sans quâil soit besoin de toucher aux mÃĐcanismes qui sont à lâorigine de la sÃĐgrÃĐgation. Âŧ[36].
NÃĐanmoins lâobjectif nâa pas ÃĐtÃĐ tout à fait rempli, puisque les classes populaires ont continuÃĐ Ã ignorer ses ÃĐquipements. AprÃĻs avoir fixÃĐ la culture en un espace central (Malraux et le culturo-ÃĐlitiste), dissÃĐminÃĐ les ÃĐquipements sur le territoire (lâanimation socio-culturelle), il sera dÃĐcidÃĐ de toucher la population de maniÃĻre plus directe : dans la rue avec le culturo-festif. Lâespace urbain sera investi pour faire de la ville une fÊte en lâhonneur du libidinal.
On peut trouver lâorigine de festivisme dÃĻs le 10 mai 1981, lors de la fÊte organisÃĐe pour lâÃĐlection à la prÃĐsidence de François Mitterrand Le ÂŦ peuple de gauche Âŧ se rÃĐunit pour cÃĐlÃĐbrer ce que François Mitterrand a modestement qualifiÃĐ de ÂŦ troisiÃĻme ÃĐtape dâun long cheminement, aprÃĻs le Front populaire et la LibÃĐration Âŧ[37]. Il fallait trouver un endroit symbolique à Paris : ce sera la place de la Bastille. Le nouveau pouvoir en place cherche à sâinscrire dans la gÃĐographie politique de la ville[38]. Le choix de la Bastille nâest donc pas innocent. Il sâagit pour le nouveau pouvoir de se positionner, dans un sens tÃĐlÃĐologique de lâHistoire, dans la succession de la RÃĐvolution française. Mais ce fut la Bastille et non la Concorde, la prise dâune prison qui nâÃĐtait plus, plutÃīt que le changement de systÃĻme politique et ÃĐconomique[39]. Dâailleurs François Mitterrand ne tarde pas à dÃĐvoiler les objectifs de son septennat ÂŦ Câest convaincre qui mâimporte et non vaincre Âŧ[40]. DÃĻs lors, le choix dÃĐlibÃĐrÃĐ du rappel à la RÃĐvolution française apparaÃŪt comme une volontÃĐ de dÃĐpolitiser à la fois la victoire aux ÃĐlections (union nationale) et la RÃĐvolution française elle-mÊme (reprendre la Bastille). LâÃĐvocation intÃĐgratrice de la communautÃĐ par lâhistoire va culminer avec la comÃĐdie des festivitÃĐs du Bicentenaire de la RÃĐvolution française. OrganisÃĐes par le publicitaire Jean-Paul Goude, les cÃĐlÃĐbrations se gardent de tout rappel historique, le nÃĐo-bourgeois se dÃĐfinissant dans un ÃĐternel prÃĐsent. Par la fÊte, lâintelligentsia socialiste a pris soin de dissoudre lâÃĐpaisseur historique et dâÃĐtendre ce temps indÃĐfini et indÃĐfinissable pour effacer les restes de la mÃĐmoire populaire, qui sâÃĐtait construite sur une sÃĐrie dâÃĐvÃĐnements historiques majeurs : la RÃĐvolution française, la Commune, le Front populaire, la RÃĐsistance. Les socialistes sâinscrivent dans lâhistoire, afin de mieux la nier. Par le ÂŦ pourrissement de lâHistoire Âŧ, soit la nÃĐgation du passÃĐ et lâimpossibilitÃĐ de lâavenir, il sâagit dâadapter et de prÃĐparer les consciences au libÃĐralisme ; lâÃĐlite socialiste rejouant la dÃĐcouverte du Nouveau monde en lieu et place de lâhistoire du potentiel rÃĐvolutionnaire du peuple français[41].
La fÊte comme remÃĻde à la lutte des classes
Au cours des annÃĐes 1970, la fÊte pouvait encore apparaÃŪtre comme une activitÃĐ non-aliÃĐnÃĐe et libÃĐratrice. La ÂŦ fÊte de jadis Âŧ est censÃĐe rompre la monotonie, avec le culturo-festif la fÊte moderne exalte la monotonie du mouvement de lâaxe temporel du prÃĐsent, dâ ÂŦ une spirale infinie dâune finalitÃĐ sans fin Âŧ[42].
Le capitalisme a dÃĐtruit au fur et à mesure les sociabilitÃĐs et solidaritÃĐs traditionnelles (famille, village, paroisse) nÃĐcessitant la crÃĐation de nouveaux outils (crÃĻches, asile, etc.) et la crÃĐation de nouveaux loisirs. La sociabilitÃĐ traditionnelle impliquait lâexistence de valeurs humaines partagÃĐes, la common decency dâOrwell[43]. LâEtat accompagne ce mouvement du capitalisme pour recrÃĐer les conditions de la vie sociale en sociÃĐtÃĐ capitaliste : il protÃĻge en partie les populations les plus pauvres et les plus faibles (lâEtat-Providence), mais en mÊme temps il concourt à lâaffaiblissement des moyens individuel et collectif de reprÃĐsentation de la sphÃĻre sociale par la gÃĐnÃĐralisation et la colonisation de lâensemble des activitÃĐs (Etat ÂŦ Big Brother Âŧ au double sens de policier et de ÂŦ grand copain Âŧ).
Dans la sphÃĻre culturelle, câest lâEtat ÂŦ Big Brother Âŧ et les industries culturelles qui agissent de concert pour recrÃĐer du ÂŦ lien social Âŧ, lien factice car artificiellement ÃĐtabli. LâEtat vise ainsi principalement la conservation et la perpÃĐtuation des rapports sociaux, tout en limitant la conflictualitÃĐ. Ainsi à cÃītÃĐ de son action visant à promouvoir lâart de lâavant-garde pour quelques mondains (stratÃĐgie du prestige), il a mis en place une politique de dÃĐmocratisation de la culture de la diversion (stratÃĐgie de la persuasion).
Les espaces de loisirs, devenus lâespace urbain dans son ensemble, marquent leur refus dâapparaÃŪtre en lien avec les rapports de production. Il sâagit comme câÃĐtait le cas pour lâÃĐquipement culturel, mais à une ÃĐchelle bien plus vaste, de faire naÃŪtre lâillusion de la libertÃĐ et de lâaffranchissement des rapports de production. La fÊte â de quartier, municipale, ÃĐvÃĐnementielle et dÃĐsormais europÃĐenne â illustre lâidÃĐe dâun brassage de classe, or ÂŦ les classes sociales se parlent à elles-mÊmes, dans un dialecte qui est propre à chacune, et inaccessible à ceux qui nâen font pas partie. Âŧ[44] La fÊte, pas plus que lâespace culturel, nâest vÃĐcue de la mÊme maniÃĻre selon son origine sociale. Mais peu importe, puisque lâobjectif est de faire croire, de masquer le rÃĐel. La conflictualitÃĐ cherche à Être dÃĐsamorcÃĐe par la mise en avant du discours de la convivialitÃĐ et de la citoyennetÃĐ. Si la sociabilitÃĐ nâest en soi pas contestataire â elle en est une cause â la citoyennetÃĐ rejette, pour sa part, la contestation.
Ainsi si la fÊte est originellement transgressive, elle est dÃĐnaturÃĐe par les politiques urbaines et culturelles en lui imposant un but. La thÃĐmatique du bonheur entrait ainsi dans le domaine de la politique politicienne : Jack Lang voulait un ministÃĻre du bonheur, Bertrand DelanoÃŦ entend par ses diffÃĐrents projets offrir des occasions de bonheur aux Parisiens. NÃĐanmoins il ne sâagit pas de bonheur, mais de dÃĐsir, ou pour le dire selon les termes de B. DelanoÃŦ, qui nâont ÃĐtrangement provoquÃĐ aucun quolibet, ÂŦ de quelque chose de jouissif Âŧ[45]. Ainsi de la culture et de lâArt, il nâest plus promu et attendu une rÃĐflexion, une ÃĐlÃĐvation, une prise de conscience durable mais une rÃĐcrÃĐation passagÃĻre et une emprise inconsciente qui, elle cherche à Être durable. Diversion et transmutation.
La fÊte devient un appareil idÃĐologique ÃĐtatique visant la rÃĐgulation sociale, le ludique remplaçant le policier. La pseudo-transgression à laquelle la fÊte dans sa version contemporaine exhorte retranscrit le passage, initiÃĐ post-soixante-huit, de lâOrdre moral à lâordre sans la morale mais avec un pouvoir conservÃĐ et renouvelÃĐ[46].
Pour cette sociÃĐtÃĐ du ÂŦ jouissif rÃĐcrÃĐatif Âŧ, le calendrier liturgique sera rythmÃĐ par de nombreuses fÊtes : fÊte de la musique[47], fÊte du livre, fÊte du cinÃĐma auxquelles sâajoutent les fÊtes transgressives comme les techno-parades ou les festivals alternatifs. Le festival apparaÃŪt comme le nouveau chemin de foi : on se rend aux festivals comme autrefois on se rendait à Compostelle. Tous les chemins mÃĻnent à un festival.
Le rejet de la rÃĐalitÃĐ atteint son paroxysme
ÂŦ Lâair de la ville rend libre au bout dâun an et dâun jour Âŧ voulait un adage mÃĐdiÃĐval. Or, force est de constater quâil libÃĻre de moins en moins les classes populaires. Les politiques urbaines marquent la dÃĐpossession du droit à la ville[48] pour la classe populaire au profit de la nÃĐo-bourgeoisie. La ville est ainsi modelÃĐe selon les volontÃĐs et dÃĐsirs de cette classe. Les classes populaires sont nÃĐanmoins invitÃĐes, en guise de consolation, à se joindre à des ÃĐvÃĐnements ÃĐminemment festifs (Paris-Plage ou Rome-Plage, rÃĐponse politique à la question sociale ?) pour revenir dans les villes contempler ce quâils ont perdu. Dâautre part, le culturo-festif marque la dÃĐpossession au niveau individuel de lâentendement et de la capacitÃĐ des classes populaires à se constituer en une classe agissante. La pensÃĐe est une activitÃĐ dangereuse, il convient dâen dÃĐtourner ceux qui risquent dâen user dâune maniÃĻre jugÃĐe mauvaise par la classe dominante.
Lâart pourrait jouer un rÃīle important dans la prise de conscience de la rÃĐalitÃĐ. Lâart est à mÊme de traduire la ÂŦ substantifique moelle Âŧ des choses, ÃĐvÃĐnements collectifs et singularitÃĐ de lâindividu. Il permet une rÃĐflexion sur soi, une introspection, une remise en cause individuelle morale condition sine qua non de toute remise en question de la sociÃĐtÃĐ nÃĐo-libÃĐrale[49]. Il est en cela flagrant que parmi les dystopies (1984 de George Orwell ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) le livre joue un rÃīle fondamental. Dâailleurs Marx nâa-t-il pas dit que le vÃĐritable Capital avait ÃĐtÃĐ ÃĐcrit par Balzac.
Il nây a pas à imposer un prÃĐtendu engagement des artistes en tant quâartistes (pseudo-revendication), pas plus que lâartiste ne doit Être placÃĐ dans une icÃīne au dessus du reste de la population, ce serait tomber, pour paraphraser G. Orwell dans La ferme des animaux, dans un ÂŦ Tous les hommes sont ÃĐgaux, mais les artistes le sont plus que les autres Âŧ. Mais pour cela, il faut que lâartiste retrouve ses moyens symboliques de production que le capitalisme a pervertis par la sociÃĐtÃĐ du Spectacle[50].
Le passage de lâindividuel au collectif nâest pas chose aisÃĐe avec lâart. NÃĐanmoins, la dÃĐmocratisation annoncÃĐe nâa, non seulement, pas portÃĐ ses fruits, mais elle a ÃĐgalement rendu flou le concept dâart et de culture. Dernier avatar de cette perte de repÃĻres : les proclamations du ministre de la culture, FrÃĐdÃĐric Mitterrand, voulant intÃĐgrer le jeu vidÃĐo dans le patrimoine. Le rejet de la rÃĐalitÃĐ atteint son paroxysme : le virtuel ÃĐlevÃĐ au rang de rÃĐalitÃĐ.

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-