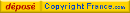Pierre MAYOL
La consommation des Français et leur vie culturelle 1944-1955
A la mÃĐmoire de Jean-Claude Klein.
Ce texte est la version remaniÃĐe et complÃĐtÃĐe dâun article paru dans Paris 1944-1954, publiÃĐ par Autrement, sÃĐrie MÃĐmoires N°38, mai 1995. Jean-Claude Klein, à qui je rends hommage – lâun des deux pilotes de ce volume collectif -, est dÃĐcÃĐdÃĐ peu aprÃĻs la sortie du numÃĐro.
Dans cet article, jâobserve d’abord les donnÃĐes macro-ÃĐconomiques et dÃĐmographiques de la France au sortir de la seconde guerre mondiale, puis je m’intÃĐresse au dÃĐveloppement de la vie culturelle pendant les dix annÃĐes suivantes, surtout sous ses aspects matÃĐriels (en particulier : ÂŦ lâÃĐquipement des mÃĐnages Âŧ). J’ai pris la culture au sens large d’aspiration à des modes de vie ÂŦ modernes Âŧ, ce qui, aprÃĻs-guerre, tient en deux mots : confort et autonomie. Ou plutÃīt : confort POUR l’autonomie. Autrement dit, le concept à privilÃĐgier est celui d’autonomie, des familles par rapport à la Nation, des couples par rapport à la famille, des enfants et des jeunes par rapport aux parents – phÃĐnomÃĻne en cascade, en somme. C’est lâapparition de l’atomisation des individus contre le fonctionnalisme des clans, des familles et des groupes sociaux. Mais il sâagit aussi d’un individualisme consensuel, câest-à -dire, dâune certaine maniÃĻre, dâun individualisme collectif, dÃĐpendant dâune idÃĐe gÃĐnÃĐrale de lâindividu – ce qui peut sembler contradictoire dans les termes. Disons que ce qui paraÃŪt clair à tout le monde, câest que lâindividu est la valeur suprÊme du moment, et que cette valeur est particuliÃĻrement exaltÃĐe par la vie et les produits culturels.
*
Un tel titre peut sembler anachronique, quand on sait que la premiÃĻre enquÊte sur les pratiques culturelles des Français n’a ÃĐtÃĐ publiÃĐe qu’en 1974[1], vingt ans aprÃĻs la fin de notre pÃĐriode – et il y a dÃĐjà vingt ans ! A cette premiÃĻre difficultÃĐ, le temps, s’en ajoute une autre, la diffÃĐrence, qui rend pÃĐrilleuses les comparaisons : jusqu’en 1950 au moins, les modes de vie ÃĐtaient presque ceux de 1930 et, par là , plus proches de 1890 que de 1995. Nous ne disposions pas de ces passerelles entre les annÃĐes que sont, par exemple – mais combien significatifs ! – la tÃĐlÃĐvision, le poste à transistors, les variÃĐtÃĐs, le rock, les grands ensembles, les grandes surfaces, etc., qui ne s’ÃĐpanouiront vraiment, au sens oÃđ nous l’entendons encore aujourd’hui, qu’aprÃĻs notre pÃĐriode, entre 1955 et 1965, pour durer encore aujourdâhui sous des modalitÃĐs diverses. TroisiÃĻme difficultÃĐ, la principale, cette dÃĐcennie tourmentÃĐe comprend deux blocs solidement opposÃĐs : jusqu’en 1949 on produit, à partir de 1950 on consomme. C’est le ÂŦ passage d’une conduite de survie, à la recherche d’un ÃĐpanouissement personnel Âŧ (Victor Scardigli). Redressement et Reconstruction sont les mots clÃĐs du premier lustre, confort mÃĐnager et consommation, fruits de la rÃĐcompense, ceux du second.
A. Turbulences
La dÃĐcennie a un dÃĐmarrage difficile qui nuit à l’ÃĐmancipation ÃĐconomique rapide des mÃĐnages : une quinzaine de prÃĐsidents du Conseil, une vingtaine de gouvernements, des luttes entre les partis – qui choqueront tant le gÃĐnÃĐral de Gaulle -, des grÃĻves redoutables (1947, 1953…), toutes ces turbulences tÃĐmoignent d’hÃĐsitations politiques qui retardent le maigre enrichissement de mÃĐnages, alors fort dÃĐmunis. En 1945, en effet, les destructions humaines et matÃĐrielles sont si considÃĐrables que ÂŦ l’indice gÃĐnÃĐral de la production industrielle est, en 1945, à 38, pour 100 en 1938 et 29 en 1929. La France est ramenÃĐe d’un demi-siÃĻcle en arriÃĻre[2]. Âŧ
ÂŦ Quelles sont les prÃĐoccupations immÃĐdiates des Français ? La majoritÃĐ des Français s’attachent à survivre Âŧ, note de Gaulle[3]. En tÊte des urgences, le ravitaillement : ÂŦ jamais les Français n’ont mangÃĐ si peu de pain qu’aprÃĻs la LibÃĐration[4] Âŧ, le charbon manque à lâindustrie comme aux mÃĐnages – les restrictions dureront jusqu’en 1947 au moins. Tout cela n’est guÃĻre favorable à la consommation, en particulier culturelle, considÃĐrÃĐe comme un luxe, un ÂŦ supplÃĐment d’ÃĒme Âŧ, dont on s’occupera plus tard, quand il sera temps, quand on aura de quoi…
Le pays connaÃŪt aussi une forte vague d’inflation, et ce depuis 1936. De 20 à 24% pendant l’Occupation – pourtant sous ÃĐconomie dirigiste, avec blocage des salaires -, elle atteint 48% en 1945, 50% en 1946, 51% en 1947, 58% en 1948. Cette ÂŦ forme raffinÃĐe de l’escroquerie[5] Âŧ absorbe les augmentations de salaire concÃĐdÃĐes par l’Ãtat. Selon la formule classique, ÂŦ c’est la course entre l’omnibus des salaires et le rapide des prix Âŧ (Jacques Chapsal). DÃĻs 1945, ÃĐclate le conflit doctrinal entre la rigueur anti inflationniste incarnÃĐe par Pierre MendÃĻs France, et la souplesse reprÃĐsentÃĐe par un RenÃĐ Pleven, plus favorable à la consommation. Le premier Plan, plutÃīt mendÃĐsien, de Jean Monnet tranche en privilÃĐgiant ÂŦ le charbon, la sidÃĐrurgie, les transports, l’ÃĐnergie, le machinisme agricole, [qui] paraÃŪtront sacrifier – et ils sacrifieront effectivement – la consommation Âŧ (Henri Amouroux; soulignÃĐ par moi). ConsÃĐquence, les mÃĐnages ont du mal à s’installer et ignorent les prÃĐmices de la sociÃĐtÃĐ de consommation qui commencent à briller dans les salons et les foires.
B. Production
EndoctrinÃĐs, ou responsabilisÃĐs, les Français se mettent au travail. DÃĻs le 10 septembre 1944, BenoÃŪt Frachon, secrÃĐtaire confÃĐdÃĐral de la C.G.T. et, en ce temps-là , homme fort du Parti, appelle à produire. Maurice Thorez renchÃĐrit à Waziers, le 21 juillet 1945 : ÂŦ produire, c’est aujourd’hui la forme la plus ÃĐlevÃĐe de la lutte de classes, du devoir des Français Âŧ. ÂŦ La pÃĐriode de la reconstruction avait victorieusement relevÃĐ la production, la hissant dÃĻs 1949 à son niveau de 1929, rÃĐtabli les ÃĐquilibres extÃĐrieurs en bonne partie grÃĒce à l’aide amÃĐricaine, tout en laissant à la traÃŪne le pouvoir d’achat des salariÃĐs[6]. Âŧ Les mÃĐnages, qui ont sacrifiÃĐ leur temps libre aux heures supplÃĐmentaires, bien rÃĐmunÃĐrÃĐes[7], perçoivent les dividendes de leurs efforts à partir de 1949, quand l’onde de choc de la croissance se rÃĐpercute enfin sur le pouvoir d’achat et le niveau de vie, qui ont fini par s’ÃĐpanouir au plus prÃĻs de la production.
Le dÃĐcollage s’esquisse en 1949, mais c’est seulement en 1953 que le fameux 5% par an[8] se confirme vraiment et devient la rÃĻgle jusqu’au dÃĐbut des annÃĐes 70, bÃĐnÃĐficiant surtout aux couches moyennes, en accroissant ainsi les inÃĐgalitÃĐs avec les classes sociales les plus pauvres. Toutefois, et en rÃĐsumÃĐ, on peut dire que, jusqu’en 1949, les Français se sont d’abord intÃĐressÃĐs au sort de LA France ; et qu’aprÃĻs 1949, ils commencent à s’intÃĐresser à eux-mÊmes.
C. « Notre premier devoir, le plus urgent, va Être de repeupler la France »[9]
Dans le dÃĐsarroi de l’aprÃĻs-guerre, un comportement, saluÃĐ par tous les observateurs, ÃĐtonne par sa prÃĐcocitÃĐ, le redressement dÃĐmographique. RÃĐtrospectivement, on dirait que les mÃĐnages ont obÃĐi au gÃĐnÃĐral de Gaulle demandant en mars 1945 ÂŦ d’appeler à la vie les douze millions de beaux bÃĐbÃĐs qu’il faut à la France en dix ans Âŧ. Pourtant, les spÃĐcialistes avaient le pronostic sombre. Jean FourastiÃĐ, chantre du ProgrÃĻs, prÃĐvoyait en 1945 une catastrophe dÃĐmographique pour 1960 : ÂŦ le prolongement à peu prÃĻs sÃŧr, à peu prÃĻs fatal des conditions dÃĐmographiques actuelles indique qu’en 1960, dans quinze ans (nous sommes à peu prÃĻs sÃŧrs du chiffre, à moins d’un redressement spectaculaire…), nous ne serons plus que 40 millions[10]. Âŧ Il s’est trompÃĐ, le redressement a bien eu lieu, mÊme s’il n’a pas ÃĐtÃĐ Ã la hauteur des souhaits du GÃĐnÃĐral : 46 millions de Français en 1960, grÃĒce en partie à une natalitÃĐ gÃĐnÃĐreuse de 840 000 naissances en 1946, 867 000 naissances chacune des trois annÃĐes suivantes, et, avec des hauts et des bas, une moyenne de 840 000 naissances par an jusqu’au dÃĐbut des annÃĐes 70. ÂŦ La France s’est dÃĐridÃĐe en pouponnant Âŧ (Jean-Pierre Rioux). Jamais depuis 1901 il n’y avait eu autant de naissances, et ÂŦ plus jamais depuis 1950, les naissances ne l’emporteront aussi largement (+322 900) sur les morts Âŧ (Henri Amouroux).
Le souci familialiste (enfants, dâoÃđ confort nÃĐcessaire…) des mÃĐnages entraÃŪne leur matÃĐrialisme. Vouloir des enfants aprÃĻs une telle guerre n’ÃĐtant pas seulement remplacer les morts mais fonder la vie sur les valeurs, l’une ancienne, traditionnelle et attendue, de sÃĐcuritÃĐ, l’autre nouvelle, frondeuse et gourmande, de satisfaction : ÂŦ aprÃĻs l’ÃĐtalage de l’impuissance et les ÃĐclats de la chute, voici la face heureuse de ces annÃĐes, quand la fÃĐconditÃĐ et l’ambition s’enhardissent avec les gains de productivitÃĐ et la multiplication des biens Âŧ (Jean-Pierre Rioux; soulignÃĐ par moi). Du point de vue ÃĐconomique, on assiste au passage de relais entre des siÃĻcles de thÃĐsaurisation prÃĐcautionneuse, et l’ÃĐpoque, toute moderne et juvÃĐnile, de la dÃĐpense hÃĐdoniste. Cela sâopÃĻre en particulier par la transformation des rapports au fiduciaire, matÃĐriellement traduite par la substitution, encore timide mais insistante, du bas de laine ou de l’enveloppe dâargent liquide (la paye hebdomadaire ou mensuelle), par le compte-chÃĻques – anticipant la carte de crÃĐdit, dont le Français est gros utilisateur. Quant à la famille, de cellule sociale traditionnelle, voire coutumiÃĻre, elle se mÃĐtamorphose en groupe pilotÃĐ par le choix libre des conjoints, ÂŦ adonnÃĐs de plus en plus à la recherche du bonheur Âŧ (Jean Stoetzel). On se marie beaucoup, les couples sont jeunes et ont des enfants rapidement : l’indice de fÃĐconditÃĐ est de 2,94 enfants (1,65 en 1994), et les trois quarts des enfants issus des mariages cÃĐlÃĐbrÃĐs autour de 1950 naissent dans des familles qui comprendront au moins trois enfants[11] (moins de 20% aujourd’hui). Indice de frivolitÃĐ, ou d’ÃĐmancipation, une enquÊte de 1951 dans le dÃĐpartement de la Seine (qui, à lâÃĐpoque, comprend Paris et ses actuels dÃĐpartements limitrophes) montre, dÃĐjà , quâun quart des bÃĐbÃĐs (23%) sont le fruit de conceptions prÃĐnuptiales (on ne parle pas encore des naissances hors mariage, dont le taux est alors infÃĐrieur à 5% des naissances)…
D. Confort : Plus d’espace pour moins de monde.
Ne manquent ni l’ardeur au travail ni les ressources, modestes mais constantes (c’est le plein emploi), mais la place. Les logements sont petits et inconfortables. Le logement des classes pauvres et moyennes est alors le problÃĻme numÃĐro un. Depuis la fin de la premiÃĻre guerre mondiale, la France a pris un retard considÃĐrable par rapport à ses voisins europÃĐens. On peut dire, presque, quâen terme de logement, rien nâa bougÃĐ depuis les annÃĐes 20. Neuf logements sur dix n’ont pas de sanitaires (baignoire, douche), deux sur cinq n’ont pas les W-C. intÃĐrieurs, un sur trois n’a pas l’eau courante. Une enquÊte de 1952 sur le logement des jeunes mÃĐnages dans le dÃĐpartement de la Seine d’alors rÃĐvÃĻle qu’à cette date un quart (24%) habitent avec leurs parents, dans une exiguÃŊtÃĐ telle que les trois-quarts d’entre eux (18% du total) ne disposent pas d’intimitÃĐ (en clair, ils dorment dans la mÊme piÃĻce que les parents, ou sur le canapÃĐ du salon dÃĐpliÃĐ chaque soir…). En outre, un sur vingt (4%) vivent dans un hÃītel et un sur sept (14%) dans une seule piÃĻce sans cuisine. Au total, 42% des jeunes mÃĐnages ne sont pas logÃĐs correctement, proportion qui monte à plus de 50% chez les jeunes ouvriers. De plus, 56% trouvent insuffisantes (26%) ou trÃĻs insuffisantes (30%) leurs conditions de logement[12]. Il n’est pas ÃĐtonnant, dans ces conditions, que lâexigence de confort à domicile soit si prÃĐgnante, et se traduise, dÃĻs que possible, par un appÃĐtit vigoureux de consommation, ce qui, à lâÃĐpoque, ne signifie rien dâautre que : le minimum de confort. C’est que la consommation renforce l’autonomie de la famille dans la sociÃĐtÃĐ, et, par emboÃŪtement hiÃĐrarchique, l’autonomie de l’individu dans la famille. Car ce qu’elle proclame le plus fort, c’est cette formule toute simple, chargÃĐe de rÊves et d’espaces, mumurÃĐe par tous, de l’adolescent aux grands-parents : ÂŦ avoir un coin à soi, chacun chez soi Âŧ.
Plus d’espace, plus confortable, pour moins de monde, tel est le fil rouge de la dÃĐmographie dans ses rapports anthropologiques avec l’habitat. La diminution du nombre moyen de personnes par piÃĻce au fur et à mesure des recensements (de 1,4 vers 1950 à 0,68 au recensement de 1990), et, corrÃĐlativement, l’augmentation du nombre moyen de piÃĻces par logement (de 2,5 à 3,8), et de la surface de ces piÃĻces, sont le tÃĐmoignage prÃĐcieux de cette lente mais irrÃĐpressible conquÊte d’espace domestique, propice à l’expression personnelle des enfants comme des parents. En 1950, la famille conjugale a dÃĐfinitivement supplantÃĐ la famille parentale. Le couple est le grand vainqueur de ce combat pour l’ÃĐmancipation amoureuse, qui aurait commencÃĐ Ã germer pendant le Romantisme allemand, à la fin du XVIIIÃĻme siÃĻcle – en tÃĐmoignerait la pression dÃĐmographique des conceptions prÃĐnuptiales et la baisse de l’endogamie, maniÃĻres pour les amants d’imposer leur choix aux calculs des clans[13]. L’heureuse conjonction en 1950 de la reprise, et de l’autonomie des couples (ÂŦ chacun chez soi Âŧ) va permettre à la SociÃĐtÃĐ de Consommation – parÃĐe de majuscules, manne pour les petits et les sans-grades, rÃĐpulsion pour les nantis – de proposer ses services au plus grand nombre en taillant, sur mesure pour chacun, un confort à petits prix aux objets variÃĐs, et variables. Au tableau d’honneur de quelques croissances, pour 100 en 1949, l’ÃĐlectromÃĐnager est à 500 en 1957, l’automobile à 385, les voyages aÃĐriens à 280, les investissements pour le logement à 245, les communications tÃĐlÃĐphoniques de 200. Au total, et pendant la mÊme pÃĐriode, le PNB augmente de 49%, tandis que la population totale n’augmente que de 5%, et le nombre de logements, construits en nombre notoirement insuffisant, de 7%[14].
E. Formica, bricolage, et compagnie
Les mÃĐnages investissent d’abord dans le mobilier blanc, le sanitaire et la cuisine, dont les ÃĐlÃĐments sont joliment regroupÃĐs sous le vocable d’Arts mÃĐnagers[15]
. Le Formica en reste le symbole le plus populaire. Nom dÃĐposÃĐ d’un ÂŦ plastique phÃĐnolique comprimÃĐ Âŧ inventÃĐ en 1950, on l’emploie pour des panneaux isolants et des meubles, surtout ceux du sanitaire et de la cuisine. HabillÃĐs de couleurs vives, ces tables, tabourets, chaises, plans de travail, etc., rÃĐsistent aux dÃĐgÃĒts enfantins, à la chaleur, à l’eau bouillante, aux acides et dÃĐtergents domestiques, et sont d’un entretien facile[16]. Dans la perspective au long cours, mais dÃĐjà enclenchÃĐe en 1950, d’un dÃĐsengagement des tÃĒches mÃĐnagÃĻres au profit d’un temps libÃĐrÃĐ pour d’autres activitÃĐs (loisirs, emploi…), ce genre de dÃĐtail est dÃĐcisif pour le choix des objets du confort domestique.
Au Formica s’ajoutent les installations alors exceptionnelles, traditionnelles depuis, comme ÃĐviers blancs (à la place des vieux ÃĐviers en pierre ou en mÃĐtal), douches, baignoires, chasses d’eau. Obligeant à faire de nÃĐcessitÃĐ vertu pour raisons d’ÃĐconomie (le matÃĐriel coÃŧte cher), ces nouveaux appareils de confort dÃĐveloppent le talent des bricoleurs. Pierre Belleville[17] a bien montrÃĐ que l’amÃĐnagement de l’espace domestique pour amÃĐliorer la vie quotidienne, accueillir la famille et les amis, ou agrandir l’habitat, dÃĐveloppe des activitÃĐs d’une authentique valeur culturelle et sociale – ou : culturelle parce que sociale.
F. Radio, tÃĐlÃĐvision
Seconde vague d’investissement, le mobilier acajou – plus tard mobilier noir[18]. Il s’agit de la radio et, un tout petit peu, de la tÃĐlÃĐvision, qui sont encore de beaux meubles en bois ouvragÃĐ. ÂŦ Les annÃĐes 50 sont l’ÃĒge d’or de la radio Âŧ (RenÃĐ RÃĐmond) : 5 345 941 rÃĐcepteurs radios dÃĐclarÃĐs en 1945, 6 889 522 en 1950, 9 266 464 en 1955 (pour 14 millions de mÃĐnages environ), un doublement en dix ans[19]. La Radiodiffusion française (R.D.F.) compte trois chaÃŪnes mÃĐtropolitaines, ChaÃŪne nationale, ChaÃŪne parisienne et Paris-Inter (ancÊtre de France-Inter), et neuf RÃĐgions radiophoniques de 1945 à 1962[20]. Des ÃĐmissions expÃĐrimentales en modulation de frÃĐquence à partir de mai 1946 sont officialisÃĐes en mars 1954 mais, trop confidentielles, elles ont peu d’impact sur les auditeurs.
Monopole d’Ãtat, ÂŦ la surveillance des ondes est ÃĐtroite [ . . . ] , la censure est tatillonne, voire ridicule[21] Âŧ. En octobre 1948, le secrÃĐtaire d’Ãtat à l’Information, un certain François Mitterrand, ÂŦ fait parvenir à tous les producteurs une circulaire par laquelle il interdit l’utilisation des ÃĐmission artistiques et littÃĐraires de la Radiodiffusion française à des fins politiques Âŧ. La R.D.F. devient la R.T.F. (Radiodiffusion-tÃĐlÃĐvision française) par dÃĐcret du 9 fÃĐvrier 1949, et contrÃīle par la SOFIRAD (SociÃĐtÃĐ financiÃĻre de radiodiffusion) les postes pÃĐriphÃĐriques, comme Radio-Luxembourg, qui renaÃŪt en novembre 1945, Radio Andorre, Radio Monte-Carlo, ou Europe N°1 qui naÃŪt en 1955.
Les auditeurs prÃĐfÃĻrent les ÃĐmissions de dÃĐtente comme Travaillez en musique, On chante dans mon quartier, par Saint-Granier, avec son cÃĐlÃĻbre indicatif ÂŦ Ploum ploum tra la la Âŧ. Ou PÊle-mÊle de Jean-Jacques Vital, et ses deux vedettes, M. Champagne, et le chanteur comique Bourvil ; Le Grenier de Montmartre, rendez-vous des chansonniers le dimanche à midi ; Les Branquignols, Faites chauffer la colle, avec Robert DhÃĐry, Pierre Dac, Jean Carmet, Louis de FunÃĻs, AimÃĐe Mortimer, etc. Sur Radio-Luxembourg, c’est le succÃĻs du feuilleton inusable de Jean-Jacques Vital La famille Duraton (commencÃĐ en 1936, il durera jusqu’en 1961), du Crochet radiophonique, de Ãa va bouillir, ou bien de jeux dont le plus cÃĐlÃĻbre reste Quitte ou double de Zappy Max, dont le sociologue Georges Friedmann remarque qu’il exalte la culture gÃĐnÃĐrale et contribue à l’instruction des auditeurs.
La tÃĐlÃĐvision en est à un stade rudimentaire. Il vaut la peine d’ÃĐnumÃĐrer la progression : 297 postes (dÃĐclarÃĐs) de tÃĐlÃĐvision en France le premier janvier 1950, 3 794 en 1951, 10 558 en 1952, 24 209 en 1953, 59 971 en 1954, 125 088 en 1955, 260 508 le premier janvier 1956. Au terme de notre pÃĐriode, seulement 2% des mÃĐnages ont la tÃĐlÃĐvision, soit un sur cinquante[22]. Deux dates conservent une forte saveur symbolique : le 25 mai 1949, deux speakerines sont recrutÃĐes sur concours, Jacqueline Joubert et Arlette Accart ; et le 29 juin, Pierre Sabbagh prÃĐsente le premier journal tÃĐlÃĐvisÃĐ : il dure 15 minutes, à 21 heures, cinq jours par semaine. En janvier 1950, une seconde ÃĐdition est crÃĐÃĐe entre 12 h 45 et 13 heures[23]. Le sacre de la reine d’Angleterre, retransmis en direct dans cinq pays le 2 juin 1953, accÃĐlÃĻre la vente des postes de tÃĐlÃĐvision. Mais la tÃĐlÃĐvision de 1950 ne supplante pas encore le poste (de radio) du salon. D’abord, elle ne diffuse que 25 heures d’ÃĐmission par semaine (en 1951), ensuite elle coÃŧte cher. Regarder la tÃĐlÃĐvision se pratique surtout dans les cafÃĐs, les ÂŦ tÃĐlÃĐ-clubs Âŧ, ou bien chez d’heureux – et accueillants – voisins. Les Tours de France font un tabac dans l’ÃĐtÃĐ des bistros, mais aussi les premiers feuilletons comme L’Agence Nostradamus de Claude Barma, ou bien des soirÃĐes de variÃĐtÃĐs comme Music-hall parade de Gilles Margaritis. DÃĻs 1952, la tÃĐlÃĐvision a ses ÂŦ ÃĐmissions fÃĐtiches Âŧ (RenÃĐ RÃĐmond) comme 36 Chandelles, de Jean Nohain, La joie de vivre d’Henri Spade ou La piste aux ÃĐtoiles, de Gilles Margaritis.
G. Le cinÃĐma
Nous ne ferons qu’ÃĐvoquer l’industrie du cinÃĐma. Toutefois, bien que RenÃĐ RÃĐmond note qu’il est le ÂŦ premier spectacle de France Âŧ, la chute de la maison cinÃĐma est dÃĐjà programmÃĐe. De 200 millions (en 1930) à 231 millions (en 1936) d’entrÃĐes par an dans les salles obscures à la veille de la guerre, la frÃĐquentation atteint, certes, 424 millions en 1947, soit un indice de frÃĐquentation supÃĐrieur à 10 sÃĐances par habitant et par an – record jamais dÃĐpassÃĐ. De plus, aprÃĻs un creux à 360 millions en 1952, la frÃĐquentation touche un nouveau sommet en 1957 avec 411 millions d’entrÃĐes. Mais c’est vite le dÃĐclin inexorable (dix ans aprÃĻs, en 1967, on ne compte dÃĐjà plus que 211 millions, puis 167 millions en 1977, etc.[24]). Cette prÃĐmonition de la baisse de la frÃĐquentation est si forte que dÃĐjà l’Almanach Hachette de 1953 s’inquiÃĻte :
De moins en moins de spectateurs. Les salles obscures ont vu diminuer leur clientÃĻle. En moyenne, chaque Français qui allait dix fois par an au cinÃĐma en 1948 n’y va plus que neuf fois maintenant. Pourquoi ? Le prix des places a augmentÃĐ, sans doute. Mais n’est-ce pas surtout parce que le grand public se refuse de plus en plus à aller voir des films mÃĐdiocres.
Et l’article d’ÃĐnumÃĐrer : 399 millions d’entrÃĐes en 1948, 387 millions en 1949, 380 millions en 1950, 370 millions en 1951.
La grande dÃĐcouverte, c’est le cinÃĐma amÃĐricain. Depuis 1940, aucun film amÃĐricain n’avait pÃĐnÃĐtrÃĐ en France. Fin 44, une ordonnance avait interdit toute entrÃĐe de films ÃĐtrangers, à l’exception d’une quarantaine de bobines rÃĐservÃĐes aux soldats amÃĐricains, mais le public français sây prÃĐcipita. Un habitant sur deux à Paris, un sur quatre en province, a vu au moins un film amÃĐricain dÃĐbut 1945. Les accords d’entraide financiÃĻre, dits Blum-Byrnes, du 28 mai 1946, comportent une annexe encourageant les films amÃĐricains, ce qui ÃĐmeut le milieu artistique français, mais n’empÊche pas le cinÃĐma amÃĐricain d’exercer un attrait considÃĐrable sur le grand public[25].
Les succÃĻs sont, dâailleurs, autant français qu’amÃĐricains. Et il vaut la peine de rappeler quelques titres, comme Cendrillon (1950) et Alice aux pays des merveilles (1951) de Walt Disney, des westerns comme La flÃĻche brisÃĐe (1950) de Delmer Daves, Le train sifflera trois fois (au titre original superbe : High Noon) de Fred Zimmerman (1952), qui consacre le couple Gary Cooper et Grace Kelly, L’homme des vallÃĐes perdues (1952) de George Stevens, avec un Alan Ladd romantique et justicier, Rio Bravo (1959), de Howard Hawks. Des films d’aventures comme Fanfan la Tulipe (1952) de Christian-Jaque (un rÃīle exprÃĻs pour GÃĐrard Philippe), IvanhoÃĐ (1952) de Richard Thorpe, 20 000 lieues sous les mers (1955) de Richard Fleischer, Le monde du silence (1956) de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle. Pendant la mÊme ÃĐpoque, certains films, et non des moindres, prennent la jeunesse comme thÃĻme principal, Les enfants terribles (1950) de Jean-Pierre Melville assistÃĐ, si on peut dire, de Jean Cocteau. Encore s’agit-il là d’une sorte de romance subtile, qui n’a pas grand-chose à voir avec des films amÃĐricains comme L’ÃĐquipÃĐe sauvage (1954), de Lazlo Benedeck, avec Marlon Brando dans une bande de blousons noirs à moto terrorisant une petite ville, Graine de violence (1955) de Richard Brooks, film qui associe (dÃĐjà !) la dÃĐlinquance juvÃĐnile au rock’n'roll – qui fait ici sa premiÃĻre apparition en bande-son au cinÃĐma avec le succÃĻs de Bill Haley Rock around the clock. La mort accidentelle de James Dean le 30 septembre 1955 explique peut-Être le succÃĻs en France du film de Nicholas Ray, La fureur de vivre (mars 1956), traduction trÃĻs ÂŦ existentialiste Âŧ d’un titre amÃĐricain sociologiquement plus dÃĐfaitiste : Rebel without a Cause.
H. Lire : la presse, les livres
ÂŦ En France, plus qu’en tout autre pays, l’ÃĐcrit est aurÃĐolÃĐ de prestige. La lecture est au sommet de la hiÃĐrarchie des pratiques culturelles[26] Âŧ. La censure de l’Occupation a jugulÃĐ ce dÃĐsir. DÃĻs les premiers jours de la LibÃĐration, et au fur et à mesure de l’avancÃĐe des AlliÃĐs, la presse tant nationale (c’est-à -dire parisienne) que rÃĐgionale explose littÃĐralement aprÃĻs quatre ans de silence. A Paris, elle prÃĐcÃĻde mÊme de quelques jours la descente par le GÃĐnÃĐral de Gaulle des Champs-ElysÃĐes (samedi 26 aoÃŧt 1944). Pour parler franchement, ce sont des feuilles de chou de quatre pages imprimÃĐes à la diable. La censure, dÃĐboulonnÃĐe, ne peut plus sÃĐvir dans les imprimeries clandestines qui s’organisent pour faire renaÃŪtre une presse digne de ce nom. Il s’agit, dans un premier temps, d’une presse ÂŦ trÃĻs politisÃĐe[27] Âŧ, et mÊme extrÃĐmiste. Par exemple la presse communiste, qui reprÃĐsentait 5% des exemplaires publiÃĐs chaque jour avant la guerre, atteint 27% dÃĻs la LibÃĐration, au dÃĐtriment de la presse radicale-socialiste (qui chute de 14 à 2%) et de la presse d’information gÃĐnÃĐrale (de 42 à 15%).
En avril 1947, la presse communiste tient le haut du pavÃĐ Ã Paris : 450 000 exemplaires pour l’HumanitÃĐ le matin, devant Le Figaro (399 000 exemplaires), Franc-Tireur, Le Parisien LibÃĐrÃĐ, l’Aurore, LibÃĐration, Combat, L’Ordre, etc.; et 448 000 exemplaires le soir pour Ce soir, aprÃĻs France-Soir (578 000 exemplaires) et Paris-Presse, et devant L’Intransigeant, Le Monde (174 000 exemplaires) et La Croix (161 500 exemplaires). Toutefois, le destin de Ce soir symbolise le dÃĐclin idÃĐologique qui suit l’aprÃĻs-guerre et, peut-Être, la lassitude devant les grÃĻves à rÃĐpÃĐtition : le quotidien communiste du soir ne vend plus que 215 000 exemplaires en janvier 1950, et 120 000 dÃĐbut 1953, annÃĐe oÃđ il cesse de paraÃŪtre en mars. C’est au dÃĐbut de notre pÃĐriode que naissent ou renaissent trois grands quotidiens qui ont toujours pignon sur rue : Le Figaro, crÃĐÃĐ par des chansonniers du XIXÃĻme siÃĻcle en 1826, suspendu en 1942, reparaÃŪt le 23 aoÃŧt 1944 en pleine libÃĐration de Paris; le premier numÃĐro de France-Soir, fondÃĐ par Pierre Lazareff, paraÃŪt le 8 novembre 1944. Enfin Le Monde, fondÃĐ par Hubert Beuve-MÃĐry, dont le premier numÃĐro, paru la veille, est datÃĐ du 19 dÃĐcembre 1944.
Des magazines ÃĐclosent alors, toujours cÃĐlÃĻbres : Marie-France en novembre 1944, concurrent de Marie-Claire (de 1937), Elle en novembre 1945, Le Canard enchaÃŪnÃĐ (1916) rÃĐÃĐditÃĐ sous sa forme actuelle en 1946, Match (de 1928) reparaÃŪt en mars 1949 sous le titre Paris-Match, L’Observateur en avril 1950, L’Express en mai 1953, supplÃĐment du journal ÃĐconomique Les Ãchos, qui a la bonne idÃĐe de publier dans son premier numÃĐro un entretien avec Pierre MendÃĻs France, bientÃīt PrÃĐsident du Conseil.
Pour les jeunes aussi la pÃĐriode est fÃĐconde : ÂŦ entre le 1er mai 1946 et dÃĐcembre 1949, trente-trois journaux [pour la jeunesse] sortent, dont Fillette, Bernadette, La Semaine de Suzette, Coeurs vaillants, Lisette, Pierrot, Bayard et Ãmes vaillantes[28] Âŧ. La transformation du journal communiste le Jeune patriote en Vaillant en juillet 1946 provoque la colÃĻre des « cathos » qui rÃĐclament la reparution de Coeurs vaillants. Tintin (1946 en Belgique, 1948 en France) concurrent de Spirou (nÃĐ en 1936, hebdo en 1946), est nÃĐanmoins son alliÃĐ contre le Journal de Mickey (nÃĐ en 1934) dont l’influence marchande croÃŪt à proportion de la prÃĐsence amÃĐricaine en Europe. Les lois et dÃĐcrets du 16 juillet 1949 sur la presse enfantine allait juguler cette efflorescence sauvage dont beaucoup jugeait qu’elle risquait de menacer la morale enfantine et juvÃĐnile.
La publication des livres aussi reprend. L’ÃĐvÃĐnement majeur reste l’invention du livre de poche en 1953. ÂŦ La France, qui aime les livres, ÃĐtait en retard[29] Âŧ sur ce point par rapport à ses voisins britanniques et ses ÂŦ amis Âŧ amÃĐricains. Pourtant, elle avait des prÃĐcÃĐdents et, pour rester dans notre pÃĐriode, par exemple la collection ÂŦ Que sais-je ? Âŧ, crÃĐÃĐe par Paul Angoulvent en 1941. Il fallait du neuf. C’est Henri Filipacchi, ÂŦ aventurier du siÃĻcle nouveau[30] Âŧ, crÃĐateur de la BibliothÃĻque de la PlÃĐiade chez Gallimard, qui crÃĐe le Livre de poche, dont les trois premiers titres, Koenigsmark de Pierre BenoÃŪt (un best-seller des annÃĐes 20), Les clÃĐs du royaume d’A.-J. Cronin et Vol de nuit d’Antoine de Saint-ExupÃĐry, paraissent en librairie le 9 fÃĐvrier 1953. Il seront bientÃīt suivis par des titres de Colette, Malraux, CÃĐline, Steinbeck, etc. Les livres, vendus 150 F de l’ÃĐpoque (environ 20 F d’aujourd’hui), rencontrent un succÃĻs immÃĐdiat : les tirages de 60 000 exemplaires sont rapidement ÃĐpuisÃĐs, et de quatre titres mensuels, le Livre de poche passe bientÃīt à huit (puis à douze en 1962). Une telle production sur tant d’annÃĐes n’est possible que parce que Filipacchi rÃĐunit sous un mÊme sigle les ÃĐditeurs Plon, Gallimard, Albin Michel, Laffont, Calmann-LÃĐvy, Julliard, DenoÃŦl, Fasquelle et Grasset, puis, plus tard, Stock et Fayard, disposant ainsi d’une richese littÃĐraire et intellectuelle, française et ÃĐtrangÃĻre, inouÃŊe et cÃĐdÃĐe à bas prix.
I. L’automobile
Les Français se convertissent à la ÂŦ civilisation roulante Âŧ (Jean-Pierre Rioux). En 1939, le parc automobile est de 2,4 millions de vÃĐhicules, dont 1,9 million de voitures particuliÃĻres. En 1945, il ne comprend plus que 910 000 de vÃĐhicules, dont 680 000 voitures particuliÃĻres. La production reprend. Le parc des vÃĐhicules à moteur (toutes catÃĐgories) passe de 910 000 en 1945 à 4,3 millions en 1955, dont les voitures particuliÃĻres, de 680 000 à 2,8 millions (soit 21% des mÃĐnages).
Cette montÃĐe en puissance de l’automobile rÃĐsulte de l’ingÃĐniositÃĐ d’industriels français qui, depuis plusieurs annÃĐes, cherchent à fabriquer des TPV, des toutes petites voitures. Pierre Lefaucheux, PDG de Renault, met au point la 4 CV, clou du Salon de 1946. Il dÃĐclare : ÂŦ il faut que disparaisse cette notion vraiment pÃĐrimÃĐe de l’automobile objet de luxe restant l’apanage des privilÃĐgiÃĐs de la fortune. L’exemple de l’AmÃĐrique est là pour nous montrer que l’automobile doit se dÃĐmocratiser. Il faut des automobiles pour faire de notre pays, et pour le plus grand nombre possible de ses habitants, une terre oÃđ il fasse à nouveau bon vivre Âŧ. La 100 000ÃĻme 4 CV est livrÃĐe en janvier 1950, la 500 000ÃĻme en avril 1954, chiffre jamais atteint par une voiture de sÃĐrie en France (produite jusqu’en juillet 1961, la derniÃĻre porte le numÃĐro 1 105 500[31]).
Le 7 octobre 1948, ÂŦ sous le regard stupÃĐfait d’un parterre d’officiels et du PrÃĐsident Vincent Auriol, la 2 CV CitroÃŦn est prÃĐsentÃĐe au public du Salon[32] Âŧ. Pierre-Jules Boulanger, son concepteur voulait, dÃĻs 1936, ÂŦ une chaise longue sous un parapluie (dans laquelle) une fermiÃĻre puisse traverser un champ sans casser un seul oeuf de son panier Âŧ. Cette boÃŪte de conserve – disent aimablement des journalistes amÃĐricains dâalors – de 495 kg mesurant 3,78 m avec une cylindrÃĐe ridicule de 375 cmÂģ, au prix imbattable de 185 000 F d’alors (environ 25 000 F d’aujourd’hui), sÃĐduisit les campagnes, le clergÃĐ, les ÃĐtudiants (fabriquÃĐe jusqu’en juillet 1991; 5 millions d’exemplaires). ÂŦ PhÃĐnomÃĻne de sociÃĐtÃĐ et phÃĐnomÃĻne industriel, la 2 CV allait rejoindre, au PanthÃĐon de l’automobile et de l’industrie, les mythiques Ford T, Traction Avant et autres Coccinelles Volkswagen, mais aussi la machine à coudre Singer, le Frigidaire, et le VÃĐlosolex Âŧ – lequel fut prÃĐsentÃĐ au Salon du Cycle pour la premiÃĻre fois ÃĐgalement en 1948.
L’industrie automobile est trÃĻs active. La dÃĐcennie connaÃŪt la naissance de la belle 203 Peugeot (1947) suivie de la 403 (1955), de la FrÃĐgate Renault (1951), grosse berline concurrente malchanceuse des belles amÃĐricaines, les Dyna Panhard à partir de 1945. Le dernier Salon de notre pÃĐriode, en 1955, est le plus symbolique de tous et ouvre une ÃĻre nouvelle. Le 6 octobre, les visiteurs ÃĐbahis dÃĐcouvrent la rÃĐvolutionnaire DS 19 de CitroÃŦn. Avec sa silhouette de batracien accroupi, son toÃŪt en plastique, son volant à un seul rayon, la DS ne ressemble à aucune autre voiture. Elle symbolise l’ÃĻre nouvelle des voitures sÃŧres et ÃĐconomes, dont l’esthÃĐtique se soumet humblement au coefficient de pÃĐnÃĐtration dans l’air. Le contraste avec d’autres logiques automobiles, massives et dispendieuses, est d’autant plus saisissant qu’au mÊme Salon les visiteurs peuvent contempler les gÃĐantes amÃĐricaines, la Lincoln Mark III et, surtout, la Cadillac Eldorado (2,5 tonnes et 5,5 mÃĻtres de long), qui allait Être, peinte en rose, l’une des premiÃĻres voitures du futur jeune dieu Elvis Presley, grand amateur de la marque (il en achÃĻtera cent au cours de sa fulgurante carriÃĻre). Mais le Français moyen, quoique jaloux et envieux, se mÃĐfiera toujours des ÂŦ grosses amÃĐricaines Âŧ croqueuses de diamants, et leur prÃĐfÃĐrera les petites cylindrÃĐes, adaptÃĐes aux chemins de campagne, ou les limousines familiales, puritaines, confortables et ÃĐconomes.
Conclusion
1945 – 1955 : la pÃĐriode s’ouvre avec Les Temps modernes de Sartre, et les funÃĐrailles nationales de Paul ValÃĐry, en juillet 1945, et se clÃīt avec L’ÃĻre du soupçon de Nathalie Sarraute, Le voyeur d’Alain Robbe-Grillet, Le marteau sans maÃŪtre de Pierre Boulez, MÃĐtastasis de Iannis Xenakis et les funÃĐrailles nationales de Paul Claudel en fÃĐvrier 1955 à Notre-Dame de Paris (ÂŦ J’aurais ÃĐtÃĐ bouleversÃĐ s’il avait fait moins froid Âŧ, persifle Mauriac dans son Bloc-Notes). En mourant en 1955, Arthur Honegger ne passe-t-il pas le flambeau au jeune Boulez ? Et Pierre Teilhard de Chardin, qui meurt lui aussi en 1955 à New-York, le jour de PÃĒques, ne laisse-t-il pas place aux structuralistes ? De ValÃĐry à Robbe-Grillet, de Sartre à Sarraute, de Teilhard à LÃĐvi-Strauss et Barthes, que de titres rÃĐels, ou possibles… On pourrait dire, tout autant : de la BibliothÃĻque de la PlÃĐiade au Livre de poche, de la 4 CV à la DS 19, de Cendrillon à la Nouvelle vague, du jazz au rock, ou encore du 78 tours au microsillon.
Dans un avenir proche, les grands ensembles vont dÃĐferler, avec les grandes surfaces, les loisirs de masse, et, par-dessus tout, la tÃĐlÃĐvision, qui va profiter de la prochaine dÃĐcennie pour multiplier sa prÃĐsence par vingt-cinq (de 260 000 postes fin 1955 à 6,5 millions dÃĐbut 1966, oÃđ elle est prÃĐsente dans plus de 40% des mÃĐnages). Alors, 1945-1955 ? C’est l’ÃĐpoque des grands changements, oÃđ le Français moyen achÃĻve de dÃĐchausser les sabots de 1930 hÃĐritÃĐs de 1890 en les rangeant dans les recoins des souvenirs futurs, et enfourche sa Mobylette toute neuve (au « y » ÃĐtymologiquement incongru, comme une croix sur le passÃĐ) pour des petits matins dont on lui a dit qu’on y chanterait à jamais…
Pierre MAYOL (mars 1996)
DÃĐpartement des ÃĐtudes et de la prospective, MinistÃĻre de la Culture.
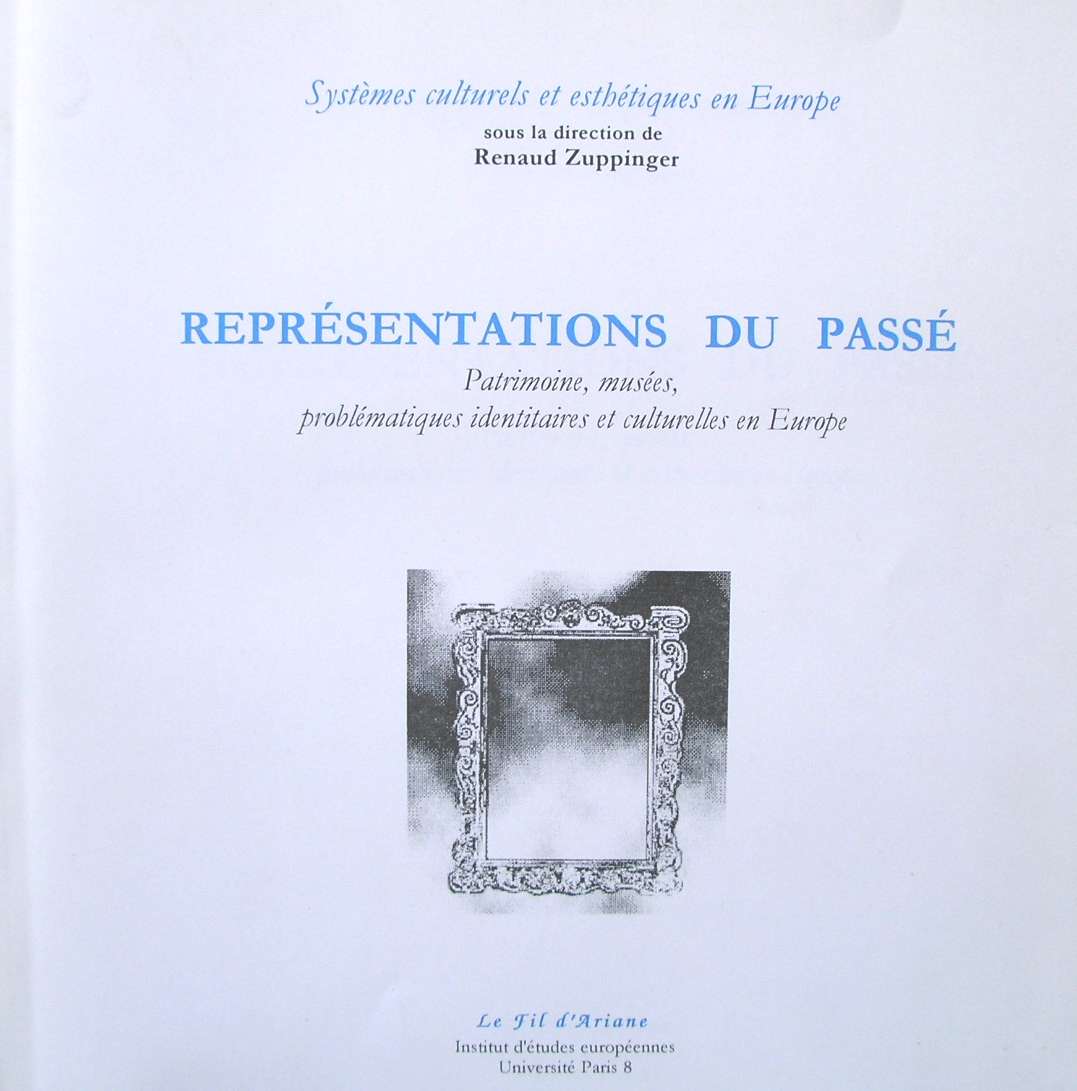

 mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-
mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ
-