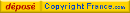Jean-Marc BEDECARRAX
Influence des modes de prรฉsentation en musรฉographie sur les formes de la modernitรฉ artistique.
La question de l’inventio en art est de celles qui, depuis toujours, fascine et intrigue. Comment naรฎt l’idรฉe artistique ? Peut-on dรฉcrire une hypothรฉtique alchimie de l’inspiration ?
Une phรฉnomรฉnologie de l’acte crรฉateur est-elle possible ? ร cette catรฉgorie de questions, la tradition romantique impose un silence religieux. Pour Kant, l’inspiration renvoie ร la thรฉorie du gรฉnie et ainsi se prive de la possibilitรฉ du concept : ยซ le crรฉateur d’un produit qu’il doit ร son gรฉnie, ne sait pas lui-mรชme comment se trouvent en lui les idรฉes qui s’y rapportent ยป.[1]
Pourtant, sans prรฉtendre opรฉrer une plongรฉe au cลur mรชme de l’ineffable de la crรฉation, dont la sanctuarisation me semble devoir รชtre maintenue contre les dangers d’un rรฉductionnisme nรฉopositiviste, un nombre non nรฉgligeable de dรฉterminations de l’ลuvre d’art nous reste nรฉanmoins accessible. Parmi celles-ci, cette รฉtude se propose de mettre en รฉvidence celles qui ont prรฉsidรฉ ร la constitution des formes de la modernitรฉ artistique.
Comment de telles formes ont-elles pu voir le jour ?
Par l’entremise de quelles procรฉdures d’invention se sont-elles rรฉvรฉlรฉes ?
Comment expliquer le privilรจge accordรฉ ร certains choix plastiques comme, par exemple, la planรฉitรฉ ou les ready-made ?
Autant de questions auxquelles il conviendrait de rรฉpondre et dont le rรฉsultat fournira en retour des รฉlรฉments prรฉcieux pour une meilleure comprรฉhension des formes plastiques de la modernitรฉ, qui restent aujourd’hui encore ร dรฉterminer.
Le chimiste allemand August Kekule rapporte dans ses comptes rendus[2]
la maniรจre dont, un soir de 1865, l’idรฉe lui vint en observant un feu de cheminรฉe de reprรฉsenter la structure molรฉculaire du benzรจne par un anneau hexagonal. Alors qu’il รฉtait plongรฉ dans une rรชverie, une des flammes forma un anneau, suscitant chez lui, par un simple jeu d’analogie formelle, le jaillissement d’une idรฉe. On n’en peut conclure pour autant que l’invention rรฉsulte de la seule divagation formelle de l’esprit. Elle prรฉsuppose, cela va sans dire, une conjonction de paramรจtres : conditions techniques, รฉpistรฉmologiques, sociales, etc. Cette anecdote confirme cependant l’existence d’un aspect non nรฉgligeable du phรฉnomรจne : la transposition entre domaines de validitรฉ hรฉtรฉrogรจnes.
L’hypothรจse que j’aimerais ici รฉprouver s’inspire directement d’un tel mรฉcanisme. Elle postule l’existence d’un lien direct entre les modes de prรฉsentation des ลuvres dans les musรฉes et les formes de la modernitรฉ artistique, ceci dans la seconde moitiรฉ du XIXรจme siรจcle et au tournant du XXรจme. Pour audacieuse qu’elle paraisse, elle s’appuie nรฉanmoins sur un faisceau d’รฉlรฉments convergents et ne semble pas contredite par les faits. Je m’efforcerai ici d’en prรฉsenter et en dรฉcrypter le fonctionnement.
L’รฉtat de prรฉsentation des ลuvres dans les musรฉes du XIXรจme nous est bien connu. L’accrochage dit ยซ en tapisserie ยป, encore visible aujourd’hui dans certains musรฉes, [3]
y domine largement. Les tableaux sont accrochรฉs bord ร bord de maniรจre ร occuper la totalitรฉ de la surface verticale disponible. L’examen de la documentation iconographique sur le sujet confirme ce phรฉnomรจne, qui semble ne souffrir que de rares exceptions. Afin nรฉanmoins de complรฉter ces informations nรฉcessairement partielles, nous nous sommes livrรฉ ร une รฉtude des archives du Ministรจre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, celui-ci ayant procรฉdรฉ entre 1878 et 1914 ร une inspection systรฉmatique de l’ensemble des musรฉes des Beaux-Arts de province.[4] Les rapports d’inspection et la correspondance entre l’administration centrale et les musรฉes confirment, mais surtout prรฉcisent, la dimension quasi obsessionnelle des procรฉdures d’accrochage.
Ainsi Arthur Baigniรจres, un des trois inspecteurs nommรฉs en 1878, dรฉclare-t-il concernant le Musรฉe d’Orlรฉans : Il faudra loger les toiles nouvelles, et la place manque. Beaucoup dรฉjร n’ont pu รชtre accrochรฉes au mur, et dans le grand salon une rangรฉe supplรฉmentaire repose sur le sol[5]. ร Autun, en 1887, c’est l’inspecteur lui-mรชme qui prรฉconise des remaniements [qui] permettraient de recevoir dans ce musรฉe encore quelques toiles de faibles dimensions attendu que toutes les parois importantes sont occupรฉes [ . . . ]. La surface disponible serait d’environ 50 m2 [6].Tandis qu’ร Auxonne, l’inspecteur signale ร ses supรฉrieurs que le musรฉe ยซ pourra recevoir encore quelques toiles ne dรฉpassant pas 3,40 m de hauteur ยป.[7] Administration centrale et musรฉes de province semblent donc collaborer ร la rรฉalisation d’un mรชme objectif : l’optimisation complรจte des surfaces d’accrochage. La profusion qui rรจgne dans les musรฉes ne relรจve en rien d’une quelconque contingence musรฉographique, produit d’une sรฉdimentation mรฉcanique et incontrรดlรฉe ร l’intรฉrieur de locaux exigus et inadaptรฉs. Elle rรฉpond, bien au contraire, ร un programme dรฉlibรฉrรฉment รฉtabli et, de surcroรฎt, parfaitement rationalisรฉ : les surfaces sont quantifiรฉes, les espaces rรฉamรฉnagรฉs ร cet effet.
Comment expliquer alors une telle volontรฉ, un tel ยซ abus de l’espace ยป[8]
pour reprendre l’expression de Paul Valรฉry ? La question centrale qui organise l’essentiel de l’activitรฉ des musรฉes ร cette รฉpoque est celle de la richesse des collections. Celle de l’ostentation en est le corollaire. Les musรฉes disposent principalement d’une double source d’enrichissement : les dรฉpรดts de l’รtat et le produit de l’รฉvergรฉtisme local. Susciter un don passe nรฉcessairement par une politique d’exposition afin d’assurer les donateurs potentiels qu’un tel sort sera effectivement rรฉservรฉ ร leurs ลuvres. Aussi les rรฉserves, souvent qualifiรฉes de ยซ dรฉbarras ยป, sont-elles frappรฉes d’infamie, les conservateurs allant jusqu’ร en nier l’existence.[9]
En 1905, le Projet de rรฉsolution de Fernand Engerand pose bien en ces termes le problรจme de l’exposition :
Il conviendrait de faire entrer โ au besoin de force โ cette idรฉe dans la tรชte des conservateurs que tous les tableaux de leurs collections doivent รชtre exposรฉs, leur mรฉrite ne doit que dรฉterminer leur emplacement. Si les tableaux sont envoyรฉs par l’รtat, les municipalitรฉs sont tenues lรฉgalement de les exposer ; c’est une obligation morale s’ils ont รฉtรฉ donnรฉs par des particuliers, le fait de l’acceptation implique la promesse de l’exposition.[10]
Quelles sont maintenant les consรฉquences,[11] du point de vue esthรฉtique et formel, d’un tel mรฉcanisme socio-institutionnel ? Les ลuvres se trouvent subsumรฉes ร l’intรฉrieur d’un ensemble plus vaste : le musรฉe. Elles sont proprement instrumentalisรฉes. Nous tenterons maintenant de montrer comment, dรจs lors, ร l’intรฉrieur de la catรฉgorie ยซ musรฉe ยป s’opรจre un lรฉger et imperceptible dรฉplacement sรฉmantique. Le musรฉe en tant que nouvelle unitรฉ pertinente, devient lui-mรชme une ลuvre d’art, fonctionnant ร la maniรจre d’une ยซ hyper-ลuvre ยป.
John Ruskin, dans un article[12] visionnaire et admirable de luciditรฉ, dรฉnonรงait dรฉjร en 1852 ce procรจs d’instrumentalisation. Dรฉplorant le mode d’accrochage en tapisserie pratiquรฉ par le Musรฉe du Louvre, dans lequel ยซ le meilleur Tintoret de ce cรดtรฉ-ci des Alpes รฉtait accrochรฉ ร plus de dix-huit mรจtres de hauteur ! ยป, Ruskin propose de replacer chacune des ลuvres ยซ on the level with the eye ยป. Il en perรงoit pourtant clairement les consรฉquences : ยซ je rรฉalise รฉgalement tout ร fait que le coup d’ลil[13] de la galerie ne survivra pas ร un tel amรฉnagement. Mais les grands chef-d’ลuvres ne doivent pas รชtre l’objet d’un « coup d’ลil » ยป. Autrement dit, ils mรฉritent mieux que d’รชtre sacrifiรฉs ร la seule vision d’ensemble.
Pour saisir au plus prรจs la dimension esthรฉtique du phรฉnomรจne, il faut s’imaginer โ car c’est ainsi que les choses se passent โ le conservateur devant sa cimaise vierge, disposant d’un stock dรฉterminรฉ d’ลuvres d’art et s’apprรชtant ร composer un ensemble, tant cohรฉrent scientifiquement, conforme aux contraintes institutionnelles et sociales, qu’agrรฉable ร la vue, au dire mรชme des conservateurs. Ceux-ci se dรฉfendent pourtant de sacrifier, au profit de l’ensemble, l’individualitรฉ des ลuvres ยซ dont chacune exige, sans l’obtenir, l’inexistence de toutes les autres ยป.[14] Ainsi, B. Passepont, conservateur du Musรฉe d’Auxerre, dรฉclare en 1872 :
Nous avons, au contraire, essayรฉ par un placement rรฉflรฉchi, d’รฉviter ร chacune d’elles un malencontreux voisinage dans lequel elles pourraient se nuire mutuellement par la discordance des couleurs et cherchรฉ ร faire valoir autant que possible toutes leurs qualitรฉs par l’harmonie des effets.[15]
En pensant, de bonne foi, surmonter la contradiction de la partie et du tout, B. Passepont ne parvient en rรฉalitรฉ qu’ร en attรฉnuer les effets, et ainsi, d’une certaine maniรจre, ร en nier l’existence. Pour ce faire, il procรจde implicitement ร l’introduction d’un troisiรจme terme : le paradigme de la liaison. Chaque tableau s’intรจgre certes ร l’ensemble mais non en tant que monade irrรฉductible, en tant qu’ลuvre-transit, traversรฉe par un flux colorรฉ circulant d’une ลuvre ร l’autre sans rupture majeure. ร rechercher cette trame ยซ harmonieuse ยป assurant le liant gรฉnรฉral, le conservateur ne fait en rรฉalitรฉ que trahir sa volontรฉ de constituer un ensemble homogรจne, esthรฉtiquement et formellement cohรฉrent.
Cette attention particuliรจre accordรฉe au tout trouve au Musรฉe de Toulouse son expression la plus achevรฉe. Dans un rapport de 1873 sur l’รฉtat du musรฉe, le conservateur M. George dรฉcrit avec prรฉcision les principes qui ont prรฉsidรฉ ร l’amรฉnagement de la Grande Galerie dont il est l’auteur. ร travers la description dรฉtaillรฉe qu’il donne de son travail d’agencement des tonalitรฉs, le conservateur nous apparaรฎt sous la figure d’un artiste qui, disposant d’une palette de couleurs, se livrerait ร un vรฉritable exercice de composition. Insistant sur la dimension empirique de son travail, celui-ci se veut moins musรฉologue que musรฉographe :
Pour parvenir ร ce rรฉsultat et opรฉrer avec mรฉthode, on comprend qu’il faut รชtre en prรฉsence (des ลuvres)[16].
Rappelons, pour justifier la mรฉtaphore du musรฉographe en artiste, qu’ร cette รฉpoque, les conservateurs sont, pour l’immense majoritรฉ d’entre eux, des peintres, la crรฉation de l’รcole du Louvre n’intervenant qu’en 1882 afin de remรฉdier justement ร ce problรจme.
M. George, en reprenant le paradigme de la liaison, va composer ici un ensemble suivant l’axe paradigmatique fade / brillant et sa projection sur l’axe syntagmatique. L’enchaรฎnement tonal, tout en respectant le dรฉcoupage traditionnel en รฉcoles, s’organise linรฉairement de la faรงon suivante : Flamands fades / Flamands brilยญlants / Italiens / Franรงais ayant travaillรฉ en Italie / Franรงais aux tonalitรฉs vives / Franรงais de l’รฉcole moderne.
Entre deux รฉcoles, le passage se veut le plus progressif possible, รฉvitant absolument toute rupture trop brutale. Les peintres flamands, par exemple, sont disposรฉs ร cรดtรฉ des Italiens en commenรงant par les plus fades de coloris. [ . . . ] parmi ceux-ci, on choisirait les plus brillants en coloris pour servir de transition aux deux รฉcole[17].
La question de la continuitรฉ est omniprรฉsente :[ . . . ] leurs coloris s’harmoniseraient le mieux entre eux [ . . . ] qu’ils se relient sans contraste[18].
L’ensemble forme ainsi un tout homogรจne, servi admirablement par un harmonieux dรฉgradรฉ de masses colorรฉes.
Ce travail de composition se dรฉploie suivant une double direction : le versant chromatique dont nous venons d’examiner le traitement, et son pendant graphique, reproduisant en cela la distinction traditionnelle entre couleur et dessin. La dimension graphique de la composition s’organise autour essentiellement du principe de symรฉtrie :
La symรฉtrie dans une exposition flatte toujours les regards et plaรฎt gรฉnรฉralement aux amateurs ; on l’observera tant qu’elle ne nuira pas aux tableaux parce qu’elle rattache les objets ร un centre d’unitรฉ et qu’elle contribue par consรฉquent ร faire saisir d’un seul coup d’ลil un ensemble grandiose[19].
Cette analyse des procรฉdures de composition nous rend mieux ร mรชme de saisir les enjeux esthรฉtiques du mode d’accrochage dominant de cette seconde moitiรฉ du XIXรจme. Prise ร l’intรฉrieur de logiques multiples, qui lui sont pour la plupart รฉtrangรจres, la peinture se trouve en quelque sorte niรฉe en tant qu’autonomie. Le mode de prรฉsentation affecte l’ลuvre au cลur mรชme de son identitรฉ. Il en modifie jusqu’ร la perception de ses qualitรฉs plastiques. L’ลuvre est rรฉifiรฉe, rabaissรฉe au rang de tache colorรฉe, ce qu’encore une fois Ruskin avait parfaitement perรงu lorsqu’il dรฉfinissait le musรฉe, suivant la conception populaire, comme ยซ un palais somptueux dรฉcorรฉ de panneaux colorรฉs ยป.[20]
La situation est donc la suivante : des musรฉographes, d’un cรดtรฉ, qui empiรจtent ostensiblement en dehors de leur juridiction et, de l’autre, des artistes qui ont toutes les raisons de dรฉnoncer une pareille intrusion mais qui, paradoxalement, en reprendront ร leur compte les consรฉquences formelles. Comment expliquer un tel phรฉnomรจne en apparence contradictoire ? On aura compris que ce qui se joue ici dรฉpasse largement la simple transposition formelle, comme nous le laissions entendre en dรฉbutant cet article. Ce qui s’ouvre sous nos yeux, c’est bien plus profondรฉment un drame au sens รฉtymologique du terme, rรฉunissant deux protagonistes que nous venons clairement d’identifier, et gravitant autour d’un mรชme problรจme, celui de la performativitรฉ de l’art. En poussant ainsi la logique musรฉale ร l’extrรชme, la musรฉographie semble avoir ouvert une crise sans prรฉcรฉdent ร l’intรฉrieur mรชme de l’art, et l’invention de la modernitรฉ pourrait trรจs bien n’en reprรฉsenter qu’un simple รฉpisode.
Le XIXรจme est le siรจcle de la montรฉe en puissance de l’institution musรฉale. Ce phรฉnomรจne est le rรฉsultat d’une laรฏcisation du processus de l’art. Avec l’avรจnement du musรฉe, la sociรฉtรฉ se dote d’une instance d’รฉvaluation, certes faillible et perfectible mais nรฉanmoins, et cela mรฉrite d’รชtre pris au sรฉrieux, รฉmanation de la souverainetรฉ populaire. Ainsi, et jusqu’ร preuve du contraire, la critique conservant un droit de citรฉ, tout ce qui est se trouve exposรฉ ร l’intรฉrieur d’un musรฉe peut รชtre considรฉrรฉ comme รฉtant l’รฉmanation du beau. La sentence du juge, une fois prononcรฉe, fait force de loi. Il en va de mรชme concernant l’exposition. Que ses dรฉcisions – verdict et jugement esthรฉtique – puissent ultรฉrieurement faire l’objet d’une rรฉvision, ne change rien. Le conservateur, au mรชme titre que le juge, est investi par la souverainetรฉ populaire – ou positivement ou par dรฉfautโ - d’un pouvoir de dire le beau : c’est trรจs exactement, au sens austinien du terme, un pouvoir de performativitรฉ.
Cependant, cette version du performativisme admet encore la possibilitรฉ d’une rรฉgulation extรฉrieure en maintenant une rรฉfรฉrence ร la catรฉgorie transcendante du beau. Le dire du musรฉe n’est pas encore un faire : le musรฉe dit la valeur artistique mais ne la fait pas. On est en prรฉsence ici d’une version affadie ou non achevรฉe du performativisme en matiรจre d’art. Ou, pour le dire autrement, le musรฉe peut bien instituer la valeur d’une ลuvre, mais uniquement sa valeur sociale, en aucun cas sa valeur absolue.
Mais les choses changent du tout au tout dรจs lors que le musรฉe se prรฉsente lui-mรชme comme ลuvre, ainsi que nous venons de le montrer dans notre premiรจre partie. Il transforme de la sorte son dire en un faire et bascule d’une performativitรฉ faible vers une performativitรฉ forte ou radicale. C’est cette prรฉtention que trahit irrรฉvocablement l’accrochage en tapisserie.
En niant l’ลuvre dans sa matรฉrialitรฉ propre, le musรฉe s’en prend ร ce qui constituait son dernier refuge contre une dรฉsontologisation de l’art et sa transformation en simple acte de langage. Sur la cimaise, l’ลuvre devient signe d’elle-mรชme, signe de l’art. Articulรฉe ensuite aux autres ลuvres, elle n’incarne plus qu’une fonction morphologique ร l’intรฉrieur de l’รฉnoncรฉ gรฉnรฉral, simple morphรจme du continuum culturel. Le musรฉe, en tant qu’ลuvre globale, tend ร identifier l’art ร la culture. L’art ainsi est niรฉ. Il est simplement signifiรฉ par la prรฉsence des ลuvres qui le reprรฉsentent mais qui ne le portent pas directement. Il est transformรฉ en catรฉgorie de pensรฉe.
Quelle sera dรจs lors la rรฉaction des artistes ร cette situation ? Celle-ci prendra principalement deux formes distinctes mais complรฉmentaires. Le premier geste de l’artiste consiste en une appropriation du pouvoir de performativitรฉ de l’institution. Il tente d’imposer et de lui substituer une performativitรฉ de l’artiste. Le ready-made se prรฉsente dรจs lors comme la reproduction du geste du musรฉographe. ร l’intรฉrieur du dispositif musรฉo-graphique, l’objet fonctionne comme ยซ objet-pigment ยป. En simulant ce geste, l’artiste rรฉvรจle, sur le mode parodique, le fonctionnement de l’institution. Mais, plus profondรฉment, il modifie dans l’intervalle le sens du procรจs de performativitรฉ lui-mรชme dont nous avons vu qu’il tendait ร transformer l’art en simple artifice langagier. Si le geste de Marcel Duchamp opรจre lui aussi ร l’intรฉrieur du champ social et des catรฉgories sรฉmantiques qui s’y dรฉveloppent, ร la diffรฉrence du musรฉographe, il ambitionne de replacer au cลur du processus langagier la question du sens et de la rรฉalitรฉ humaine. La catรฉgorie de la performativitรฉ ne se rรฉduit plus ร la simple mise en branle d’un processus autonome de codification gรฉnรฉralisรฉe. Elle est problรฉmatisรฉe : devant un geste aussi abrupt et radical que le ready-made, nous sommes tenus de nous interroger sur la signification mรชme du pouvoir de performer et de son origine. En transformant le performatif en matรฉriau artistique, Duchamp lui confรจre une รฉpaisseur : il postule une rรฉalitรฉ de l’homme dans la sociรฉtรฉ.
La seconde forme que prendra la rรฉponse des artistes ร l’autonomisation du procรจs musรฉographique comme faire artistique, se dรฉveloppe cette fois ร l’intรฉrieur du champ pictural. Elle consiste ร rรฉintroduire une opacitรฉ de la peinture, une รฉpaisseur de la reprรฉsentation, en sorte que celle-ci renvoie de maniรจre immanente ร elle-mรชme et ร sa matรฉrialitรฉ propre dont nous avons vu qu’elle รฉtait niรฉe. L’ลuvre abandonne dรฉlibรฉrรฉment la transparence picturale de la perspective afin de bien signifier qu’elle ne signifie justement plus. Ou, pour le dire autrement, signifier que signifiant et signifiรฉ sont indissolublement liรฉs. C’est dans cette identification que consiste l’apport dรฉcisif de la modernitรฉ artistique. L’ลuvre n’est plus mรฉdiation mais position et autonomie.
En reprenant le geste du musรฉographe, l’artiste en modifie fondamentalement la signification. Le musรฉographe en produisant la planรฉitรฉ des ลuvres les rendait de la sorte รฉquivalentes et, ainsi, substituables les unes aux autres dans la grande chaรฎne syntagmatique de la culture, la catรฉgorie ยซ art ยป n’รฉtant conservรฉe que comme sous-ensemble de la culture. L’artiste en assumant la bidimensionnalitรฉ de la peinture affirme, pour sa part, la singularitรฉ absolue de chacune d’entre elles.
Pour bien comprendre la situation telle qu’elle se prรฉsentait avant l’intervention des artistes, il faut se reprรฉsenter un espace musรฉographique qui s’organisait autour de deux grands axes : l’axe de la profondeur reprรฉsentant l’axe synchronique de l’art se manifestant d’une part et, d’autre part, l’axe du plan, celui diachronique de la culture se dรฉployant. Le musรฉographe pouvait alors sans peine articuler l’un sur l’autre et intรฉgrer tout naturellement l’art ร la culture comme deux temporalitรฉs distinctes se complรฉtant mutuellement. L’abstraction en rabattant, sur un mode conflictuel, les deux axes l’un sur l’autre, rend cette articulation problรฉmatique. Le peintre moderne rรฉinvestit la dimension du plan,[21] celle de la cimaise, qu’il avait jusque-lร dรฉlaissรฉe, occupรฉ qu’il รฉtait depuis plusieurs siรจcles ร travailler la question de la profondeur. Il introduit, ce faisant, ร l’intรฉrieur de la linรฉaritรฉ diachronique, une fragmentation irrรฉductible. On comprend mieux dรจs lors l’inconvenance qu’il y aurait ร exposer ensemble des peintures monochromes suivant le mode d’accrochage en tapisserie : le conflit apparaรฎtrait de faรงon trop รฉvidente entre des modes de spatialisation par trop similaires, ลuvres et cimaise se disputant le mรชme plan.[22]
Le geste de la modernitรฉ artistique ne pose en rรฉalitรฉ pas pour impossible une articulation entre art et culture. Il en propose simplement une modalitรฉ diffรฉrente. Tout se passe en effet comme si l’ลuvre abstraite reproduisait en miniature l’hyper-ลuvre musรฉe[23] dont nous avons fait apparaรฎtre, dans notre premiรจre partie, les caractรฉristiques formelles, coloristes et non figuratives. Si une telle signification se confirmait, le geste de la modernitรฉ reviendrait ร inverser le rapport de force et rabattre cette fois la culture sur l’art : chaque ลuvre dans son occurrence singuliรจre et punctiforme constituerait en soi un condensรฉ de la culture, chacun de ses pigments renvoyant mรฉtaphoriquement ร un รฉlรฉment de la culture. On retrouve ici la question de l’unitรฉ de la culture, mais unitรฉ rรฉalisรฉe cette fois au prix d’un effort remarquable et sans cesse ร renouveler : l’ลuvre comme fait social.
La reconstitution du scรฉnario de la modernitรฉ nous aura donc permis de retrouver la double dรฉtermination de l’art selon Theodor Adorno : l’art comme autonomie et comme fait social.[24] Ceci nous amรจne ร formuler l’hypothรจse suivante : l’art moderne ne s’est-il pas fondamentalement constituรฉ dans et par son rapport ร l’institution musรฉale ? Nous nous sommes limitรฉ ร prรฉsenter ici simplement l’aspect inaugural et formel de ce lien. Cette รฉtude s’inscrit cependant ร l’intรฉrieur d’un ensemble plus vaste de recherches sur l’articulation entre musรฉologie et esthรฉtique. Des รฉtudes comme celles menรฉes par Jean-Louis Dรฉotte sur le musรฉe comme origine de l’esthรฉtique et site de l’art,[25]
ou Oskar Bรคtschmann sur l’artiste d’exposition et le musรฉe comme destination,[26]
indiquent admirablement, bien que suivant des orientations diffรฉrentes, la fรฉconditรฉ d’un tel axe de recherche.
Au terme de ce parcours, nous sommes en droit de nous interroger sur la destinรฉe d’une telle fondation. Si l’art moderne s’est constituรฉ dans une opposition fondamentale ร l’omnipotente figure du musรฉe, comment expliquer dรจs lors leur rรฉcente lune de miel ? Ne nous mรฉprenons pas, celle-ci s’est faite au prix, pour le musรฉe, d’un extraordinaire effort d’adaptation de ses procรฉdures d’accrochage, et ร la faveur d’un contexte socio-รฉconomique tout ร fait exceptionnel dont nous percevons aujourd’hui les effets d’un renversement. Ceux qui prรฉdisent une disparition de l’art moderne ne semblent pas rรฉaliser que celle-ci ne se fera qu’au prix d’un changement de paradigme du musรฉe comme destination. Mais au profit de quel nouveau paradigme : les collections privรฉes, les nouveaux mรฉdias, la spรฉculation ? On a pu mesurer dans les annรฉes quatre-vingts les effets d’un assujettissement des musรฉes au marchรฉ de l’art. Les arts plastiques s’en relรจvent aujourd’hui difficilement.
Jean-Marc BEDECARRAX
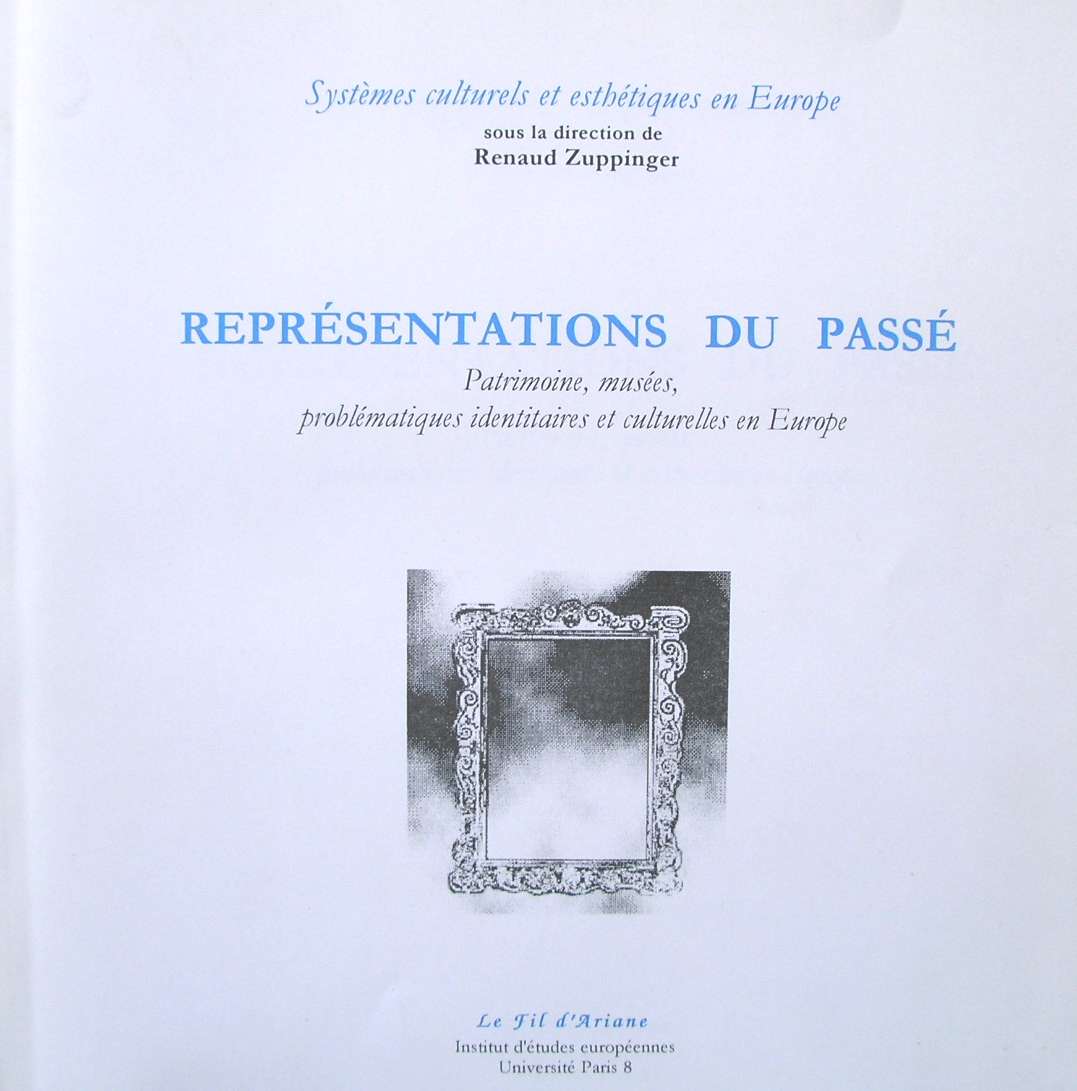

 mythe-imaginaire-sociรฉtรฉ
-
mythe-imaginaire-sociรฉtรฉ
-