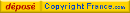Annette GEIGER
Faut-il dรฉfinir le musรฉe d’aprรจs son objet d’exposition ou sa maniรจre d’exposer ?
(La fonction du discours sur le statut scientifique de la musรฉologie 1960 – 1990)
ยซ La musรฉologie nโexiste pas, mais elle a une histoire ยป – ce constat paradoxal a รฉtรฉ formulรฉ par Martin Schรคrer lors dโun colloque sur les musรฉes et la recherche, ร la fin de lโannรฉe 1993[1]. Il touche au cลur du problรจme suivant : musรฉoยญlogie, museology, muzeologie, Museumskunde, musรฉographie etc, dans toutes les langues europรฉennes, il existe, depuis le dรฉbut du siรจcle, plusieurs vocables de ce type ; pourtant, aucune dรฉfinition cohรฉrente et valable pour tous ces mots nโa surgi pour en fixer le sens. La musรฉologie peut ainsi รชtre comprise comme lโรฉtude de la collection du musรฉe, du travail pratique dans le musรฉe, dโune thรฉorie du musรฉe, de lโhistoire du musรฉe etc. Chaque groupe de ยซmusรฉologuesยป semble, de fait, avoir sa notion spรฉcifique. Cette diversitรฉ des concepts de musรฉologie empรชche jusquโร nos jours son ยซexistenceยป en tant que discipline clairement dรฉlimitรฉe. La seule distinction qui paraisse sโaffirmer, est celle qui est faite entre la musรฉographie, relevant des aspects pratiques du travail musรฉal (lโaccrochage, lโรฉclairage, lโarchitecture etc.), et la musรฉologie, en tant que partie thรฉorique, voire philosophique, reflรฉtant le phรฉnomรจne de la musรฉalisation en soi. Et malgrรฉ lโinsuffisance de cette dรฉfinition, la musรฉologie ne cesse de rรฉclamer le statut dโune science autonome. La revendication dโun statut de science autonome pour la musรฉologie ne cesse pas de rรฉapparaรฎtre. Lโidรฉe en a รฉtรฉ formulรฉe pour la premiรจre fois ร la fin des annรฉes 60 et elle continue de trouver des dรฉfenseurs aujourdโhui encore.
Bien quโon puisse รชtre opposรฉ ร cette revendication, force est de reconnaรฎtre quโune discussion, aussi assidue, doit avoir une certaine fonction pour la conception de nos musรฉes et que ce dรฉbat – quand on le lit entre les lignes – est le signe dโun changement nรฉcessaire au sein de lโรฉpistรฉmologie musรฉale, sans que, pour autant, lโon puisse encore prรฉciser lequel ?
Lโanalyse que je voudrais prรฉsenter dans cet article part de lโhypothรจse quโil existe une relation entre lโรฉtat de dรฉfinition de la musรฉologie et le concept du musรฉe, notamment en ce qui concerne le classement des diffรฉrents types de musรฉes (art, histoire, ethnologie, sciences et techniques etc.).
Dans une premiรจre partie, sans vouloir prendre la position de lโarbitre dans ce dรฉbat, ni vouloir proposer ร mon tour une autre dรฉfinition de ce quโest la musรฉologie, je tenterai de rรฉsumer lโรฉvolution de ce discours. (Toutefois, une รฉtude historique exhaustive dรฉpasserait de beaucoup les enjeux de cette question. Il mโapparaรฎt plus utile de dรฉfinir certains indicateurs reprรฉsentatifs qui permettent de retracer les grandes lignes de ce dรฉbat.)
Depuis la fondation de lโICOM (International Council of Museums) en 1946, les professionnels du monde entier se rencontrent tous les trois ans lors de la confรฉrence gรฉnรฉrale de cette institution. La sรฉlection des interventions thรฉmatiques me semble donner une image assez fidรจle des prรฉoccupations principales dโune รฉpoque, sans privilรฉgier aucune ยซรฉcoleยป particuliรจre de musรฉologie. Un travail dโanalyse de ces documents nโa jusquโร prรฉsent pas รฉtรฉ รฉtabli. Seuls certains musรฉologues ont tentรฉ de prรฉsenter une histoire de leur mouvement. Il est รฉvident que ces articles sont ร รฉtudier avec prudence : leur version de lโhistoire de la musรฉologie est toujours celle dโune victoire…[2]
Le discours officiel des annรฉes 60 jusquโau dรฉbut des annรฉes 90 se caractรฉrise, ร mon sens, beaucoup moins par la prรฉoccupation de fonder une vraie science de la musรฉologie – je considรจre cette prรฉtention plutรดt comme un prรฉtexte (probablement inconscient) – que par deux types de rรฉflexions qui nous plongent au cลur du problรจme :
- celle de formuler une dรฉontologie de la profession du musรฉe,
- celle de lรฉgitimer le musรฉe dโaujourdโhui comme institution dont la mission serait รฉpistรฉmologique vis-ร -vis de la sociรฉtรฉ. Nous verrons ce quโil faut entendre par lร .
A. La dรฉfinition du musรฉe dans les annรฉes 60 :
De lโรฉlargissement quantitatif ร lโenjeu qualitatif.
Parmi les documents accessibles sur cette dรฉcennie, trois ouvrages consacrรฉs aux confรฉrences organisรฉes par lโICOM en 1962, 1965 et 1968. Une รฉtude comparative montre que la question du statut scientifique des musรฉes sโest posรฉe pour la premiรจre fois lors dโun colloque officiel en 1965, sur le thรจme de la formation du personnel des musรฉes. En 1968, ce thรจme a รฉtรฉ repris sous un angle plus large : ยซ musรฉe et recherche ยป, qui mettait en question, de maniรจre plus gรฉnรฉrale, le droit du musรฉe ร se lรฉgitimer comme institution scientifique.
Le terme de ยซmusรฉologieยป – mรชme sโil est dรฉjร utilisรฉ dans certains articles – ne figure pas encore dans les titres, les mots clรฉ du dรฉbat tournant autour des notions de formation, de recherche et de science. Somme toute, on cherchait ร savoir quelle รฉtait la diffรฉrence entre la recherche au musรฉe et celles des autres institutions de recherche – pas question de dรฉfinir une science propre, nous sommes encore loin dโun tel esprit et dโune telle confiance en soi …
En 1962, lors dโune confรฉrence internationale organisรฉe par le comitรฉ suisse de lโICOM, la dรฉfinition du musรฉe, donnรฉe dans les rรฉsolutions 3 et 4, ne manifeste qu’une faible prรฉoccupation par rapport au sรฉrieux scientifique de cette institution. Lโaspect scientifique nโest alors quโun critรจre parmi dโautres :
Art.3 :
Icom shall recognize as a museum any permanent institution which conserves and displays, for purpose of study, education and enjoyment, collections of objects of cultural or scientific significance.
Art. 4 :
Within this definition fall :
(a) exhibition galleries permanently maintained by public libraries and collections of archives,
(b) historical monuments…
(c) botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, and other institutions which display living specimens,
(d) natural reserves.[3]
La dรฉfinition est non seulement trรจs souple par rapport aux lieux dโexposition acceptรฉs comme musรฉes, mais elle ne prescrit ร aucun moment quโun musรฉe – ainsi que nous le considรฉrons comme essentiel aujourdโhui – se distingue dโun parc dโattraction ou dโautres maniรจres de prรฉsenter des objets, par une certaine rigueur dans le classement de ses objets. Le critรจre principal est alors quโon y collectionne des objets, ce qui ne veut tout dโabord rien dire de plus quโon les stocke !
En effet, en 1962 – le titre du colloque lโannonce : ยซ The problems of museums in countries undergoing rapid change ยป – le souci principal รฉtait dโintรฉgrer les musรฉes du monde entier dans cette organisation, lโICOM, afin de constituer un rรฉseau de communication et dโรฉchange entre eux.
Now the whole question must be taken up systematically as element of a general policy of international co-operation in favour of museums in developing countries[4].
Il va de soi quโune telle politique de coopรฉration internationale ne peut sโorganiser, en un premier temps, sur une dรฉfinition restrictive du musรฉe.
En 1965, lors de la 7รจme confรฉrence gรฉnรฉrale de lโICOM, les intervenants se rendent compte que lโinstitution du musรฉe a connu une forte diffรฉrenciation, sous la pression de la multiplicitรฉ des types de musรฉe et la spรฉcification de leurs fonctions. Par rapport ร ces nouveaux enjeux se pose alors la question de savoir comment former un personnel qualifiรฉ. Aprรจs lโรฉlargissement quantitatif envisagรฉ dans lโinternationalisation du mouvement, il sโagit maintenant dโobtenir un niveau de qualitรฉ valable pour tous et adaptรฉ ร cette diffรฉrenciation des fonctions :
Le maintien dโun niveau scientifique le plus รฉlevรฉ possible est alors compatible avec le dรฉveloppement parallรจle des activitรฉs de conservation, de prรฉsentation et dโaction culturelle dont les techniques ont considรฉrablement รฉvoluรฉ depuis vingt ans et nโautorisent plus le maintien de la notion du โconservateur ร tout faireโ. (A.B. de Vries)[5].
รtre conservateur de musรฉe รฉtait jusque lร un ยซ mรฉtier bourgeois ยป (Jean Chatlain). Sans formation spรฉcifique, le conservateur รฉtait en gรฉnรฉral collectionneur et amateur lui-mรชme, son expรฉrience dans la matiรจre รฉtait formรฉe par sa classe sociale et le goรปt qui en dรฉcoulait. Il est รฉvident que le musรฉe moderne a dรฉsormais besoin dโun autre type de spรฉcialiste. En consรฉquence, la rรฉsolution finale de cette 7รจme confรฉrence gรฉnรฉrale de lโICOM prescrit, pour la premiรจre fois, que le conservateur doit recevoir une formation universiยญtaire correspondant ร son domaine de travail. Cela implique non seulement une garantie de qualiยญfication, mais permet la dรฉmocratisation de la profession, qui, ainsi, ne sera plus rรฉservรฉe ร un petit cercle de la sociรฉtรฉ.
En 1968, lors de la 8รจme confรฉrence gรฉnรฉrale de lโICOM, lโancienne dรฉfinition du musรฉe comme lieu oรน sont rรฉunis des objets dโune maniรจre ou dโune autre, sโavรจre insuffisante. La rรฉsolution finale explique :
Au XIXรจme siรจcle, le musรฉe devait avant tout amasser et conserver les objets. Aujourdโhui, le musรฉe sโefforce de plus en plus dโรฉtudier les collections, et les moyens de les mettre au service de la sociรฉtรฉ ainsi que leur augmentation systรฉmatique dรฉcoulent des rรฉsultats de leur examen scientifique [6].
Or il ne suffit pas de dรฉcrรฉter ce statut ยซ scientifique ยป : parmi les autres institutions de recherche, le musรฉe doit tenir un rรดle spรฉcifique, quโaucune autre institution ne peut tenir ร sa place :
Mais il est probablement nรฉcessaire de se demander aujourdโhui comment le travail de recherche doit รชtre menรฉ dans un musรฉe et quels sont les problรจmes scientifiques qui doivent รชtre traitรฉs surtout au musรฉe ou exclusivement au musรฉe. (W.Schรคfer, Francfort)[7]
Cette spรฉcificitรฉ du musรฉe qui le distingue de toutes les autres institutions a, dโaprรจs ces auteurs, deux origines :
1. Le musรฉe communique son message ร travers ses objets.
2. Le musรฉe communique son message ร travers le classement de ces mรชmes objets.
Ces deux constats, aussi รฉvidents quโils puissent paraรฎtre, constituent les premiรจres interยญrogations sur les consรฉquences รฉpistรฉmologiques de la dรฉfinition du musรฉe : comment un objet peut-il avoir de la valeur informative ?
Une premiรจre explication et fournie par son intรฉgration ร lโintรฉrieur dโun classement, ce qui explique les raison pour lesquelles la standardisation mondiale dโun mode particulier de classement est devenue une prรฉoccupation importante de cette รฉpoque :
Par consรฉquent, plus une collection est โtransparenteโ et plus elle est susceptible de devenir un outil universel, utilisable dans le monde entier. Lโaccessibilitรฉ, la transparence indispensable dโune collection ne peut รชtre rรฉalisรฉe que par le catalogue. [ . . . ] Pour que les musรฉes, en tant quโinstitutions scientifiques, puissent remplir leur rรดle, il faut que soient rรฉalisรฉes toutes les exigences mentionnรฉes plus haut : description correcte, identification correcte, catalogue critique.
(W.Schรคfer, Francfort)[8]
Schรคfer voit bien le dilemme qui en dรฉcoule : lโobjet exposรฉ est en vรฉritรฉ trop insignifiant pour illustrer les rรฉsultats de la recherche effectuรฉe ร son sujet, mais, en mรชme temps, le musรฉe ne peut lโabandonner sans perdre sa spรฉcificitรฉ.
Lโancienne ยซ doctrine de lโobjet ยป (Schรคfer), cโest-ร -dire lโhabitude datant de la fin du XIXรจme siรจcle dโexposer lโobjet seul, afin que lโรฉpanouisยญsement de son caractรจre noble et admirable ne soit en rien dรฉrangรฉ, est jugรฉe insuffisante et illusoire par rapport aux nouveaux objectifs de communication. Lโeffet dโinformation ne passe plus, dans cette prรฉsentation ยซ neutre ยป et sans commentaire, auprรจs du public dโaujourdโhui. Dโoรน la demande de Jan Jelinek :
It will no longer suffice, for our collections to concentrate on unique objects : we must present, as far as possible, a complete picture[9].
Rรฉsumons : la mise en question du statut scientifique des musรฉes est nรฉe dโune interrogation sur les possibilitรฉs de faire communiquer les objets. Cette ยซ double injonction ยป : science et/ou communication, va caractรฉriser, tout en demeurant la source principale de nombreux malentendus et confusions, le discours sur la musรฉologie et son statut scientifique jusquโร nos jours. Quelle solution propose-t-on en 1968 ? Confrontรฉe ร un flou dโinterprรฉtation autour de lโobjet exposรฉ, lโintรฉgration de ce dernier dans un contexte plus complexe paraรฎt le moyen adรฉquat pour augmenter la prรฉcision de sa signification. La rรฉsolution finale regrette par exemple que :
[ . . . ] certains conservateurs [fassent] toujours une diffรฉrence entre les objets โoriginauxโ appartenant aux collections proprement dites et le reste quโils estiment secondaire en le dรฉsignant comme โmatรฉriaux auxiliairesโ. La documentation musรฉale est toujours classรฉe parmi ces matรฉriaux de moindre importance[10].
Lโexposition musรฉale est dรฉsormais censรฉe sโouvrir aux nombreux objets de documentation tels que : ยซ descriptifs, comptes rendus des expรฉditions et des missions, matรฉriaux iconographiques et photographiques, films et bandes magnรฉtiques… ยป, qui, par leur appartenance ร dโautres familles mรฉdiatiques, ne peuvent รชtre classรฉs et prรฉsentรฉs de la mรชme maniรจre. Reconnaissant leur valeur, on souhaite quโils soient intรฉgrรฉs dans la recherche musรฉale, bien que surgisse le risque que les modes de classement habituels du musรฉe ne sโy retrouvent plus ; il faut donc, en consรฉquence, les modifier. Lโouverture, dโabord quantitative, puis qualitative, reste cependant ยซpositivisteยป : il existe des classements possibles pour tout genre dโobjet ! Le problรจme philosophique sous-jacent ne se pose pas encore.
Parallรจlement ร ce discours officiel sur les consรฉquences pratiques et conceptuelles liรฉes aux nouvelles conditions de travail dans les musรฉes, des chercheurs universitaires, en Europe de lโEst, ont poursuivi la question de lโobjet et de sa valeur communicative jusquโร atteindre un niveau de rรฉflexion philosophique. Parmi les fondateurs de cette ยซรฉcoleยป qui, trรจs vite, va se former autour du concept de musรฉologieยป, nous trouvons notamment les chercheurs tchรจques Jan Jelinek (Brno), Zbynek Stransky (Brno) et Jiri Neustupny (Prague). Dรจs 1968 (donc avec une avance considรฉrable par rapport aux pays occidentaux !), on cherche ici ร dรฉfinir une musรฉologie en tant que science :
Recently a number of works have been devoted not only to museology proper but also to the problem whether it is a scientific discipline or not. In considering this problem we must be aware of the fact the recent development of research have given rise to many new marginal or interdisciplinary sciences, so that we are often at a loss whether to speak of a new discipline or about the combination and application of several already established disciplines in a new line of research. [ . . . ] It is not yet certain whether such formations of mixed or composite character are real scientific disciplines[11].
Discipline autonome ou travail thรฉorique interdisciplinaire ? En effet, toute la problรฉmatique qui va occuper les esprits ร lโOuest, mais beaucoup plus tard, est dรฉjร formulรฉe ici. Sans vouloir spรฉculer sur les raisons de cette avance, il est tout de mรชme intรฉressant de constater que la musรฉologie รฉtait avant tout censรฉe formuler la prรฉgnance de la thรฉorie, et aussi, vraisemblablement de lโidรฉologie sur la pratique : il fallait dโabord formuler ยซla relation de lโhomme ร la rรฉalitรฉยป (Stransky) avant dโinterprรฉter la rรฉalitรฉ des objets. Par-delร toutes ses implications politiques, cette construction est intรฉressante, et nous allons voir dans les annรฉes 80 – rรฉsultat dโun vide รฉpistรฉmologique plus que dโun trop plein dโidรฉologie – le mouvement occidental de la ยซ Nouvelle musรฉologie ยป rallier cette idรฉe.
B. Lโenjeu principal des annรฉes 70 : nouveaux publics – nouveaux objets ?
La premiรจre confรฉrence gรฉnรฉrale de lโICOM, aprรจs les รฉvรฉnements de 1968 qui, รฉvidemment, concernent aussi le musรฉe, a eu lieu en 1971. En effet, les consรฉquences รฉtaient importantes : il nโest plus question de la maniรจre dont la recherche musรฉale doit รชtre menรฉe, lโintรฉrรชt de celle-ci pour le public la remet en question. Au lieu de rรฉflรฉchir sur le sรฉrieux et la spรฉcificitรฉ de son travail scientifique, le musรฉe est alors pris dans un discours tout autre : la conquรชte de tous les publics, le non-public (ceux qui nโy vont jamais) inclus. Lโinterrogation principale reste pourtant la mรชme : quโest-ce que lโobjet peut exprimer pour celui qui le regarde ? Dans les annรฉes 60, on croyait obtenir une signification plus exacte et plus comprรฉhensible ร travers la mise en contexte de lโobjet ; dans les annรฉes 70, on se rend compte quโil faut procรฉder de maniรจre radicale : il faut aussi exposer dโautres objets.
Lโinterface avec le public, donc la pratique elle-mรชme, va dรฉsormais dicter aux sciences ce quโest un sujet actuel. LโlCOM demande dans sa conclusion, ร la communautรฉ des musรฉes :
Dโentreprendre avec lโaide de lโICOM un programme de recherche et dโรฉtudes systรฉmatiques basรฉes sur les rรฉsultats obtenus et de mettre au point des moyens dโaction qui, dans lโavenir, permettront aux musรฉes de remplir plus efficacement leur rรดle รฉducatif et culturel au service de lโhumanitรฉ[12].
La problรฉmatique qui sโy rรฉvรจle constitue une vรฉritable rรฉvolution pour la dรฉfinition du musรฉe : le musรฉe ne doit plus seulement obรฉir ร un savoir scientifique sur le passรฉ, il doit correspondre ร la sociรฉtรฉ contemporaine en rรฉpondant ร ses besoins de savoir.
Et les premiers musรฉologues ont dรฉjร rรฉagi : ils prรฉsentent une multitude de nouveaux types de musรฉe conรงus pour rรฉpondre ร ces critรจres, tels que le musรฉe dโidentitรฉ rรฉgionale[[13], le musรฉobus qui va au-devant du public, le ยซ museo integrale ยป en Amรฉrique latine et le ยซ neighbourhood-museum ยป en Amรฉrique du Nord. Cโest surtout ce dernier, concevant des expositions thรฉmatiques sur les sujets qui concernent directement les problรจmes de la population ciblรฉe[14], qui a fortement impressionnรฉ lโรฉpoque, jusquโร nos jours oรน il figure parmi les exemples les plus citรฉs. Lโensemble de ces nouveaux types de musรฉe sera regroupรฉ plus tard sous la notion de ยซmusรฉe communautaireยป. Face ร un tel enthousiasme dโinvention et de crรฉation concernant la ยซ pratique ยป musรฉale, le dรฉbat sur une science de la musรฉologie finit par disparaรฎtre des colloques. En effet, les deux confรฉrences gรฉnรฉrales suivantes de 1977 et 1980 nโรฉvoquent plus ce thรจme, en tout cas pas dans les rapports officiels publiรฉs par lโUnesco ร chaque occasion.
A cรดtรฉ de cela, une autre prรฉoccupation constitue dรฉsormais le souci principal des confรฉrences gรฉnรฉrales de lโICOM : le sauvetage du patrimoine mondial, la nรฉcessitรฉ dโune protection internationale par rapport ร une ยซ insuffisance รฉthique ยป (sic !) au niveau des Etats. Les pays du tiers monde notamment se voient pillรฉs de leurs biens culturels pour satisfaire les envies des collectionneurs des pays industrialisรฉs. Dans le discours officiel lโยซ รฉthique du patrimoine ยป, dans son sens commercial, devient le nouveau thรจme ร la mode. Cependant – comme je lโavais mentionnรฉ dans lโintroduction – le rapport officiel ne donne pas toujours une image reprรฉsentative de la multitude des opinions et positions, notamment lorsque des sous-groupes se forment…
En 1977, par exemple, lโICOFOM (Comitรฉ international pour la musรฉologie) est crรฉรฉ afin de poursuivre le dรฉbat de la musรฉologie au niveau international. Sa premiรจre publication autonome date de 1978, faisant suite ร un colloque en Pologne, et deux numรฉros seulement intitulรฉe ยซ Museological Working Papers ยป suivront. Il nโest sans doute pas exagรฉrรฉ de dire que le comitรฉ a รฉtรฉ fondรฉ pour sauver la question du rรดle scientifique du musรฉe contre les รฉducateurs et les pรฉdagogues… Aprรจs cela, la question du musรฉe comme phรฉnomรจne รฉpistรฉmologique conserve-t-elle ses chances dโรชtre sรฉrieusement posรฉe ? Les rรฉsultats de ce colloque ressemblent plutรดt ร un recommencement ร partir de zรฉro : les tentatives de dรฉfinition et de lรฉgitimation sโenchaรฎnent… Vers le dรฉbut des annรฉes 80 commence ainsi une pรฉriode de crise pour lโICOFOM. Vinos Sofka rรฉsume rรฉtrospectivement leur situation de lโรฉpoque dans un article de 1988 :
Schon im Jahre 1978 wurde auf der Tagung in Polen die Frage nach dem Daseinszweck gestellt : Was ist unser Ziel, wozu dient das Komitee ? Und was ist eigentlich Museologie ? Die Antworten der Mitglieder variierten in betrรคchtlichem Maรe. Daher wurde der Beschluss gefaรt, die Untersuchung von Inhalt und Grundlagen der Museologie zum Hauptprogramm des Komitees zu machen [ . . . ] Doch zeigte sich bald, daร es mit Deklarationen allein nicht sein Bewenden haben konnte. So kam es in den Jahren 1980 – 1982 zur Krise : verringertes Interesse an dem Komitee und seiner Arbeit, keine Tagung im Jahre 1981[15].
C. Les annรฉes 80 : Dรฉfinir la musรฉologie ou dรฉfinir le musรฉe ?
Aprรจs cette crise grave de la ยซ musรฉologie ยป qui dura jusquโau milieu des annรฉes 80, de nouveaux acteurs vont apparaรฎtre sur la scรจne, ร lโoccasion du retour dโun discours typiquement ยซ occidental ยป. Ou, autrement dit, les รฉducateurs et les pรฉdagogues redeviennent musรฉologues. Cependant, leur objectif provient dโune motivation tout autre…
En 1982 sโest crรฉรฉ en France le mouvement ยซ Musรฉologie Nouvelle Expรฉrimentation Sociale ยป MNES. En 1984, les Quรฉbรฉcois le rejoignent en fondant le Mouvement International pour une nouvelle musรฉologie (Minom), qui sera le forum des musรฉologues ยซ rรฉformรฉs ยป du monde entier. Minom est officiellement reconnu comme organisation associรฉe de lโICOM, en 1986. Entre-temps lโexpansion mondiale du nouveau type de ยซ musรฉe communautaire ยป aura รฉtรฉ importante.
Mais ces dates ne sont ร comprendre que comme le moment dโacceptation large du mouvement de la nouvelle musรฉologie. Lโidรฉe dโun musรฉe alternatif et ses premiรจres rรฉalisations sont beaucoup plus anciennes. Dans les annรฉes 1940-50, lโethnologue Georges-Henri Riviรจre avait imaginรฉ un type de musรฉe qui prรฉsentait une image interdisciplinaire de lโhomme dans son environnement. La crรฉation du musรฉe de Bretagne peut รชtre identifiรฉ comme le premier exemple rรฉalisรฉ, suivi de la fondation de nombreux parcs naturels dans les annรฉes 60. En 1971, Hugues de Varine invente le terme ยซ Ecomusรฉe ยป qui se trouve aussitรดt rรฉutilisรฉ et ainsi lรฉgitimรฉ lors de la confรฉrence gรฉnรฉrale. En 1971-72, le premier Ecomusรฉe franรงais, le ยซ Musรฉe de lโHomme et de lโIndustrie : Ecomusรฉe de la Communautรฉ urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines ยป est fondรฉ.
Ce concept dโEcomusรฉe va dominer le dรฉbat ร partir du milieu des annรฉes 80. Avant dโen analyser les consรฉquences, sa dรฉfinition sera rappelรฉe : il sโagit de proposer des possibilitรฉs dโidentification ร travers une prรฉsentation, รฉlaborรฉe ร lโaide des mรฉthodes les plus interdisciplinaires. LโEcomusรฉe sโoppose ร la stratรฉgie musรฉale traditionelle en ce quโelle ne procรจde pas ร des sรฉlections, ainsi que le signale Andrea Hauenschild, rรฉsumant trรจs ร propos son caractรจre totalitaire :
- la collection est la totalitรฉ de lโhรฉritage ;
- le ยซbรขtimentยป est la totalitรฉ du territoire ;
- le public est la totalitรฉ de la population[16].
Nous laisserons de cรดtรฉ la question de savoir si lโEcomusรฉe est censรฉ se substituer au musรฉe traditionnel ou sโil nโest que la proposition dโune alternative supplรฉmentaire. (La rรฉalitรฉ a fini par confirmer cette derniรจre hypothรจse.) Ce qui nous intรฉresse ici, ce sont plutรดt les rรฉflexions philosophiques dรฉclenchรฉes par ce mouvement. Reste ร noter que le vรฉritable enjeu รฉpistรฉmologique du musรฉe a รฉtรฉ dรฉcouvert par ces ยซ praticiens ยป et quโil nโest pas le fruit des recherches musรฉologiques de lโICOFOM…
Je discernerai deux prรฉoccupations principales qui, par la suite, domineront les colloques et les publications :
1. Quโest ce que le langage du musรฉe ? Musรฉologues et chercheurs universitaires se rรฉunissent afin de formuler, ร lโaide des thรฉories de la communication, une approche pour le musรฉe. (Cf. par exemple Duncan Cameron, Bernard Deloche, Susan Pearce et dโautres)
2. Comment peut-on sโidentifier ร son patrimoine ? Le problรจme est souvent formulรฉ dans la contradiction entre ยซmusรฉgliseยป et ยซmusรฉcoleยป, ou dans lโhypothรจse de la ยซmort de lโobjetยป, cโest-ร -dire la perte de sa force communicative, par le fait de son isolement ou de sa sacralisation. Le philosophe Bernard Deloche rรฉsume le problรจme du musรฉe dans le paradoxe suivant :
La musรฉologie actuelle rรฉsulte toute entiรจre de la paradoxale dualitรฉ de la culture humaniste : 1) รtendre le pouvoir de lโhomme sur les choses par lโextension et la transmission dโun savoir (musรฉcole = transmission dโune culture) ; 2) Isoler et fรฉtichiser en intemporalisant (musรฉglise = valorisation exorbitante de cette culture)[17].
Les musรฉologues savent maintenant que la ยซmort de lโobjetยป nโest pas un problรจme de collection de ยซfauxยป objets (comprรฉhensible uniquement pour une รฉlite par exemple), comme on le croyait naรฏvement dans les annรฉes 70. Le simple fait de ยซmusรฉaliserยป lโobjet est ร lโorigine de sa ยซmortยป – aussi grand que puisse รชtre lโeffort pรฉdagogique. Cette vision nรฉgative va dรฉsormais trouver sa place permanente dans les rรฉflexions musรฉologiques.
Si, vers la fin des annรฉes 80, la musรฉologie sโest enfin imposรฉe comme un รฉlรฉment omniprรฉsent dans le discours officiel, ce nโest point parce quโon a enfin rรฉussi ร la dรฉfinir, au contraire, le concept semble plus flou que jamais, mais grรขce au succรจs (dans la pratique !) du tout nouveau ยซEcomusรฉeยป.
Il est dรฉsormais souhaitรฉ que le musรฉe sโouvre, se remette en question, voire sโรฉloigne de la notion de culture traditionelle. La rรฉsolution finale de la confรฉrence gรฉnรฉrale de lโICOM, en 1989, finit par rรฉclamer lโauto-critique :
Questions have been rightly put regarding the concept of culture that was used. Whose culture and what culture is generated by museums ? And on whose authority ? Are museums not rather culture-corroborating institutions, and should they not take more trouble for explicit mobilization of opposition by permanently and scrupulously considering and criticizing their own Weltanschauung ? [ . . . ] A closer look at the readiness of musums to expand collection exchange and to try out its practical possibilities seems to offer them the chance for a deeper insight into their own collections and subsequent reinterpretation. In this way museums comment on the idea of โtheโ culture and clarifiy its definition[18].
Comment lโinterprรฉter autrement que : la musรฉologie est devenue un instrument pour rรฉflรฉchir non plus sur ce quโest la science du musรฉe, mais sur ce que ยซ culture ยป veut dire ! Elle doit combler le vide รฉpistรฉmologique qui sโest rรฉvรฉlรฉ ร force de remise en question de lโidรฉe traditionelle de culture. Ce problรจme se pose encore plus radicalement dans les annรฉes 90 : cโest la dรฉfinition du musรฉe mรชme qui entre en crise. Eilean Hooper-Greenhill, chercheur en ยซ museums studies ยป ร lโuniversitรฉ de Leicester, ouvre son ouvrage, ยซ Museums and the Shaping of Knowledge ยป sur le constat que rien nโest moins assurรฉ que la fonction du musรฉe dans la sociรฉtรฉ :
The fixed view of the identity of museums has sometimes been firmly held and, until recently, little has disturbed it. But it is a mistake to assume that there is only one form of reality for museums, only one fixed mode of operating. [ . . . ] What does โknowingโ in museums mean ? What counts as knowledge in the museum ? Or to put it another way, what is the basis of rationality in the museum ? What is acceptable and what is regarded as ridiculous, and why ? [ . . . ] How are individuals constructed as subjects ? What is the relationship of space, time, subject, and object ? And, perhaps the question that subsumes all the others, how are โmuseumsโ constructed as objects ? Or, what counts as a museum[19]?
En conclusion :
Le fait que la musรฉologie nโait gagnรฉ dโadhรฉrents quโร partir du moment oรน lโon a cessรฉ de vouloir la dรฉfinir, cโest-ร -dire vers la fin des annรฉes 80, permet sans doute dโaffirmer que lโidรฉe de son statut comme science nโa fonctionnรฉ quโen tant que prรฉtexte. Sa fonction (ce dรฉbat nโรฉtait pas vain) dans le milieu professionnel semblait plutรดt destinรฉe ร contrebalancer le dรฉclin de la dรฉfinition du musรฉe, pour ouvrir des perspectives malgrรฉ cette insรฉcuritรฉ nouvelle provoquรฉe par la question du rรดle du musรฉe dans la sociรฉtรฉ, comme institution du savoir – mais de quel savoir ? et pour qui ?
Dans les annรฉes 60, le discours รฉtait encore double : il sโagissait dโabord de formuler une dรฉontologie de la profession du musรฉe. Les analyses le montrent : lorsque les types de musรฉes se diffรฉrencient et se spรฉcifient, la question de la formation du personnel surgit aussitรดt. La standardisation et la normalisation dโun savoir commun devrait permettre ensuite lโexclusion du non-professionnel. (Ainsi les formations universitaires se sont-elles multipliรฉes partout dans le monde[20].) Cette fermeture du mรฉtier dโun cรดtรฉ, permit des ouvertures importantes de lโautre : dโabord lโintรฉgration de tous les musรฉes du monde dans le mรชme systรจme musรฉal (inaugurรฉe avec la fondation de lโOffice international des musรฉes en 1926 et reprise en 1946 avec la crรฉation de lโICOM) et puis la prolifรฉration des types de musรฉe. On profite dโun savoir gรฉnรฉralisรฉ et ยซ sรปr ยป pour sโavancer dans de nouveaux domaines qui nโont pas encore รฉtรฉ musรฉalisรฉs.
Venons-en donc ร la deuxiรจme problรฉmatique qui est au fond de ce dรฉbat : la mission du musรฉe dans la sociรฉtรฉ. En 1968, la question se pose encore de la maniรจre suivante : quelle est la spรฉcificitรฉ du musรฉe par rapport aux autres institutions de recherche ? Une comparaison avec la recherche scientifique dans les universitรฉs sโimpose. La demande dโun statut scientifique pour la musรฉologie est รฉvidemment issue de cette mรชme comparaison. Mais cโest ร ce moment que se produit la faute de pensรฉe dans la rรฉflexion des musรฉologues : au lieu de rechercher ce qui constitue la diffรฉrence entre recherche scientifique et musรฉale, ils ont cherchรฉ ร ranger la musรฉologie parmi les disciplines scientifiques. Logiquement, ceci ne pourrait fonder ni la spรฉcificitรฉ ni la lรฉgitimitรฉ de la musรฉologie dans la sociรฉtรฉ. (Une institution a une mission spรฉcifique dans la sociรฉtรฉ lorsquโelle est irremplaรงable par tous les autres organismes de ce type !)
Le sociologue Niklas Luhmann dรฉcrit un tel processus de diffรฉrenciation ร lโaide de codes spรฉcifiques ร chacun des systรจmes. Il dรฉcrit le systรจme des sciences comme un systรจme qui classe sa ยซrรฉalitรฉยป, donc les descriptions faites de son objet de recherche, ร lโaide du code ยซvraiยป / ยซfauxยป. Or ce code peut-il รชtre valable pour le musรฉe ? Il est รฉvident que non. Le musรฉe cherche ร intรฉresser son spectateur uniquement ร des choses ยซvraiesยป : elles peuvent รฉtonner, surprendre, รชtre belles, admirables ou rendre nostalgique…, on ne pose certainement pas la question de savoir si elles sont ยซfaussesยป! Aujourdโhui, on ne peut mรชme plus dire quโun objet doit รชtre plus particuliรจrement ยซtypiqueยป de son รฉpoque pour rentrer au musรฉe. Il peut รชtre tout ร fait rare et exceptionnel (un chef-dโลuvre artistique par exemple) ou รชtre lโobjet le plus commun de notre civilisation (LโEcomusรฉe veut effectivement ยซtoutยป conserver). En tout cas, il sโagit lร de critรจres qui ne sont certainement pas valables dans les sciences…
Si le musรฉe va ยซ mal ยป aujourdโhui, sโil a donc besoin dโun discours ยซ musรฉologique ยป de lรฉgitimation en plus de son propre discours que sont ses expositions, un nouvel ordre semble nรฉcessaire, qui rende compte des diffรฉrenciations du passรฉ – celle avec les sciences est rรฉcente, dโautres, comme celle avec la religion par exemple, sont รฉvidentes depuis longtemps (cf. les รฉtudes de K. Pomian).
Comment interprรฉter lโEcomusรฉe et son intention de supprimer tout ordre de sรฉlection fixรฉ a priori, pour travailler de maniรจre radicalement ยซinterdisciplinaireยป, autrement que comme une attaque contre lโancien classement des musรฉes dโaprรจs leurs objets collectionnรฉs ?
Une telle distinction des types de musรฉe correspond – et je ne crois guรจre exagรฉrer en รฉtablissant cette comparaison – ร un classement des genres de peinture dโaprรจs les sujets reprรฉsentรฉs. Thรจme historique, portrait, paysage, nature morte… – logique de classement abandonnรฉe depuis longtemps. Les ลuvres ne sont plus classรฉes dโaprรจs le ยซquoiยป de la reprรฉsentation mais dโaprรจs leur ยซ comment ยป. Pourquoi donc ne pas en faire de mรชme pour le musรฉe ? Plutรดt que de continuer ร parler du musรฉe par ses ยซ objets ยป : lโart, lโhistoire, lโethnologie, les sciences naturelles et la technique…, qui par ailleurs ont dรฉjร fini par devenir un seul ยซ patrimoine ยป ou ยซ hรฉritage culturel ยป ? Ne vaudrait-il pas mieux รฉtablir une typologie distinguant les diffรฉrentes maniรจres de collectionner et dโexposer ? Car ce nโest quโร ce niveau que lโon a des chances de trouver la ยซ spรฉcificitรฉ ยป du musรฉe, nรฉcessaire pour lรฉgitimer son existence dans la sociรฉtรฉ.
Pour lโensemble des musรฉes contemporains, je distinguerais trois types de prรฉsentation diffรฉrentes :
1. Le musรฉe dโillustration :
Ce musรฉe nโรฉlabore pas, au sein de son institution, ce quโil expose. Le savoir communiquรฉ est รฉlaborรฉ ailleurs, dans des institutions de recherche spรฉcialisรฉes en gรฉnรฉral. Le musรฉe nโa pas la fonction dโy contribuer, une exposition sur un sujet nโa pas le droit de modifier les rรฉsultats de la recherche dans ce domaine. Le musรฉe des sciences et techniques qui vulgarise, explique, ร travers des images, des objets ou autres documents, ce que les diffรฉrentes disciplines ont รฉlaborรฉ, en constitue certainement l’exemple par excellence. La prรฉsentation nโy changera rien, mรชme si, elle aussi, peut รฉvoluer, devenir plus complรจte, par exemple. La rรฉvolution actuelle dans ces musรฉes consiste ร intรฉgrer รฉgalement les erreurs commises dans lโhistoire des sciences. Le musรฉe peut donc essayer dโexpliquer la logique de ce systรจme des sciences, mais ce sera toujours un scientifique qui la lui rรฉvรฉlera !
2. Le musรฉe de mรฉmoire :
Sa fonction est dโรฉtablir une mรฉmoire pour un lieu, un รฉvรฉnement, un personnage etc, non seulement comme lutte contre son oubli – ce serait la fonction dโun simple mรฉdium de stockage (archives, bibliothรจques) – mais aussi en tant que commรฉmoration pour une communautรฉ. Or ce musรฉe ne reflรจte pas un savoir รฉtabli ailleurs, il le construit au sein de son exposition ! Mรชme si son thรจme a comme origine un fait historique rรฉel, la mise en scรจne musรฉale seule dรฉcide de ce que lโon va retenir dans la mรฉmoire collective. La fonction pour la collectivitรฉ est รฉvidente : la commรฉmoration musรฉale empรชche que chacun ne retienne une autre version. Cependant, ces musรฉes de mรฉmoire nโont pas besoin de rรจgles scientifiques pour la construction de leur sujet. Leur maniรจre de communiquer est essentiellement mythique, on ne peut donc pas juger une mรฉmoire ยซ vraie ยป ou ยซ fausse ยป. Sa fonction est tout dโabord dโassurer le consensus de la collectivitรฉ pour laquelle elle est รฉtablie. Et seule cette communautรฉ a le droit de la juger actuelle ou obsolรจte.
Dans un tel cadre de dรฉfinition, le concept de lโEcomusรฉe fait enfin sens. Le musรฉe dโhistoire peut, par ailleurs, rentrer dans les deux cas : il peut รชtre un musรฉe dโillustration lorsque lโhistoire ยซacadรฉmiqueยป est expliquรฉe, ou un musรฉe de mรฉmoire, lorsque le but est commรฉmoratif – il faut seulement que soit clair pour le spectateur de quel type il sโagit.
3. Le musรฉe comme systรจme autonome
Pour les deux cas prรฉcรฉdents, il existe des raisons extรฉrieures ร la crรฉation du musรฉe – extรฉrieures, car les thรจmes reprรฉsentรฉs ne disparaรฎtront pas sans le musรฉe. Ces musรฉes peuvent รชtre caractรฉrisรฉs comme rรฉpondant ร une logique hรฉtรฉronome : la science nโa pas vraiment besoin dโรชtre vulgarisรฉe auprรจs dโun grand public, et une mรฉmoire peut aussi รชtre maintenue ยซ clandestinement ยป, lorsquโun rรฉยญgiยญme lโinterdit par exemple. Lโimportant est que les communautรฉs concernรฉes, scientifiques ou sociales, continuent ร parler entre eux leur ยซ langage ยป autonome, qui ne fait, dans aucun cas, dโabord rรฉfรฉrence ร une quelconque communication musรฉale prรฉalable,.
Or la sociรฉtรฉ a produit un autre systรจme, le seul ร mon avis, qui constitue un objet tout autre pour le musรฉe. Je parle รฉvidemment de lโart (tous genres confondus) : une crรฉation artistique ne serait pas imaginable, dans sa forme dโexistence moderne, sans le musรฉe, sans un espace de prรฉsentation et de comparaison. Depuis la fin du XVIIIรจme siรจcle, le systรจme de lโart sโorganise comme un systรจme complexe, avec des structures de comparaison quโon perรงoit de maniรจre historique et non plus comme des rรจgles normatives (les ยซ styles ยป de lโart) et des structures de rรฉflexion (la critique dโart). Ces deux รฉlรฉments dรฉcoulent ici (nous ne voulons pas dire quโils nโexistent pas ailleurs) de la perception (du fait de regarder, lire, รฉcouter…). Ils ont, en consรฉquence, besoin dโun mรฉdium de diffusion particulier : le thรฉรขtre, lโopรฉra, lโรฉdition et lโexposition. Ces lieux ont aujourdโhui en commun leur accessibilitรฉ au public. Lโart cherche-t-il vraiment le grand public ou, comme les sciences et la mรฉmoire, une ยซ communautรฉ ยป, cโest-ร -dire un public compรฉtent ? Ce nโest pas le fait de se prรฉsenter au public qui fait de lโart un systรจme ร part. Comme tous les autres systรจmes de notre sociรฉtรฉ, une certaine clรดture le caractรฉrise plutรดt.
La distinction est dโabord plus simple : cโest ce lieu de prรฉsentation et dโexposition qui est irremplaรงable pour la perception de lโลuvre, cโest-ร -dire de sa raison dโรชtre. Si un scientifique apprend un rรฉsultat de recherche, disons une nouvelle formule mathรฉmatique, peu importe quโil aparaissse dans un livre, ร la radio ou sur internet ; de mรชme le rรฉcit dโune mรฉmoire connaรฎt une tolรฉrance relativement importante par rapport ร ses moyens de diffusion et ses contenus (cf. les รฉtudes de Pierre Nora et al. sur les ยซ lieux de mรฉmoires ยป). Ceci nโest pas le cas de lโart : si une toile cubiste est exposรฉe accompagnรฉe dโune plastique africaine, le spectateur va trรจs probablement se faire une opinion du rapport des deux, autre que sโil avait seulement su quโil existe un rapport entre cubisme et art nรจgre. Lโexposition, et cโest pourquoi elle nโobรฉit pas ร des critรจres ยซextรฉrieursยป, nโest uniquement concevable que parce que quelquโun (ne serait-ce que lโartiste lui-mรชme) a observรฉ ce rapport qu’ont entre eux les objets exposรฉs. Lโart, bien longtemps avant que dโรชtre analysรฉ par la critique dโart, lโhistoire de lโart, la thรฉorie de lโart etc, a eu besoin dโun ยซ musรฉe ยป. Un scientifique, certes, a aussi besoin de connaรฎtre toutes les formules dรฉjร existantes sโil veut en trouver une nouvelle, mais peu importe le contexte dans lequel il les apprend, seul compte le fait quโil connaisse toutes celles qui concernent son domaine – pour y distinguer les ยซ vraies ยป des ยซ fausses ยป ! Un artiste doit-il nรฉcessairement connaรฎtre toutes les ลuvres dรฉjร peintes, tous les livres dรฉjร รฉcrits, tous les opรฉras dรฉjร composรฉs, avant de crรฉer une autre ลuvre ? Il est รฉvident quโil ne doit pas les connaรฎtre de cette maniรจre : lโart ne se vรฉrifie ou ne se falsifie pas, il doit, tout dโabord, รชtre nouveau, diffรฉrent. En appliquant une rรจgle correctement, je ne rรฉussirai jamais ร ยซ faire de lโart ยป, ร exposer dans ce musรฉe qui nโexpose que ce que je nโai jamais vu, entendu, lu …
Je me rends dans un musรฉe de mรฉmoire pour reconnaรฎtre ou pour que mes ยซ hรฉritiers ยป continuent ร reconnaรฎtre ; par contre j’irai dans un musรฉe dโillustration pour savoir, etc. Par ailleurs, un musรฉe dโart peut aussi se transformer en musรฉe de mรฉmoire, si jโy vais pour revoir, ou en musรฉe dโillustration, si jโy vais pour savoir ce que pense de lโart lโhistoire de lโart (une science !). Mais ceci nโest certainement pas la fonction premiรจre du musรฉe comme systรจme…
Etant donnรฉes les diffรฉrences importantes entre ces types de musรฉes, il faudrait ร prรฉsent rรฉflรฉchir ร la fonction que peut encore remplir le terme de musรฉologie. Sโil nโexiste pas un phรฉnomรจne homogรจne de ยซ musรฉe ยป, si lโรฉvolution de cette institution a fini par en diffรฉrencier trois, il serait vain de vouloir dรฉfinir une seule musรฉologie. Les crises de dรฉfinition, aussi bien de la ยซ musรฉologie ยป que du ยซ musรฉe ยป, posent pourtant des problรจmes quโil faut rรฉsoudre, si lโon accepte comme condition de la sociรฉtรฉ moderne la diffรฉrenciation fonctionnelle de systรจmes autonomes, au lieu de vouloir considรฉrer comme unitรฉ ce qui, depuis longtemps, est hรฉtรฉrogรจne.
Annette GEIGER
Universitรฉ de Stuttgart
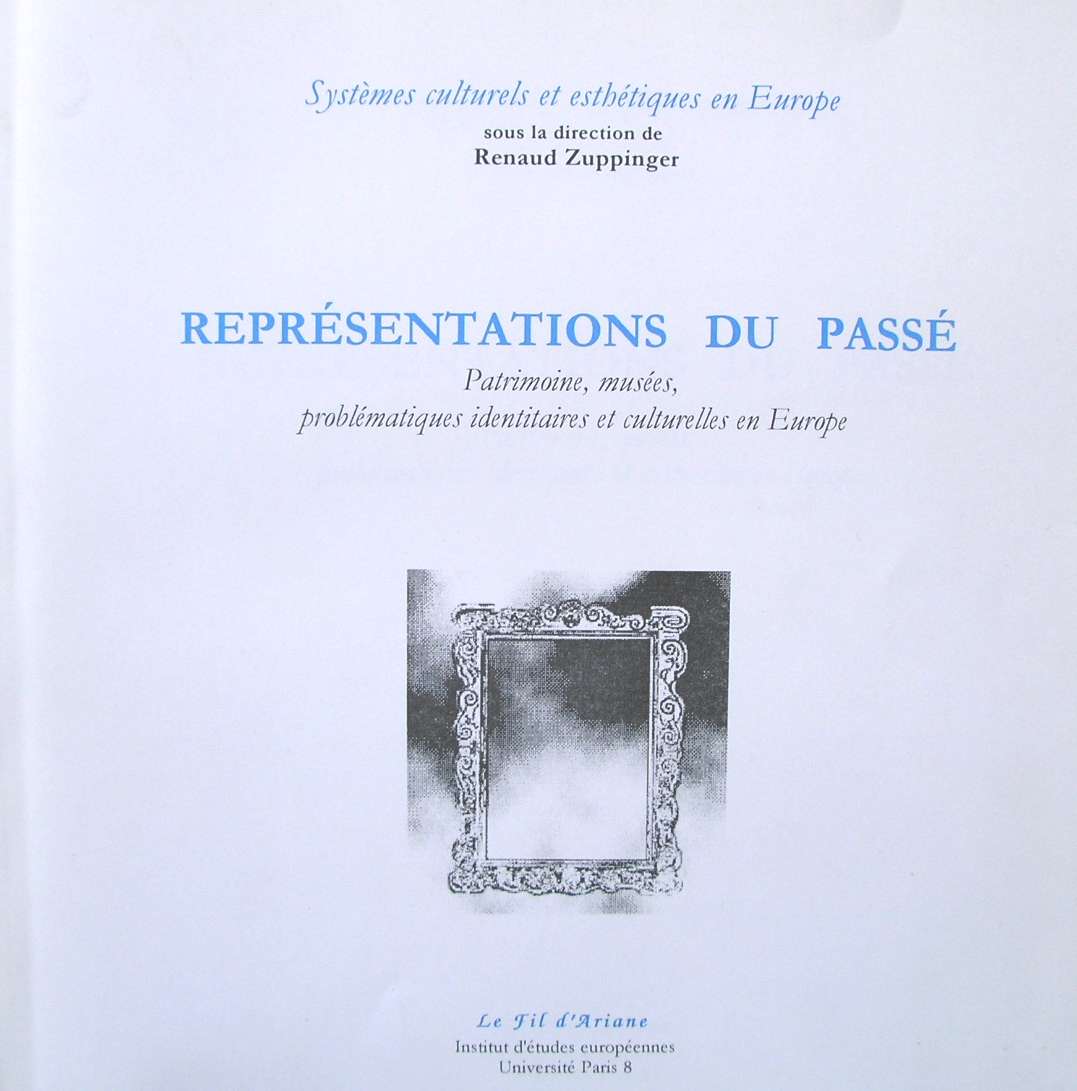

 mythe-imaginaire-sociรฉtรฉ
-
mythe-imaginaire-sociรฉtรฉ
-