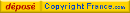Johanna O’BYRNE
S’interroger sur l’existence d’une identitĂŠ culturelle europĂŠenne suppose un travail de recherche historique antĂŠrieur, pour se demander si cette identitĂŠ a marquĂŠ les peuples rĂŠunis gĂŠographiquement sur le continent europĂŠen.
Une continuitĂŠ logique
De fait, l’histoire de l’Europe est marquĂŠe par une sorte de continuitĂŠ logique pour les europĂŠens que nous sommes. Nous avons ĂŠtudiĂŠ, au minimum par le biais de nos diffĂŠrentes histoires nationales, certains liens transeuro-pĂŠens, quitte Ă ce que ce soit ceux de guerres et de leurs pacifications. Et, justement, au fil de cette histoire europĂŠenne, nous ne pouvons que remarquer des phĂŠnomènes cycliques de rapprochement et de sĂŠparations. Une sorte de continuitĂŠ par des remises en question sans cesse renouvelĂŠes.
L’Europe se dĂŠmarque par son histoire cyclique faite de pĂŠriodes centripètes suivies de pĂŠriodes centrifuges. Rassemblement et dissensions des peuples europĂŠens en consĂŠquence de quoi notre propos reviendrait Ă recouvrir, au fil du patrimoine historique de l’Europe, ces pĂŠriodes centripètes – type vers lequel l’Union EuropĂŠenne est aujourd’hui engagĂŠe – et les pĂŠriodes centrifuges, en essayant de comprendre les phĂŠnomènes explicatifs de ces cycles conflictuels, vĂŠritables tensions dynamiques de notre continent.
Mais il ne s’agit pas ici seulement d’histoire. Il s’agit, dans l’histoire de l’Europe, de s’intĂŠresser Ă son identitĂŠ culturelle. ÂŤ IdentitĂŠ Âť, ÂŤ Culture Âť, deux termes complexes et ambigus Ă dĂŠfinir de par l’ĂŠtendu de leurs champs d’application.
Caractère de ce qui est commun, l’identitĂŠ s’ĂŠnonce scientifiquement par A est A ou l’ĂŠquation A=A. Concernant des individus, et plus encore des sociĂŠtĂŠs, l’identitĂŠ relève d’un schème d’appartenance. Elle est au confluent d’une hĂŠrĂŠditĂŠ sociale, ensemble d’attributs symboliques traduits en termes filiatifs, religieux et sociaux. Existe-t-il une vĂŠritable cohĂŠrence dans la transmission de ces patrimoines en Europe pour les citoyens europĂŠens d’aujourd’hui ?
Cette cohĂŠrence, de plus, est culturellement codĂŠe. C’est par un ensemble de rituels que se produit l’identification. Reste Ă savoir quels sont ces rituels, et en quoi les europĂŠens s’y reconnaissent les uns les autres.
Antonin Artaud affirmait que ÂŤ la culture demeure le moyen raffinĂŠ de comprendre et d’exercer la vie Âť. Se pose en consĂŠquence la question de savoir si les europĂŠens ont un hĂŠritage culturel commun suffisant pour rĂŠaliser l’Union EuropĂŠenne, soit l’exercice commun de leurs vies.
S’intĂŠressant aux problèmes d’acculturation et aux relations interethniques, SĂŠlim ABOU[1], tente de dĂŠfinir, dans un premier chapitre, l’identitĂŠ culturelle. Nous l’avons constatĂŠ, ce concept relève d’un champ plutĂ´t vaste. Et les critères sur lesquels SĂŠlim ABOU formule ce concept paraissent suffisamment notables pour les suivre. Il s’agit des critères de race, de la langue et de la culture. Critères proches de ceux de l’ethnicitĂŠ qui se trouvent en nĂŠcessaires et intensives relations pour former l’identitĂŠ culturelle d’un ensemble de sociĂŠtĂŠ, pour ce qui nous concerne. Or ces trois critères sont la source mĂŞme des divergences et des convergences de l’histoire europĂŠenne.
Ces diffĂŠrentes considĂŠrations nous amènent Ă nous poser un certain nombre de questions. Retrouve-t-on une identitĂŠ europĂŠenne Ă travers ces diffĂŠrents critères ? Y a-t-il eu, au cours de l’histoire de l’Europe, une pĂŠriode pendant laquelle ces critères ethniques et sociaux se sont rĂŠvĂŠlĂŠs critères de convergence des populations europĂŠennes ?
Et, finalement, quelle leçon tirer de cette histoire riche pour une Union EuropĂŠenne efficiente et rĂŠpandue auprès de ses populations ? Y a-t-il lieu, pour l’Union, d’aspirer Ă une identitĂŠ culturelle ou lui faut-il, plus modestement, accepter la multitude de ses identitĂŠs et de ses modes de vie au sein d’une union cohĂŠrente des peuples europĂŠens.
Pour tenter de rĂŠpondre au mieux Ă ces diffĂŠrentes interrogations, la population europĂŠenne nous intĂŠressera en tant qu’entitĂŠ dans un premier temps ; peuplement dont rĂŠsulte un hĂŠritage culturel pluriethnique, il n’en reste pas moins l’un des premiers Ă dĂŠvelopper le jeu de forces sociales au sein de frontières revendiquĂŠes.
Puis, consubstantielles Ă ces entitĂŠs des peuplements europĂŠens, nous ĂŠtudierons leurs langues, porteuses d’une cosmogonie europĂŠenne, mais aussi d’une prise de position nationale; et leur culture, prise dans son sens de pratique sociale, Ă la fois inspirĂŠe par de grands mouvements trans-europĂŠens, mais aussi moyen d’imprimer une personnalitĂŠ propre.
Deux mises en garde s’imposent avant d’entrer dans le dĂŠveloppement de notre propos.
L’histoire, selon la manière dont elle est traitĂŠe, n’est pas innocente. Se pose alors un problème d’ordre ĂŠpistĂŠmologique quant aux ouvrages et aux auteurs de rĂŠfĂŠrences sur ce thème. Marc Ferro, dans le Manières de voir consacrĂŠ Ă l’Europe[2], traitait avec justesse de ce problème des sources d’une science prenant ici une nouvelle dimension. Cette difficultĂŠ d’ordre ĂŠpistĂŠmologique est Ă marquer d’autant plus en considĂŠrant que l’histoire fait rĂŠfĂŠrence Ă des ĂŠtapes historiques qui ne sont pas vĂŠcues comme telles par leurs contemporains. En consĂŠquence de ces mises en garde ce travail pourra paraĂŽtre imparfait pour les spĂŠcialistes puisqu’il est l’objet d’un choix d’ĂŠclairage.
Par ailleurs l’histoire n’est pas la mĂŞme pour tous ses contemporains. Elle se divise mĂŞme en deux pour deux types de populations, une immense majoritĂŠ, qui suit le mouvement, et les ĂŠlites qui sont les acteurs de ce mĂŞme mouvement. Ces ĂŠlites ont certainement ĂŠtĂŠ europĂŠennes, se sont identifiĂŠes les unes aux autres entre pays europĂŠens. Une typologie d’ĂŠlites se retrouve Ă travers l’histoire europĂŠenne. Les familles de l’aristocratie europĂŠenne, issues de mariages contractĂŠs au grĂŠ des paix Ă signer ou des puissances ĂŠtatiques Ă valoriser. Mais aussi les ĂŠlites intellectuelles et artistiques, dont les ouvrages sont traduits, si nĂŠcessaire, lus et commentĂŠs dans toute l’Europe, ou qui n’hĂŠsitent pas Ă se dĂŠplacer, souvent Ă la demande et au profit de la première de ces ĂŠlites, pour se produire au travers des pays de l’Europe.
Deux types d’ĂŠlites qui donnent justement une cohĂŠrence Ă l’ĂŠvolution de l’histoire europĂŠenne, sans pour autant favoriser auprès du plus grand nombre ce sentiment d’unitĂŠ. Et il nous paraĂŽt nĂŠcessaire aujourd’hui de s’intĂŠresser plus encore au grand ensemble que forment les populations intĂŠgrales dans l’histoire de l’Europe.
Les populations europĂŠennes
Il apparaĂŽt dans un premier temps nĂŠcessaire de synthĂŠtiser la situation des diffĂŠrentes populations installĂŠes sur le territoire europĂŠen aux origines de son histoire. De fait, ces races sont importatrices de rites et de pratiques culturelles qui forment l’esprit des premières civilisations europĂŠennes. Sur ce point, et suivant les auteurs de l’ouvrage Aux sources de l’identitĂŠ europĂŠenne, nous ne pouvons que constater le fait que ÂŤ notre Europe apparaĂŽt, culturellement, comme l’indo-europĂŠanisation d’un substrat nĂŠolithique, modelĂŠe par l’hĂŠritage classique, la christianisation, et, enfin, le gĂŠnie propre de chacun de ses peuples Âť[3].
Une mosaique constituee autour des races de souche indo-europeenne
La multiplicitĂŠ raciale europĂŠenne
Les premières races europÊennes
Lors de la protohistoire, les premières races ont permis le dĂŠveloppement de la rĂŠvolution nĂŠolithique, Ă savoir une sĂŠdentarisation due Ă un premier dĂŠveloppement de l’agriculture et de l’ĂŠlevage, c’est Ă dire les dĂŠbuts d’une ĂŠconomie mixte.
Cet essor agricole implique un certain ĂŠlan culturel. L’ĂŠvolution est particulièrement prĂŠsente en Europe orientale oĂš se dĂŠveloppe une culture dite ÂŤ Vieille EuropĂŠenne Âť, avec un certain nombre de vestiges visibles. En particulier, des sĂŠpultures nous font remarquer l’existence de rites funĂŠraires, et, en consĂŠquence, les prĂŠmices d’une cosmogonie; cosmogonie qui met particulièrement en exergue la dĂŠesse mère nature. Ce dĂŠveloppement est essentiel pour les cultures postĂŠrieures[4].
Outre ce phÊnomène des dÊbuts dits culturels, la protohistoire va être la pÊriode de prise de conscience par les peuples concernÊs de la gÊographie de leur territoire. Et au IIIème millÊnaire avant notre ère apparaissent les guerres et la notion de hiÊrarchie au sein du groupe.
On remarque particulièrement trois zones correspondant Ă des civilisations en plein essor, qui, avec l’acquisition de l’ĂŠcriture feront passer l’Europe de la Proto-histoire Ă l’AntiquitĂŠ.
La culture minoenne, tout d’abord, se dĂŠveloppe sur l’ĂŽle de Crète. L’ĂŠvocation de cette composante de la civilisation ĂŠgĂŠenne est l’occasion pour nous de rappeler le mythe d’Europe, fille du roi de PhĂŠnicie, enlevĂŠe par Zeus et mère du roi Minos. Ce mythe paraĂŽt intĂŠressant pour deux de ses aspects, l’influence mythologique certaine, d’une part, tenue par les CrĂŠtois pour les AchĂŠens, futurs Grecs arrivĂŠs plus tardivement, et, d’autre part, par le fait qu’il permet de souligner la venue d’une culture Ă partir du Proche-Orient, alors qu’Europe vient du continent asiatique. Cette civilisation raffinĂŠe sera adoptĂŠe partiellement par les AchĂŠens, conquĂŠrants d’origine indo-europĂŠenne qui, par le phĂŠnomène du syncrĂŠtisme, donneront naissance Ă la civilisation mycĂŠnienne, lors de leur descente vers la mer EgĂŠe. L’influence essentielle des crĂŠtois se manifeste en particulier par leur adoption de l’ĂŠcriture syllabique, dite du linĂŠaire B.
Le groupe, plus disparate mais non moins influent, des Etrusques est installĂŠ sur la pĂŠninsule italienne. Civilisation urbaine qui se dĂŠveloppe au VIIIème siècle avant notre ère, les Ătrusques sont les fondateurs de Rome, et par lĂ mĂŞme du mythe de Romulus et RĂŠmus, elle influencera les Indo-europĂŠens arrivĂŠs plus tardivement, non seulement par leur connaissance de la construction mais encore par leur art.
Enfin, dernière grande civilisation de transition vers l’AntiquitĂŠ, les proto-Celtes, d’origine indo-europĂŠenne des premières vagues. Les historiens les dĂŠfinissent Ă partir de leurs pratiques mortuaires, puisqu’on parle d’une ÂŤ culture des tumulus Âť, qui se transformera vers des pratiques de type ÂŤ culture des champs d’urne Âť au Ier millĂŠnaire d’avant notre ère. Cette culture, mis Ă part l’incinĂŠration de ses morts, dĂŠveloppe ĂŠnormĂŠment le travail du bronze.
Les ethnies indo-europĂŠennes
La plus grande partie des peuples d’origine indo-europĂŠenne sont arrivĂŠs Ă partir de la pĂŠriode du deuxième millĂŠnaire avant notre ère. On reconnaĂŽt quatre groupes principaux pour ce qui concerne l’Europe :
Les Hellènes, ou Grecs, terme qui rassemble tout Ă la fois les Ioniens et les AchĂŠens. Ces peuples indo-europĂŠens viennent du Nord. Ils s’organisent en de multiples principautĂŠs, avec un important dĂŠveloppement de la force militaire et de la lĂŠgislation des conflits. Leur arrivĂŠe dans la violence, entre autre, mettra fin Ă la civilisation minoenne dont ils adopteront partiellement certains traits. Avec Alexandre le Grand, la civilisation grecque devient ÂŤ hellĂŠnique Âť en s’enrichissant du dĂŠveloppement culturel du Proche-Orient.
Les Italiques, de leur cĂ´tĂŠ, s’installent vers la pĂŠninsule italienne. Ils se subdivisent en deux sous-groupes, les Osco-ombriens et les Romains. Suivant la mĂŞme pĂŠriode de dĂŠveloppement que les prĂŠcĂŠdents, a lieu une première phase d’acculturation ĂŠtrusque, puis Ă partir de la soumission grecque, une pĂŠriode florissante avec l’adoption de l’hellĂŠnisme.
Quant aux Celtes, ils se rĂŠpandent par vagues successives sur une vaste ĂŠtendue gĂŠographique, sans unitĂŠ politique, mais rassemblĂŠs par des liens tant linguistiques que religieux, au point que certains parlent d’une ÂŤ Europe celte Âť[5]. On les retrouve de l’Europe occidentale (Gaulois…) jusqu’Ă la Grèce, cependant les permanences de cette civilisation ne subsisteront principalement qu’en Irlande et dans l’actuelle Grande-Bretagne ( Ecosse et Pays de Galles).
La dernière vague des arrivĂŠes de ces peuples d’origine indo-europĂŠenne a lieu plus tardivement et de façon dĂŠfinitive face aux rĂŠgions culturellement les plus dĂŠveloppĂŠes. ArrivĂŠe qui s’explique tant par des nĂŠcessitĂŠs ĂŠcologiques que par des pressions d’autres peuples venant de plus Ă l’est encore, les mongols. Il s’agit des grandes migrations qui mettront finalement un terme Ă la culture classique de la phase historique de l’AntiquitĂŠ. Il s’agit des Germains, nom gĂŠnĂŠrique postĂŠrieur commun d’une multitude de peuples venus de Scandinavie, arrivĂŠs par vagues successives entre 2000 et 500 avant JĂŠsus-Christ. Leur arrivĂŠe est d’abord pacifique jusqu’Ă l’Empire romain d’Occident, oĂš ils sont intĂŠgrĂŠs, en petit nombre, souvent en tant que mercenaires de l’armĂŠe romaine. Ce n’est qu’au dĂŠbut de notre ère qu’ils franchiront massivement le limes romain de façon dĂŠterminante. On distingue parmi ces diffĂŠrents groupes les Lombards, les Francs, les Angles, les Saxons, les Wisigoths…
Outre ces quatre grands groupes, ne peuvent ĂŞtre nĂŠgligĂŠs les Slaves, dont l’origine d’arrivĂŠe, plus tardive, est ĂŠgalement plus floue. Ce retard dans leur implantation gĂŠographique la rendra de fait plus conflictuelle.
Par ailleurs, les Baltes, ĂŠgalement arrivĂŠs aux environs de 2000 avant notre ère se dirigeront moins vers les territoires occidentaux de l’Europe, s’ĂŠtendant au contraire du nord au sud de la partie continentale de l’Europe, Ă savoir jusqu’Ă ce qui correspond Ă la BiĂŠlorussie actuelle.
Il est entendu qu’aucun de ces peuples n’a alors notion de son ÂŤ europĂŠanitĂŠ Âť. L’idĂŠe mĂŞme de territorialitĂŠ, notion gĂŠographique sous-tendue d’idĂŠologie, n’apparaĂŽt qu’avec les Grecs, comme nous amène Ă le constater les apports culturels de ces diffĂŠrents groupes de populations.
Apports culturels de ces groupes installĂŠs sur le territoire europĂŠen
Les apports culturels des diffĂŠrents groupes originels.
Si nous voulons relever les apports culturels des groupes d’origine indo-europĂŠenne, il convient de noter toutefois que les races Indo-europĂŠennes ont certainement dĂŠveloppĂŠ une culture des plus brillantes plus du cĂ´tĂŠ de l’Orient que l’on retrouve en particulier en Iran ou encore en Inde.
Edgar Morin reconnaĂŽt Ă l’Europe la parentĂŠ et l’ĂŠpanouissement de trois grands courants de pensĂŠe, le rationalisme, la science et l’humanisme[6]. En suivant l’exposition de cette idĂŠe, nous pouvons en reconnaĂŽtre certaines prĂŠmices dès cette pĂŠriode historique :
La pensĂŠe rationnelle, et, en relation, la philosophie et une cosmogonie (en tant que apprĂŠhension par l’homme du monde dans lequel il vit) sont explorĂŠs en premier lieu. Issus de la pĂŠriode hellĂŠniste, ces dĂŠveloppements des idĂŠes se poursuivent en plusieurs directions. La prise de conscience de la valeur de l’homme, comme nous allons le voir, mais ĂŠgalement, et de façon insĂŠparable pour ces premiers penseurs pluridisciplinaires, celui des sciences. La notion d’une dignitĂŠ humaine ĂŠmerge avec la première conceptualisation de la dĂŠmocratie grecque. Suite Ă l’hellĂŠnisation partielle de Rome se dĂŠveloppent alors le droit ĂŠcrit et l’esprit constitutionnaliste, mais aussi la notion de citoyennetĂŠ. Parallèlement on assiste au dĂŠveloppement de la CitĂŠ, l’Urbs, et d’un système administratif des gouvernants Ă partir de Rome.
Par ailleurs, et cette fois non rĂŠpertoriĂŠes par Edgar Morin, des influences celtes et germaniques, bien que moins brillantes, ne sont certainement pas Ă nĂŠgliger non plus pour les modes de vie mais aussi l’imaginaire de l’Europe actuelle. Ainsi en est-il de l’organisation familiale, avec des influences d’organisation clanique, voire mĂŞme du rĂ´le et de la position de la femme, domaines pour lesquels il nous faut nous ramener aux lois bretonnes des sociĂŠtĂŠs celtiques par exemple. Mais surtout, ces deux cultures primitives, de tradition orale, ont transmis un capital essentiel du merveilleux au travers des sagas et des contes, dont ces deux civilisations sont très riches.
Tout comme on ne peut dire que la culture classique europĂŠenne est le fruit direct des races de souche indo-europĂŠenne, puisque celles-ci ont profitĂŠ des dĂŠveloppements amorcĂŠes par les sociĂŠtĂŠs prĂŠexistantes Ă leur arrivĂŠe, leur vĂŠritable maturation n’aurait pu se dĂŠvelopper vers l’identitĂŠ europĂŠenne actuelle sans un certain nombre de rencontres culturelles essentielles. Et ceci bien que ces rencontres n’aient certainement pas eu lieu de façon aussi simple que l’acquis d’aujourd’hui pourrait le laisser penser.
L’Europe doit beaucoup notamment au Proche-Orient. L’essentiel des bases de ses techniques et scientifiques en proviennent. Les dĂŠveloppements de ces diffĂŠrents domaines d’ailleurs ont lieu en parallèle des ĂŠvolutions dont nous avons parlĂŠ prĂŠcĂŠdemment, et s’y imbriquent historiquement. Sans les SumĂŠriens, les Egyptiens et les SĂŠmites, l’ĂŠcriture, l’astronomie, les mathĂŠmatiques, la mĂŠdecine et la pharmacopĂŠe… n’auraient pas eu la mĂŞme ĂŠvolution.
Le monothĂŠisme et la Bible du judaĂŻsme, par la diffusion lente de leurs idĂŠes, vont apporter Ă l’Europe l’ĂŠpanouissement d’une nouvelle cosmogonie. Ces concepts peuvent ĂŞtre mis en interrelation avec ce qui est considĂŠrĂŠ comme l’humanisme. Se dĂŠveloppe en effet, au travers de la foi, une morale validant les idĂŠes premières d’isonomie grecque. Par le judaĂŻsme apparaĂŽt le christianisme, ĂŠlĂŠment des plus essentiellement formateur de la culture europĂŠenne. Il est Ă noter d’ailleurs un probable syncrĂŠtisme entre le christianisme et les religions d’origine indo-europĂŠennes lorsque l’on remarque la trilogie divine des chrĂŠtiens Père, Fils et Esprit Saint, mais aussi pour ce qui concerne les pratiques et les dates rituelles[7].
L’Islam, enfin, marque l’ĂŠvolution de la pensĂŠe Ă partir de l’hĂŠgire (622 de l’ère chrĂŠtienne). Culture transnationale ouverte aux cultures non-musulmanes dans un premier temps, elle va permettre la transmission de savoirs entre ces diffĂŠrentes civilisations. De cette première ouverture aux autres, contrairement Ă la jeune chrĂŠtientĂŠ, religion d’Etat depuis le IVème siècle, va dĂŠcouler une fuite vers ses territoires, transformĂŠs en vĂŠritables terres d’accueil pour un certain nombre de dĂŠtenteurs du savoir classique, restĂŠs paĂŻens. Il en est ainsi des derniers philosophes paĂŻens d’Alexandrie, ou d’autres chrĂŠtiens non orthodoxes. VĂŠritable mĂŠdium, l’Islam va transmettre cette essence Ă un certain nombre de penseurs de la chrĂŠtientĂŠ, avec une plus ou moins grande capacitĂŠ. Et ce sera entre autre grâce Ă Avicienne ou Averroes, Maures du XIème siècle que seront transmises et surtout poursuivies les grandes pensĂŠes platonicienne ou aristotĂŠlicienne de la culture classique.
Des peuplements europĂŠens qui, au fil de l’histoire, donnent l’impression de la rĂŠussite d’un certain ĂŠclectisme, vĂŠritable melting-pot ethnico-culturel europĂŠen.
Après la rupture que marquent les grandes migrations Ă partir du Nord, l’histoire se scinde pour mettre fin d’une façon dĂŠfinitive Ă la pĂŠriode glorieuse de l’AntiquitĂŠ dans l’empire romain d’Occident, alors que l’ĂŠvolution n’est pas du tout la mĂŞme dans la partie orientale de l’empire romain.
Il convient de noter que, d’une façon gĂŠnĂŠrale, ces diffĂŠrents peuples sont des hĂŠritiers inĂŠgaux de ce que l’Europe revendique comme son patrimoine culturel antique. De plus, leur ĂŠvolution va se dĂŠrouler de façon parallèle, qui plus est dans des zones souvent sĂŠparĂŠes gĂŠographiquement. Ce qui permet l’essor de sociĂŠtĂŠs variĂŠes.
Par ailleurs, la difficile frontière Est de l’Europe, que certains considèrent comme ĂŠtant la pĂŠninsule du continent eurasien, va se fixer Ă une frontière de la culture, c’est Ă dire de la façon la plus mobile et instable qui soit.
Une intolĂŠrance rĂŠcurrente malgrĂŠ cet hĂŠritage pluri-ethnique
La pĂŠriode mĂŠdiĂŠvale est certainement, en prenant compte notamment des recherches de l’historien Jacques Le Goff, l’une des plus formatrice pour l’Europe. De fait, on y retrouve au fil de ces siècles, longtemps considĂŠrĂŠs comme obscurs, une multitude de donnĂŠes nouvelles pour cette zone gĂŠographique. En premier lieu, ce sont les frontières qui sont ĂŠbauchĂŠes autour de petits royaumes; avec un phĂŠnomène de sĂŠparation irrĂŠmĂŠdiable d’avec la partie orientale du continent. Frontières qui, au fil de l’acquisition d’une souverainetĂŠ des Ătats, gagnent en lĂŠgitimitĂŠ et en dĂŠfense nationale. Et, au sein mĂŞme de ces frontières, se dĂŠveloppent de nouveaux modes de vie sociales auxquelles correspondent par ailleurs de nouvelles peurs autrement canalisĂŠes.
Dessins de nouvelles frontières.
Ă la chute de Rome, et consĂŠcutivement aux grandes invasions, l’ĂŠquilibre frontalier europĂŠen est totalement remis en question. C’est une organisation en petites communautĂŠs autarciques qui se dĂŠveloppe bien avant la mise en place du système fĂŠodal. Mais surtout, après une dissension thĂŠologique importante l’Europe se dĂŠveloppe dĂŠfinitivement en dehors de tout contact avec l’ex-Byzance.
Du « limes » au schisme oriental
Les Grecs avaient conscience de leur existence propre par rapport aux « barbares ». L’ĂŠtymologie mĂŞme de ce terme est par ailleurs rĂŠvĂŠlatrice de la considĂŠration qu’ils portaient Ă ceux n’appartenant pas Ă leur culture, puisque barbare correspondrait Ă un borborygme de ceux qui ne parlent pas le grec.
HĂŠritiers de la culture grecque, les Romains poursuivent cette idĂŠe d’une communautĂŠ soudĂŠe face Ă l’ennemi potentiel. Pourtant cette communautĂŠ ne se fonde pas non plus pour eux sur la base d’une langue-culture similaire mais bien plus sur une communautĂŠ de droit-citoyennetĂŠ. CitoyennetĂŠ qu’il convient de protĂŠger par une armĂŠe en relation avec le système administratif et surtout par des zones frontalières dĂŠfendues de façon structurĂŠe.
C’est ainsi qu’apparaissent des ÂŤ limes Âť, ultimes frontières de l’Empire romain, qui reste centrĂŠ autour de la ÂŤ Mare nostrum Âť. Zone militarisĂŠe, souvent fortifiĂŠe, elles se poursuivent du Mur d’Adrien, au nord de l’Angleterre, sur une ligne horizontale Ă travers le continent europĂŠen et traversant la partie est de l’actuelle Allemagne.
Surtout, ce qu’il convient de noter en parallèle de cette conception de la frontière qui apparaĂŽt alors, c’est cette notion de citoyennetĂŠ nouvelle, accessible Ă tout homme libre. Il y a donc un très fort sentiment d’appartenance commune de la population, au sein d’un territoire dĂŠfini, et sous une autoritĂŠ propre. Trois conditions Ă la dĂŠfinition constitutionnelle de l’Ătat, et, en cela, force est de constater l’hĂŠritage juridique romain dont l’Europe sera la première bĂŠnĂŠficiaire. Le sentiment d’appartenance atteint son apothĂŠose sous ThĂŠodose, Ă la fin du IVème siècle, et dĂŠcline ensuite en consĂŠquence de la dĂŠcadence de l’Empire.
Il est important de souligner que l’Empire se reconnaĂŽt sur tout le pourtour de la MĂŠditerranĂŠe. Et, notamment, en consĂŠquence des territoires conquis, la Rome se retrouve sur son versant oriental, autour de la ville-capitale de Byzance, baignĂŠe de culture hellĂŠnique, devenue Constantinople lorsqu’elle est transformĂŠe en capitale de l’Empire en 330 par l’empereur Constantin. Le dĂŠveloppement de Constantinople est des plus brillants, bien qu’il se heurte Ă une opposition d’ordre politique avec la partie romaine de l’Empire. Alors que Rome est mise Ă mal par les nouveaux barbares, venus de Germanie, Constantinople revendique sa position de capitale, en ligne directe de l’ancienne prĂŠpondĂŠrance de Rome. Pourtant la Rome mise Ă mal campe sur ses positions et s’oppose Ă une telle situation. L’Empire devient bicĂŠphale.
A ces divergences politiques vont se surajouter des difficultĂŠs d’ordre religieux. La chrĂŠtientĂŠ, devenue religion d’Ătat au IVème siècle, se concentre sous l’autoritĂŠ papale de Rome, et, en mĂŞme temps, se trouve rĂŠgie par le dogme. Or, Constantinople ne partage ni la reconnaissance du Pape, auquel il prĂŠfère son Patriarche, ni la reconnaissance dogmatique. Après la crise iconoclaste, l’opposition religieuse atteint son paroxysme au Xème siècle, pour, finalement aboutir au schisme de 1054 et Ă la forme orthodoxe du christianisme.
La sĂŠparation d’avec Constantinople va ĂŞtre consacrĂŠe par l’ĂŠpisode des croisades, qui, Ă quatre reprises, voit arriver les barbares de l’ex-Empire romain dans une Constantinople mise Ă mal par les Turcs. Ces Germains qui ont mis un terme Ă l’Empire romain, mais en ont finalement adoptĂŠ les pratiques et surtout la religion, viennent « dĂŠfendre les Lieux Saints » et tombent en admiration devant la richesse, le dĂŠveloppement et le raffinement de Constantinople par laquelle tous passent, ĂŠtant le lieu ultime de la chrĂŠtientĂŠ. Le quiproquo ĂŠtait grand avec les romains d’Orient qui, s’ils avaient bien appelĂŠ Ă l’aide les descendants de l’Empire romain, ne demandait cependant qu’une aide de mercenaires pour les soutenir face Ă l’arrivĂŠe des Turcs. Mais ces arrivĂŠes massives de soldats au nom de la chrĂŠtientĂŠ rĂŠpondaient aux intĂŠrĂŞts propres de l’Eglise d’Occident, en manque de mobilisation sur son terrain oĂš les rĂŠvoltes et mouvements sectateurs se multipliaient. Le rĂŠsultat ne sera pas brillant alors qu’ils ne seront considĂŠrĂŠs que comme des barbares, par les Byzantins, mais surtout par les Turcs, qui ne voient pas lĂ une guerre de religion mais bien plutĂ´t des pratiques de raids barbares. Enfin, le royaume de JĂŠrusalem dirigĂŠ par Godefroy de Bouillon ne sera qu’ĂŠphĂŠmère, sans plus aucun soutien de la part de Rome.
Finalement, la frontière sud-orientale de l’Europe se fera au bon vouloir des Turcs, alors que la partie occidentale ne rĂŠagira pas Ă la prise de la capitale de l’Empire byzantin en 1453, et ne se manifestera pas plus lors du siège de Vienne au XVème siècle.
Parallèlement Ă cette frontière va se dessiner peu Ă peu le conflit de la frontière sud-est de l’Europe. LĂ mĂŞme oĂš les Slaves s’installaient tardivement, vont se renouveler rĂŠgulièrement dès cette pĂŠriode du haut Moyen Ăge des conflits avec les Germains.
Conflit qui se trouve par ailleurs attisĂŠ au moment de la conversion des Slaves, alors que s’opposent l’obĂŠdience romaine, propagĂŠe par les Germains, et l’obĂŠdience byzantine. Et ce alors que la configuration gĂŠographique mĂŞme pousse les Slaves vers Byzance, les mettant dans l’erreur pour leurs voisins Germains. Ce qui explique sans doute les croisades rĂŠpĂŠtĂŠes des Chevaliers teutoniques vers cet Est difficilement dominable. Ainsi, les Baltes, dont l’ĂŠvolution mĂŠdiĂŠvale est plus tardive, ainsi que sa conversion, formeront finalement la limite est de l’Europe. Et ce, alors qu’ils joueront très vite un rĂ´le ĂŠconomique important sur la zone scandinave jusqu’au XVIIIème. La Russie ne se posant comme ÂŤ europĂŠenne Âť qu’avec Pierre-le-Grand.
Ă l’intĂŠrieur de ces frontières, un dĂŠveloppement mĂŠdiĂŠval unitaire.
La pĂŠriode mĂŠdiĂŠvale est reliĂŠe Ă l’AntiquitĂŠ romaine par la propagation croissante du christianisme Ă travers les peuples diversement installĂŠs sur le territoire europĂŠen. Il convient de souligner l’imprĂŠgnation du christianisme par l’organisation de l’Empire Romain. En effet, quelques annĂŠes après l’Ădit sur la libertĂŠ des cultes, le christianisme devenait religion officielle en 394. Les implications de cette lĂŠgislation religieuse vont avoir une multitude de consĂŠquences. Et, première d’entre toutes, l’Eglise calque sa hiĂŠrarchie sur l’organisation romaine mĂŞme.
Cette proximitĂŠ tant organisationnelle que gĂŠographique va transformer l’autoritĂŠ ecclĂŠsiastique en autoritĂŠ tout court alors que l’Empire Romain se trouve en dĂŠliquescence dès le Vème siècle. Et, finalement, l’Ăglise sert de vĂŠritable trait d’union avec le Moyen Ăge, ĂŠtant dĂŠtentrice des attributs essentiels d’une puissance civile. Ainsi l’enseignement, la justice, l’ĂŠquivalent de ce qui est considĂŠrĂŠ aujourd’hui comme la couverture sociale, sont assurĂŠs par les diffĂŠrents ordres religieux. Ces attributs sont d’autant plus essentiels que les prĂŠrogatives rĂŠgaliennes ne sont plus assurĂŠs par l’Ătat, dans cette pĂŠriode de tourmente des grandes migrations. L’Ăglise domine l’organisation sociale de cette pĂŠriode du haut Moyen Ăge et l’imprègne consĂŠcutivement d’un certain nombre de ses valeurs. Ainsi en est-il de la notion du travail, mis en valeur au sein des monastères alors en plein dĂŠveloppement, mais qui inspire aussi l’organisation du temps des croyants.
Ainsi, petit Ă petit s’organise un nouveau mode de vie, hĂŠritier de l’AntiquitĂŠ romaine, mais essentiellement façonnĂŠ par la chrĂŠtientĂŠ, en parallèle des bouleversements politiques. Après une pĂŠriode de dĂŠclin, les villes se dĂŠveloppent Ă nouveau. Elles sont le lieu d’un renouveau ĂŠconomique et aussi d’essor d’une nouvelle classe, la bourgeoisie. Le dĂŠveloppement ĂŠconomique est facilitĂŠ par la mise en place de corporations des artisans. Et ces rassemblements sont parallèlement lieux de contestation. La bourgeoisie acquiert, au cours des siècles, des libertĂŠs civiles et politiques face aux pouvoirs ĂŠtendus des seigneurs de la fĂŠodalitĂŠ installĂŠe par les carolingiens. Ce sont des chartes mĂŠdiĂŠvales qui, pour l’essentiel, permettent de codifier ces acquis des bourgs.
Ces mouvements de contestation et le dĂŠveloppement de la bourgeoisie ont certainement ĂŠtĂŠ ĂŠgalement favorisĂŠs par le renouveau scolaire. Le Haut Moyen Ăge voit se propager les ĂŠcoles monastiques, puis, au sein des bourgs, les ĂŠcoles cathĂŠdrales. L’ĂŠvolution logique de ce dĂŠveloppement verra naĂŽtre en faible nombre des UniversitĂŠs au XIIème siècle.
Pour chacun de ces domaines se rĂŠpète l’importance de la pĂŠriode du VIIIème siècle, Ă tel point que les historiens parlent de ÂŤ RĂŠvolution carolingienne Âť. PĂŠriode d’un certaine restauration impĂŠriale avec le couronnement de Charlemagne en l’an 800 qui redonne Ă l’Europe un sentiment d’unitĂŠ, en parallèle bien entendu de l’unitĂŠ chrĂŠtienne alors que la majoritĂŠ des peuples ont ĂŠtĂŠ convertis. PĂŠriode d’apaisement et d’unitĂŠ politique, d’amĂŠlioration ĂŠconomique, la renaissance carolingienne permet de dĂŠvelopper les domaines de l’intellect. Ce sont de nouvelles ĂŠcoles, mais ĂŠgalement une redĂŠcouverte des textes classiques par le biais du monde musulman (les Maures d’Espagne) ou encore par la conservation qu’en ont fait les moines irlandais ou lombards. Ce ne sont pas tant ces redĂŠcouvertes, qu’un dĂŠveloppement intellectuel et artistique qui apparaissent alors avec le dĂŠveloppement de l’art courtois dans les cours fĂŠodales, mais aussi des rĂŠflexions profondes telles que celle concernant la sĂŠparation des pouvoirs spirituel et temporel.
Dans cette considĂŠration partiale du Moyen Ăge se constate un sentiment d’europĂŠanitĂŠ de façon unitaire pour ces ĂŠlites nouvelles, sentiment profond qui demeure jusqu’Ă la pĂŠriode des Temps Modernes. Pareillement, par le renouvellement des penseurs mais aussi la revendications des populations, des idĂŠes politiques sont essentielles Ă l’esprit humaniste qui sera prĂ´nĂŠ par les europĂŠens de la Renaissance jusqu’aux Temps modernes.
Il ne s’agit pas de tomber dans un discours dualiste de l’histoire. Le Moyen Ăge, s’il n’est pas la pĂŠriode unique durant laquelle l’unitĂŠ europĂŠenne semble exister, est certainement très formateur pour la sociĂŠtĂŠ europĂŠenne. Et ce tant par les dynamismes multiples qu’il permet, que par l’ĂŠmergence de pratiques qui vont dans un sens contraire Ă ces dĂŠveloppements positifs.
Christianisme et pouvoir politique
L’Ăglise chrĂŠtienne ne prend pas seulement une position hĂŠgĂŠmonique du point de vue organisationnel. Son rapprochement du pouvoir Ă partir du Vème siècle implique d’autres consĂŠquences que l’instauration d’une nouvelle hiĂŠrarchie. En effet, devenue religion d’Ătat, elle prend dĂŠsormais poids lors de dĂŠcisions politiques, et adopte en consĂŠquence des positions adĂŠquates Ă son nouveau statut. Sur une pĂŠriode relativement rapide, le dogme chrĂŠtien va s’orienter vers une restriction des libertĂŠs. L’Ăglise s’adapte restrictivement et prend des positions conservatrices, intolĂŠrantes, face Ă la rĂŠalitĂŠ politique qui, bien que troublĂŠe, demeure sous sa responsabilitĂŠ.
Il s’agit en fait d’une vĂŠritable prise de position contre ceux qui troublent l’ordre public. Ce rappel des faits est sans doute nĂŠcessaire pour resituer le contexte de la difficile pĂŠriode du grand schisme entre chrĂŠtiens d’Orient et chrĂŠtiens d’Occident.
En effet, si le Grand Schisme Ă proprement parler n’a lieu qu’en 1054, donnant naissance Ă une Ăglise grecque orthodoxe et une Ăglise latine catholique sans plus de solidaritĂŠ rĂŠciproque, du Vème au XIème siècle, ce ne sont qu’accumulations de quiproquos et conflits. Nous avons dĂŠjĂ constatĂŠ les malaises qu’impliquent les croisades qui ne font que souligner l’ĂŠvolution de la ChrĂŠtientĂŠ en deux mondes distincts. L’autre grand point de dĂŠsaccord apparaĂŽtra durant la querelle des iconoclastes au VIIIème siècle.
C’est le dĂŠbut de la prise en main de la sociĂŠtĂŠ par l’Ăglise catholique. Elle est le rĂŠsultat de la considĂŠration qu’une seule vĂŠritĂŠ est dĂŠtenue intĂŠgralement par l’autoritĂŠ ecclĂŠsiastique catholique, se voulant universaliste. Si bien que toute autre doctrine de la foi chrĂŠtienne est dĂŠsormais refusĂŠe, sous prĂŠtexte d’hĂŠrĂŠsie.
Par ailleurs, le catholicisme adopte une attitude menaçante pour les croyants, abusant de conceptions manichĂŠennes. Le millĂŠnarisme a alors de fortes consĂŠquences sur la liturgie chrĂŠtienne, et, du dĂŠbut des ĂŠcritures Ă cette pĂŠriode mĂŠdiĂŠvale, l’Ăglise impose une image d’elle puissante parce que dĂŠtentrice de la RĂŠdemption. Ce qui explique une facilitĂŠ Ă des pratiques matĂŠrielles ĂŠloignĂŠes de la thĂŠorie.
Cette trop grande puissance religieuse, d’une hiĂŠrarchie catholique capable de dĂŠlivrer le Salut des populations et par-lĂ mĂŞme d’en obtenir la soumission totale, fait rĂŠagir les dĂŠtenteurs du pouvoir au cours du Moyen Ăge.
Mise en place du mythe de la conspiration en Occident
La surpuissance ecclĂŠsiastique se concrĂŠtise par une mise Ă l’index de tout ce qui ne correspond pas Ă la norme religieuse. Cela a des rĂŠpercussions, comme ĂŠcrit prĂŠcĂŠdemment, pour tout ce qui concerne les doctrines divergentes du dogme au sein de l’Ăglise catholique. Mais ce sont surtout les croyants des religions juive et musulmane, qui se trouvent acculĂŠs aux positions les plus antagonistes.
La religion catholique est sans aucun doute la meilleure alliĂŠe des rois espagnols au cours de la ÂŤ Reconquista Âť, et rĂŠciproquement. Au nom du catholicisme et de sa vĂŠritĂŠ universaliste, les juifs et les musulmans sont persĂŠcutĂŠs.
La responsabilitĂŠ des aĂŻeuls de la communautĂŠ juive dans la mort du Christ leur est reprochĂŠe Ă partir du XIème siècle. Soit au moment mĂŞme du dĂŠbut des croisades. Jusqu’alors la cohabitation restait pacifique entre les trois religions monothĂŠistes. Pourtant au printemps 1096 apparaissent les premières formes de l’antisĂŠmitisme. Une ÂŤ croisade populaire Âť entreprend alors de rejoindre JĂŠrusalem, et fait ses premières victimes parmi les incroyants rencontrĂŠs, soient mille trois cent personnes tuĂŠes rien qu’au sein de la communautĂŠ juive de Mayence.
Parallèlement, l’occupation musulmane Ă partir du VIIIème siècle est arrĂŞtĂŠe aux limites de la pĂŠninsule ibĂŠrique. La mĂŠmoire populaire se fait fort de remĂŠmorer la victoire contre les impies Ă travers la ÂŤ Chanson de Roland Âť, par ailleurs falsifiĂŠe puisque les ennemis de Roncevaux sont des Basques. Ă partir du XIIIème siècle se dĂŠroule en Espagne la ReconquĂŞte par une alliance des rois de Navarre, de Castille, et d’Aragon. Derrière eux se rassemble un amalgame d’europĂŠens, convaincus de leur mission chrĂŠtienne dans la reconquĂŞte des territoires espagnols. 1492 est l’annĂŠe de la fin de cette lente ÂŤ Reconquista Âť avec la prise du Royaume de Grenade, couronnĂŠe comme il s’avĂŠrera plus tard, par la dĂŠcouverte d’un nouveau continent par Christophe Colomb.
Derrière l’armĂŠe militaire s’installe pourtant une armĂŠe plus redoutable encore, celle de l’Inquisition, organisme judiciaire ecclĂŠsiastique instituĂŠ par GrĂŠgoire IX et confiĂŠ Ă l’ordre des Dominicains nouvellement fondĂŠ (1213). Ă partir de 1492, juifs et musulmans sont acculĂŠs au dĂŠpart ou Ă la conversion. L’Inquisition ĂŠtant chargĂŠe de vĂŠrifier la vĂŠracitĂŠ des conversions, elle agit par la suspicion systĂŠmatique, entre autres poursuites des juifs et musulmans convertis et relaps.
Initialement, l’Inquisition a ĂŠtĂŠ instituĂŠe dans le cadre prĂŠcis de la lutte de l’Ăglise contre les cathares. VĂŠritable ĂŠpiphĂŠnomène d’une opposition du Nord contre le Sud, de la civilisation de la langue d’oĂŻl contre celle de la langue d’oc, le catharisme, hĂŠrĂŠsie venue de l’est dĂŠveloppĂŠe en Albigeois va ĂŞtre l’occasion pour Philippe-Auguste d’une ÂŤ croisade Âť censĂŠe rĂŠtablir l’ordre. Et, trente ans après les premiers combats au XIIIème siècle, ce fut l’occasion d’adjoindre Ă la couronne de France une nouvelle province au XIIIème siècle.
On le comprend, c’est une vĂŠritable psychose qui s’installe dans les esprits de la population mĂŠdiĂŠvale europĂŠenne. L’Inquisition n’hĂŠsite pas Ă utiliser la torture pour arriver Ă ses fins contre les hĂŠrĂŠtiques, qui finalement peuvent apparaĂŽtre sous n’importe quelle forme aux yeux de l’Ăglise. Des mesures de sĂŠgrĂŠgation peuvent ĂŞtre utilisĂŠs contre ces hĂŠrĂŠtiques contestataires dĂŠclarĂŠs impies. Cette attitude craintive est d’ailleurs retranscrite dans le roman d’Umberto Eco Le nom de la rose.
Ces pratiques redoutables ont une double implication pour la psychologie des masses. D’une part, elle favorise la peur des populations face Ă un pouvoir ecclĂŠsiastique alliĂŠ au pouvoir temporel. Surtout, une pratique s’installe, qui consiste Ă trouver des victimes Ă un mal social. VĂŠritable mythe de la Conspiration[8], c’est une facilitĂŠ donnĂŠe aux dirigeants que d’affubler les responsabilitĂŠs d’un malaise social, ĂŠconomique ou politique Ă un groupe social particulier. Au cours du Moyen-Ăge, le schĂŠma se rĂŠpète; alors que la peste noire fait rage, le peuple est tenu d’expier ses fautes; Ă un moment oĂš les crises ĂŠconomiques secouent le royaume français, les Templiers sont persĂŠcutĂŠs… Jusqu’au XIXème et XXème siècle, cette pratique est utilisĂŠe. Lors de scandales politico-judiciaires, ce sont les francs-maçons et les juifs Ă nouveau qui se trouvent diabolisĂŠs.
Langues et pratiques culturelles affirment
l’identitĂŠ nationale des EuropĂŠens
Langue de culture et langues nationales
Sociologiquement, le langage se dĂŠfinit comme un ÂŤ produit de la vie en sociĂŠtĂŠ de nature culturelle ayant pour fin la communication entre les membres d’un peuple Âť[9]. VĂŠritable système arbitraire ou conventionnel de signes, la langue est propre Ă chaque communautĂŠ, et chaque communautĂŠ se reprĂŠsente Ă travers son langage.
En effet, le langage est le moyen pour la communautĂŠ de transmission Ă travers les gĂŠnĂŠrations de ses valeurs, de sa apprĂŠhension du monde. Finalement, il correspond Ă un moyen de communication enrichi de la cosmogonie de cette communautĂŠ.
Plus tard, après le dĂŠveloppement culturel des communautĂŠs, avec, notamment, l’acquisition de l’ĂŠcriture, puis de l’imprimerie, la langue devient une revendication de chaque communautĂŠ. Cette volontĂŠ apparaĂŽt en corrĂŠlation avec les dĂŠveloppements culturels et idĂŠologiques correspondants. Le langage passe d’une langue vĂŠhiculaire Ă une langue populaire, vernaculaire.
Une langue pour une cosmogonie commune
Ă travers l’ĂŠvolution de l’utilisation du langage, il paraĂŽt intĂŠressant de constater les bouleversements socioculturels des communautĂŠs europĂŠennes. De fait, la linguistique permet de retrouver une parentĂŠ des langues europĂŠennes. Mais la comparaison de ces ĂŠvolutions en parallèle des langues europĂŠennes laisse surtout constater que la langue riche de culture est nĂŠgligĂŠe au profit des langues vernaculaires. Ce mouvement populaire devient une revendication culturelle correspondant Ă une revendication territoriale avec la dĂŠfinition de plus en plus restrictives des frontières des territoires.
Langues classiques et pensĂŠe symbolique
La langue d’une communautĂŠ permet de transmettre au sein de cette mĂŞme communautĂŠ une cosmogonie commune. La langue, Ă un stade ĂŠlaborĂŠ de l’ĂŠvolution humaine, atteint l’abstraction. De ce fait, elle s’enrichit petit Ă petit de concepts clefs, qui correspondent,in fine, Ă l’ĂŠlaboration d’une pensĂŠe symbolique. Ce stade de la pensĂŠe est sans doute par ailleurs Ă rapprocher du passage essentiel Ă la pratique de rituels autour de la mort pour les communautĂŠs installĂŠes alors en Europe. Ăvolution dĂŠjĂ confirmĂŠe par ailleurs par la prise en compte d’une hiĂŠrarchie liĂŠe au dĂŠveloppement de l’art de la guerre.
Avec les auteurs du livre Aux sources de l’identitĂŠ europĂŠenne nous pouvons penser que ÂŤ tout comme leurs langues dĂŠrivent d’une langue-mère, les diffĂŠrentes cultures indo-europĂŠennes ont gardĂŠ un hĂŠritage conceptuel commun, et ont conservĂŠ des structures idĂŠologiques communes sous les habits les plus disparates Âť[10].
Effectivement, les linguistes spĂŠcialistes des langues indo-europĂŠennes ont constatĂŠ des similitudes entre le sanskrit classique, le grec et le latin dont sont issus de nombreux termes techniques ou conceptuels aujourd’hui encore utilisĂŠs Ă travers l’Europe.
Cette constatation d’ordre linguistique amène Ă un rapprochement avec les travaux de Georges DumĂŠzil, dont nous avons dĂŠjĂ citĂŠ la recherche effectuĂŠe sur le panthĂŠon mythologique indo-europĂŠen, et, en consĂŠquence de cela, sur le constat de la « tripartition fonctionnelle »[11]. Georges DumĂŠzil retrouve cinq dieux principaux dans les panthĂŠons indo-europĂŠens, qui occupent trois fonctions cosmiques et sociales principales, soient la souverainetĂŠ, la guerre, et la subsistance physique. Or, ces trois fonctions hiĂŠrarchisĂŠes dans l’ordre citĂŠ se retrouvent tant chez les Indiens que chez les Celtes ou encore les Romains. Et il faut reconnaĂŽtre cette mĂŞme organisation Ă travers la rĂŠpartition sociale de l’Ancien RĂŠgime par exemple. En premier lieu apparaĂŽt le ClergĂŠ, responsable de la spiritualitĂŠ des hommes et influent politique, vient ensuite la Noblesse, initialement noblesse d’ĂŠpĂŠe ĂŠlargie avec le temps Ă la noblesse dite de robe et dont le chef suprĂŞme est le roi, enfin le Tiers-Etat rassemblant les agriculteurs avec les bourgeois issus de l’artisanat et du commerce.
La culture classique revendiquĂŠe par les EuropĂŠens correspond Ă un mĂŞme hĂŠritage conceptuel. Elle se retrouve Ă travers le grec, le latin puis un certain nombre de langues nationales Ă des pĂŠriodes de prĂŠĂŠminences de ces mĂŞmes nations; principalement le français. Ces trois langues ont pour particularitĂŠ d’avoir ĂŠtĂŠ de vĂŠritable langues vĂŠhiculaires de culture. Le grec, dans un premier temps est considĂŠrĂŠ comme langue de culture Ă travers l’Empire Romain. De la mĂŞme façon, le latin est essentiel pour les ĂŠlites de la pĂŠriode mĂŠdiĂŠvale. Le français prend une importance culturelle et diplomatique Ă partir du XVIIIème siècle, siècle des Lumières.
Ascension des langues dites vulgaires malgrĂŠ l’attachement aux langues de culture.
Les Romains avaient une conscience d’infĂŠrioritĂŠ culturelle par rapport aux grecs colonisĂŠs. Cela se traduisit par une volontĂŠ d’intĂŠrioriser la langue grecque comme langue de culture, dans la transmission du savoir auprès des jeunes gĂŠnĂŠrations. Pourtant, les chrĂŠtiens adoptent très vite le latin comme langue commune de la liturgie. Leur prise de position prĂŠĂŠminente d’ĂŠlite intellectuelle, le latin devenait par-lĂ mĂŞme essentielle dans la culture chrĂŠtienne commune postĂŠrieure Ă l’Empire romain. Cela en surplus de l’utilisation sur tout le territoire encadrĂŠ par le limes du latin comme langue de l’administration, de la justice et des institutions politiques.
L’arrivĂŠe massive de barbares va tempĂŠrer pour un temps cette prĂŠĂŠminence. Pourtant, si dans un premier temps les envahisseurs et les vaincus coexistent chacun avec ses propres institutions et sa lĂŠgislation, ces mĂŞmes envahisseurs adoptent la langue latine des vaincus, tout comme les Romains avec le grec huit siècles auparavant. Au Vème siècle de notre ère, finalement, les Germains rĂŠdigent en latin.
Le latin peut s’enorgueillir dĂŠsormais d’auteurs devenus aussi « classiques » que ceux qu’avait, Ă son apogĂŠe, la langue grecque. Il paraĂŽt alors cohĂŠrent que cette langue prenne Ă son tour un statut de langue de culture, en plus de sa capacitĂŠ d’ĂŞtre, Ă proprement parler, une langue vĂŠhiculaire. L’ĂŠlite utilise le latin, et le savoir se transmet dans la mĂŠmoire collective Ă travers cette langue et son ĂŠcriture.
Cette ĂŠlite mĂŠdiĂŠvale, hĂŠritière de la littĂŠrature et des techniques de l’AntiquitĂŠ grĂŠco-latine, est installĂŠe selon un modèle ĂŠgalement issu de l’antique villa, les grandes seigneuries. Pourtant le système seigneurial s’appuie sur de nouvelles entitĂŠs dans ce monde occidental chrĂŠtien, inspirĂŠes de l’organisation sociale des Germains. Apparaissent en effet le village, le château, appartenant Ă un propriĂŠtaire terrien et/ou chevalier, et bientĂ´t la ville dont le statut ambiguĂŤ va lui permettre de s’ĂŠmanciper. De la mĂŞme façon que la ville-commune se dĂŠfait de la mainmise seigneuriale, le savoir va tendre Ă ĂŞtre divulguĂŠ. Le Concile de Vaison, au VIème siècle, avait ordonnĂŠ la fondation d’une ĂŠcole dans chaque paroisse, le prĂŞtre faisant office d’instituteur. Au XIIIème siècle, il est dĂŠcidĂŠ, sous l’autoritĂŠ papale, de fusionner les ĂŠcoles cathĂŠdrales, monastiques et privĂŠes pour donner naissance aux UniversitĂŠs. Ce sont d’abord les villes de Bologne, de Paris et d’Oxford qui sont dotĂŠes de ces institutions ecclĂŠsiastiques d’enseignement. De Salamanque Ă Leipzig et Cracovie, ce modèle est adoptĂŠ dans les diffĂŠrentes villes de l’Europe du savoir. Le latin est langue obligatoire et permet les ĂŠchanges entre maĂŽtres venus tant de l’Allemagne que de l’Italie ou de l’Angleterre. L’enseignement se veut commun, ÂŤ universitĂŠ Âť dĂŠrivant du mot ÂŤ universel Âť, et se dĂŠveloppe en direction des sciences profanes. Par-lĂ mĂŞme, l’enseignement prend son indĂŠpendance vis-Ă -vis de l’Ăglise. Au XVIème siècle, l’esprit humaniste recherche la connaissance universelle et impose l’enseignement des ÂŤ humanitĂŠs Âť Ă savoir le latin, le grec, la mathĂŠmatique et les sciences dĂŠbutantes.
Parallèlement, on assiste Ă une ascension des langues vernaculaires issues de l’ĂŠvolution linguistique Ă partir du bas latin. Le Moyen-Ăge est en effet la pĂŠriode de transition du latin, cette langue rĂŠservĂŠe dans une certaine mesure aux clercs, aux langues romanes populaires. Entre le VIIIème et le XIème siècle, le bas latin est petit Ă petit mĂŠlangĂŠ aux dialectes et parlers rĂŠgionaux. Le français, par exemple, est issu de la langue d’oĂŻl, mĂŠlange de bas latin et de francique. Les autres langues qui se forment alors sont le catalan, l’espagnol, l’italien, le portugais, le provençal (occitan), le rhĂŠto-roman, le roumain et le sarde. L’ĂŠvolution sĂŠmantique a pu donner Ă chaque langue son originalitĂŠ ensuite. Dès le IXème siècle par ailleurs, un concile invite les prĂŞtres Ă prĂŞcher en roman, ce qui relève de la mĂŞme volontĂŠ d’ouverture de la part de l’Ăglise que ne l’a ĂŠtĂŠ ensuite la dĂŠcision de crĂŠation des universitĂŠs.
Ămergence des ĂŠtats-nations sur la base des langues nationales
Les Germains adoptent le latin au Vème siècle et sont hĂŠritiers du ÂŤ moule Âť de l’AntiquitĂŠ grĂŠco-romaine, mais, avec eux, le point central n’est plus le pourtour de la MĂŠditerranĂŠe, et il faut convenir alors seulement d’une ouverture au nord. L’Europe prend alors une physionomie plus en adĂŠquation avec celle qu’il nous est permis de constater aujourd’hui. Et l’axe danubien devient central dans les relations commerciales, remplaçant très vite ainsi l’attrait mĂŠditerranĂŠen. Cette nouvelle gĂŠographie de l’Europe est signe d’un hĂŠritage antique assumĂŠ par les vainqueurs de l’Empire dĂŠchu, tout en gardant un attachement Ă leur propre identitĂŠ avec laquelle ils vont façonner l’Europe. On peut ainsi dater Ă cette pĂŠriode de transition la naissance de l’Europe des Etats. Cette naissance est possible par une première sĂŠparation de la tutelle religieuse de Ătats en pleine gestation, qui aboutira finalement Ă la sĂŠparation des Ătats-nations de l’Ăglise englobante. Par ailleurs au sein mĂŞme de ces Ătats, l’idĂŠe de souverainetĂŠ ĂŠvoluera de façon Ă dĂŠvelopper l’Ătat moderne.
Revendication et sĂŠparation entre les Ăglises et l’Ătat
Dès le Moyen-Ăge est repensĂŠe la rĂŠpartition des responsabilitĂŠs suprĂŞmes, alors que l’Ăglise prĂŠdomine de son aura l’organisation politico-sociale de la pĂŠriode de transition postĂŠrieure Ă l’Empire Romain. Avec la redĂŠcouverte des textes politiques classiques qui se dĂŠveloppe Ă mesure du dĂŠveloppement des universitĂŠs en dehors des lignes ecclĂŠsiastiques, une opposition apparaĂŽt entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. En fait, il est possible de remonter Ă la pĂŠriode du couronnement de Charlemagne pour comprendre le malaise grandissant entre la couronne royale et la crosse pontificale. Jusqu’alors, les investitures sont faites par des laĂŻcs suivant la tradition germanique. Pourtant en cet an 800, c’est le pape qui organise le couronnement impĂŠrial de Charlemagne, ÂŤ patrice des romains Âť. Le conflit des investitures prendra une dimension plus importante au XIème siècle avec le pape GrĂŠgoire VII en opposition avec l’autoritĂŠ du Saint Empire Romain Germanique ayant pour ambition d’assurer l’unitĂŠ chrĂŠtienne temporelle. La thĂŠorie des deux glaives fait apparaĂŽtre de nouveaux concernĂŠs par cette opposition entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel alors qu’apparaissent de nouveaux intervenants dans ce qui est devenu une vĂŠritable controverse philosophique et thĂŠologique. Avec Saint Thomas d’Aquin, finalement, c’est une rĂŠconciliation de l’aristotĂŠlisme paĂŻen, redĂŠcouvert en parallèle de l’ouverture des penseurs aux philosophes arabes et notamment d’Averroès, avec le christianisme. Le thomisme reconnaĂŽt la nĂŠcessitĂŠ de l’Ătat, entitĂŠ politique qui assure la paix et a donc une valeur positive, en consĂŠquence de cette reconnaissance, l’homme doit ĂŞtre Ă la fois bon citoyen et bon chrĂŠtien dans sa recherche du Salut. Ce conflit de pouvoirs qui a dĂŠbutĂŠ entre le Saint Empire Romain Germanique et le Saint Siège, aboutira finalement au XVIème siècle Ă une volontĂŠ de prise en compte de la spĂŠcificitĂŠ nationale dans les rites de l’Ăglise. IdĂŠe dĂŠveloppĂŠe par Luther, elle sera reprise par Henri VIII revendiquant un anglicanisme suite Ă sa rupture avec l’autoritĂŠ papale, ou encore par la ÂŤ charte Âť du gallicanisme adoptĂŠe par les ĂŠvĂŞques de France Ă l’instigation de Louis XIV.
L’idĂŠe d’une spĂŠcificitĂŠ nationale religieuse prend un nouvel essor lors de la conflictuelle pĂŠriode de la RĂŠforme. Luther, religieux de la ville universitaire de Wittenberg, valorise un resserrement des croyants avec Dieu sans l’intermĂŠdiaire des religieux. Pour ce faire, il traduit la Bible en langues vernaculaires, ce alors que parallèlement l’imprimerie prend son essor grâce Ă Gutenberg et Ă son innovation d’impression Ă l’aide de caractères mĂŠtalliques. La RĂŠforme protestante, inspirĂŠe de l’esprit humaniste, permet une sorte d’ĂŠclosion de la notion d’individu pris en tant que tel, et, par lĂ mĂŞme, permet une première ĂŠvolution vers l’individualisme.
Pareillement, c’est la pĂŠriode d’ĂŠmergence de l’idĂŠe d’une diffĂŠrenciation entre les diffĂŠrentes nations de l’Europe. D’autant plus forte dans les esprits que chaque nation ressent un besoin de marquer son identitĂŠ par rapport Ă l’Ăglise qui se veut universelle. Les diffĂŠrentes situations politiques et ĂŠconomiques impliqueront en consĂŠquence de plus ou moins grande manière les Ătats. Dominique Colas dans son ouvrage Le glaive et le flĂŠau marque bien par exemple Ă quel point la RĂŠforme et ses idĂŠes austères nouvelles arrivaient Ă point dans la situation tendue de l’Europe du nord, alors que les rĂŠvoltes paysannes se multipliaient face aux pouvoirs abusifs des princes. Certains de ces mĂŞmes princes en butte Ă l’autoritĂŠ du Saint Siège adopteront la nouvelle religion des plus pauvres devenant par cette prise de position les ÂŤ protestants Âť. Finalement, le XVIème siècle marque la fin de l’unitĂŠ europĂŠenne dans la chrĂŠtientĂŠ.
C’est ĂŠgalement une première ĂŠtape vers la laĂŻcisation progressive de l’Europe. Les Ătats, par la laĂŻcisation de l’ĂŠtat civil et ce dĂŠtachement dans ses dĂŠcisions du Saint Siège parfois malmenĂŠ, deviennent laĂŻc Ă la fin du XIXème, ce qui montre le processus lent impliquĂŠ. Sans doute la RĂŠvolution française, mettant fin Ă une monarchie de droit divin, a-t-elle ĂŠtĂŠ une ĂŠtape dĂŠcisive en ce sens pour l’Europe occidentale. Mais c’est en Angleterre, avec ÂŤ la Glorieuse RĂŠvolution de 1688 Âť et avant l’intermède politique d’Olivier Cromwell que l’absolutisme de droit divin est mis Ă mal. L’Europe devient dĂŠfinitivement laĂŻque avec l’ĂŠclatement de l’Empire austro-hongrois. Depuis le Vatican, le pape LĂŠon XIII convie les catholiques Ă un ÂŤ ralliement Âť au gouvernement rĂŠpublicain, inspirĂŠ par le thomisme politique, et, avec l’encyclique ÂŤ Rerum novarum Âť de 1891, il jette les bases d’un catholicisme social.
La plus grande opposition, finalement au XXème siècle, se fera autour de l’enseignement. 1905 en France est l’annĂŠe de la sĂŠparation des Ăglises et de l’Ătat, et c’est l’adoption d’un point de vue national de l’enseignement laĂŻc, obligatoire et gratuit lĂŠgifĂŠrĂŠ par Jules Ferry en 1881.
Cette laĂŻcisation progressive des sociĂŠtĂŠs europĂŠennes est parallèle au dĂŠveloppement du concept d’identitĂŠ nationale mais aussi de la progression de l’esprit capitaliste.
Ălaboration de l’Ătat moderne au sein de ces Ătats souverains
L’Ordonnance de Villers-CotterĂŞts, pendant la pĂŠriode charnière du XVIème siècle, dĂŠcidĂŠe par François 1er en 1539 est un acte remarquable politiquement, en plus de ses implications linguistiques. DĂŠsormais tous les actes administratifs seront rĂŠdigĂŠs en français. La langue populaire est officialisĂŠe et utilisĂŠe pour l’ĂŠtat civil, les actes de justice, les lois pourront ĂŞtre connues de l’ensemble des strates sociales françaises. Cette idĂŠe sera d’ailleurs poursuivie par l’enseignement obligatoire centralisĂŠ. Cette progression de reconnaissance des langues populaires, favorisĂŠe par l’imprimerie mais aussi par les actes politiques, est un mouvement qui touche l’ensemble des Ătats europĂŠens les menant Ă long terme vers les nationalismes.
Cette ĂŠvolution politique voire idĂŠologique doit pourtant ĂŞtre mise en corrĂŠlation avec une ĂŠvolution de la reconnaissance croissante du statut de l’individu par rapport Ă sa communautĂŠ. Ă partir du Moyen-Ăge s’effectue un lent mouvement de fragmentation des communautĂŠs, l’individu se dĂŠtachant lentement mais sĂťrement des multiples liens sociaux organisĂŠs. Le mouvement d’autonomisation et de souverainetĂŠ de l’homme, de sa nation, apparaĂŽt dans cette pĂŠriode historique pour devenir incontournable au XVIIIème siècle.
L’idĂŠe que l’homme peut et doit ĂŞtre un citoyen est le rĂŠsultat d’un double hĂŠritage; de deux notions europĂŠennes intĂŠgrĂŠes Ă sa cosmogonie. Il faut en effet le rapporter aux idĂŠes politiques grecques et particulièrement Ă la première conception d’isonomie qui apparaĂŽt alors, certes insuffisante puisque cette ĂŠgalitĂŠ devant la loi dĂŠmocratique ne concerne ni les femmes ni les esclaves. L’hĂŠritage complĂŠmentaire de ce concept politique provient de la notion chrĂŠtienne de l’ĂŠgalitĂŠ et de l’importance de l’homme dans l’Ăglise, quel que soit son statut.
Les chartes mĂŠdiĂŠvales reconnaissent au sein de la commune une libertĂŠ civile personnelle et rĂŠelle Ă chacun des habitants de façon ĂŠgalitaire. Ces communes, futures villes, au nord comme au sud de l’Europe, ont obtenu un droit d’existence hors du système fĂŠodal par un statut particulier, accompagnĂŠ de privilèges plus ou moins ĂŠtendus ĂŠtant donnĂŠ le caractère souvent coutumier de leur obtention. De la mĂŞme manière, les barons anglais obtiennent du roi la Magna Carta en 1215. Elle organise une limitation du pouvoir royal, premier accès Ă une nouvelle souverainetĂŠ. Sa poursuite ĂŠvolutive se traduira par « l’Habeas corpus », en 1679, qui garantit dĂŠsormais la libertĂŠ individuelle. Initialement, la Grande Charte rĂŠpondait Ă un conflit d’autoritĂŠ entre l’assemblĂŠe ĂŠlective d’origine aristocratique et l’idĂŠe d’une souverainetĂŠ relevant du droit divin censĂŠe ĂŞtre dĂŠtenue par le roi. L’importance des Chambres reprĂŠsentatives existantes Ă travers l’Europe d’alors se reflète Ă travers le type de convocation qui les concerne. Or les Ătats, dans un premier temps, se forment dans un sens centralisateur autour d’une dynastie de droit divin. C’est le cas tant en France qu’en Angleterre ou en Espagne. La dynamique du XIIIème siècle en Angleterre est une première avancĂŠe vers le parlementarisme après cette centralisation extrĂŞme autour d’un pouvoir de droit divin. Elle marque le dĂŠbut d’une ĂŠvolution vers la reconnaissance du citoyen, Ă travers une reprĂŠsentativitĂŠ par le suffrage censitaire au XIXème siècle puis du suffrage universel au XXème siècle.
Les ĂŠvĂŠnements du Siècle des Lumières, d’abord la Guerre d’IndĂŠpendance nord-amĂŠricaine de 1776 puis la RĂŠvolution Française corroborent ces ĂŠvolutions socio-politiques. La notion d’honnĂŞte homme, poursuite de l’humaniste paneuropĂŠen du XVIème siècle savant et critique, conjugue celle des droits de l’homme. Les deux ĂŠvĂŠnements historiques font ĂŠvoluer l’idĂŠe de souverainetĂŠ, souverainetĂŠ nationale et de souverainetĂŠ populaire, et amène des hĂŠsitations pour les philosophes politiques entre ces deux modèles de dĂŠmocratie reprĂŠsentative que sont celle correspondant Ă l’ĂŠlectorat droit et celle de l’ĂŠlectorat fonction. Les philosophes et encyclopĂŠdistes traversent l’Europe pour transmettre un peu partout leurs rĂŠflexions qui influencent certains despotes ĂŠclairĂŠs europĂŠens, Catherine II de Russie, FrĂŠdĂŠric II de Prusse… qui ne vont pas pour autant jusqu’au bout de ces idĂŠaux. Pourtant ces idĂŠes s’accompagnent d’universalisme, et tant la RĂŠvolution française et ses guerres que les invasions napolĂŠoniennes constitueront diffĂŠrentes tentatives d’exportation du modèle national français.
Avec la RĂŠvolution apparaĂŽt le concept de la Nation, unitĂŠ politique et humaine partageant un mĂŞme territoire et soumise Ă une mĂŞme autoritĂŠ. Ă partir de cette dĂŠfinition, deux conceptions de la nation vont s’opposer en Europe au XIXème siècle, correspondant Ă deux traditions philosophiques europĂŠennes. Avec Fichte et Herder, philosophes allemands, la nation est première, qui façonne chacun de ses membres. A contrario, les français sous l’ĂŠgide de Renan et Fustel de Coulanges, la nation est le rĂŠsultat de la volontĂŠ de chacun des individus qui la forme. Cette opposition entre la ÂŤ thĂŠorie ethnique des nationalitĂŠs Âť et la ÂŤ thĂŠorie ĂŠlective des nationalitĂŠs Âť se retrouve Ă travers l’essentiel des conflits de nationalitĂŠs qui bouleversent le XIXème siècle, et plus particulièrement autour de la question de l’Alsace-Lorraine après la guerre de 1870. Ce siècle, vĂŠritable Ăre des RĂŠvolutions » pour Eric Hobsbown, favorise l’exaltation de ce sentiment d’appartenance Ă une collectivitĂŠ nationale donnĂŠe.
Le nationalisme ÂŤ fermĂŠ Âť selon la terminologie de Michel Winock[12], laisse bien souvent apparaĂŽtre un excès bien propre Ă l’identitĂŠ europĂŠenne et apparaĂŽt depuis lors de façon rĂŠcurrente. Ă l’opposĂŠ, le ÂŤ nationalisme ouvert Âť se ralliera Ă la volontĂŠ d’ĂŠvangĂŠlisation chrĂŠtienne en permettant par exemple la colonisation, au nom de sa mission civilisatrice. Dans ce domaine de l’impĂŠrialisme mercantile, il faut encore diffĂŠrencier les thĂŠories justificatrices des diffĂŠrents Ătats europĂŠens, la France rĂŠpublicaine proclamant vouloir diffuser ses principes universalistes, au contraire des Anglais et des Allemands plus prosaĂŻques et/ou rĂŠalistes.
La culture, expression artistique autant que reflet identitaire
Dans l’introduction de cette ĂŠtude, nous constations la diffĂŠrence Ă faire au sein de la population europĂŠenne, entre des strates sociales diffĂŠremment loties face Ă l’idĂŠe d’unitĂŠ europĂŠenne. Il s’agit, bien sĂťr, de l’ĂŠlite de dĂŠcision, transeuropĂŠenne de par ses liens familiaux entretenus au cours de l’Ancien RĂŠgime, mais ĂŠgalement de l’ĂŠlite artistique.
Nous avons perçu au travers de l’ĂŠvolution sociale et politique des Ătats souverains l’amorce du recul de l’aristocratie europĂŠenne. Il s’agit maintenant de prendre en considĂŠration les mouvements artistiques de l’Europe, pour se demander si l’appellation de ÂŤ RĂŠpublique des Lettres Âť lui convient.
Les mouvements des expressions artistiques
L’ĂŠvolution de l’art en Europe est une fois de plus Ă rapprocher de son histoire religieuse. De fait, les textes religieux vont ĂŞtre les premiers modèles des artistes. Ces reprĂŠsentations sur supports picturaux ou musicaux, principalement, prennent, du fait de leur sujet un caractère sacrĂŠ par delĂ le premier degrĂŠ. Première muse, l’Ăglise est ĂŠgalement la première commanditaire des artistes. Cette situation va ĂŠvoluer avec l’ĂŠmergence de nouvelles classes possĂŠdantes et la pratique du mĂŠcĂŠnat. L’art perdant de son sacrĂŠ du fait mĂŞme de cette diversification de ses acheteurs, il devient un mĂŠdiateur figuratif de considĂŠrations d’ordre thĂŠologiques d’abord, puis ĂŠconomiques voire politiques.
L’ imprematur de l’Ăglise
Les reprĂŠsentations artistiques en Europe sont, dès leur abord, le rĂŠsultat d’une influence, si ce n’est d’une volontĂŠ, religieuse. Ainsi les reprĂŠsentations des textes chrĂŠtiens se font-elles par le biais de l’image. Ces images sont, dans un premier temps, symboliques ; le poisson ou la colombe ĂŠtant souvent dessinĂŠs pour reprĂŠsenter la foi, la reprĂŠsentation de la figure humaine est ensuite acceptĂŠe. Il n’en est pas de mĂŞme lorsqu’on s’intĂŠresse aux autres religions monothĂŠistes. Le judaĂŻsme valorise le Verbe transmis grâce Ă la Torah, ce qui est peut-ĂŞtre Ă relier au phĂŠnomène de la diaspora. L’Islam, ĂŠgalement a la Parole, il se reprĂŠsente Ă travers l’expression architecturale des mosquĂŠes, qui, bien souvent, inclut la Parole du prophète Mahomet par le biais de bas-reliefs et ronde-bosse sculptĂŠs, ou encore admettant des dessins non figuratifs, les arabesques.
Pourtant au sein de la chrĂŠtientĂŠ, l’art de l’Europe occidentale va se distancier de la conception de Byzance de la reprĂŠsentation religieuse. Rome reste relativement pragmatique et considère la peinture comme un artisanat nĂŠcessaire permettant de dĂŠcorer les grands murs des premières ĂŠglises et basiliques, alors que le byzantinisme recherche le raffinement Ă l’excès pour cette reprĂŠsentation du sacrĂŠ. La mosaĂŻque en provenance de ce Proche-Orient lumineux va influencer l’Ăglise catholique romaine Ă partir du Vème siècle. Dans cet art, la basilique Saint-Marc de Venise ne s’ĂŠloigne pas beaucoup de la basilique Sainte-Sophie byzantine de six siècles son aĂŽnĂŠe. Pourtant les cheminements artistiques de Byzance et de Rome vont diverger, Ă cause de leurs controverses d’ordre thĂŠologique et de souverainetĂŠ.
La crise iconoclaste apparaĂŽt Ă Byzance au IXème siècle, sur fond de controverse religieuse, mais elle relève ĂŠgalement de troubles politiques et sociaux. L’icĂ´ne, portrait typique de l’art byzantin de la mère et de l’enfant, correspond aux conciles proclamant Marie mère de Dieu. Le problème apparaĂŽt lorsque ces reprĂŠsentations deviennent, au cours du VIIIème siècle, l’objet d’une idolâtrie liĂŠe Ă un certain fĂŠtichisme. Les religieux favorisent ce mouvement qui leur bĂŠnĂŠficie financièrement, ce qui choque certains membres de la classe moyenne de l’empire, qui, se rassemblant, forment le mouvement destructeur des icĂ´nes. Ce mouvement sera suivi avec plus ou moins de constance par les autoritĂŠs ecclĂŠsiastiques et impĂŠriales, pour finalement ĂŞtre dĂŠclarĂŠ comme hĂŠrĂŠtique par Rome. Le catholicisme occidental a d’ailleurs bĂŠnĂŠficiĂŠ de cette crise tant artistiquement, puisqu’elle est le lieu de refuge de certains artistes, qu’Ă titre honorifique, alors que Byzance se rĂŠtractait finalement de cet ĂŠlan iconoclaste en rĂŠtablissant solennellement le culte des images en 843. Cette crise est par ailleurs un premier exemple des rapports conflictuels entre Byzance et Rome ; elle prĂŠpare d’une certaine façon le schisme de 1054.
Le Moyen-Ăge voit se construire des ĂŠglises puis des cathĂŠdrales qui font suite aux premières basiliques issues des constructions romaines traditionnelles. Les scènes peintes sur leurs murs sont d’importance pour la transmission des rĂŠcits bibliques face Ă l’illĂŠtrisme. Par fresques entières sont reprĂŠsentĂŠs naĂŻvement les rĂŠcits des Ancien et Nouveau Testament dans les architectures romanes, premier art europĂŠen interprĂŠtĂŠ de façon diffĂŠrentes en fonction des zones gĂŠographiques. Autant l’art roman se caractĂŠrise par sa sobriĂŠtĂŠ, autant le gothique dĂŠveloppe la hauteur des bâtiments grâce Ă la voĂťte de pierre, et recherche une maximisation de la lumière. Ces bouleversements correspondent Ă des ĂŠvolutions techniques mais surtout Ă des ĂŠvolutions de mentalitĂŠs Ă partir du XIIIème. Les sculptures sont beaucoup plus prĂŠsentes, la nouveautĂŠ consistant en la fabrication de vitraux, surtout, ces reprĂŠsentations apparaissent plus torturĂŠes, avec, notamment, une forte prĂŠsence du Jugement Dernier. Ces reprĂŠsentations vont de paire avec un traumatisme croissant de la population par la Grande peste qui frappe au XIVème et tue près de la moitiĂŠ de la population europĂŠenne, et ĂŠgalement par la guerre de Cent ans, s’ajoutant aux diffĂŠrentes rĂŠvoltes paysannes du nord et de l’ouest europĂŠen durement rĂŠprimĂŠes.
L’ĂŠvolution permise par de nouveaux financements des artistes
La Renaissance, Ă partir de l’Italie et du Quattrocento fait ĂŠvoluer les styles, bouleverse les techniques, et surtout modifie les donnĂŠes financières de l’art. Les villes, lors des grands chantiers qui leur permettaient de se doter d’ĂŠglise ou de cathĂŠdrale, profitaient des dons de notables ou de corporations artisanales du bourg. Cette bourgeoisie s’affirme au fil des siècles ainsi que son influence financière. Par ailleurs, peintres, sculpteurs acquièrent le statut d’artiste, celui-ci remplaçant l’idĂŠe de simples artisans. Se dĂŠveloppent alors la pratique du mĂŠcĂŠnat et du système de protection des arts par la protection des artistes eux-mĂŞmes. On poursuit l’idĂŠe de valorisation de l’homme pour ses qualitĂŠs propres. Les premiers mĂŠcènes sont les membres du ClergĂŠ et les princes. Mais très vite des notables plus rĂŠcemment enrichit vont suivre le modèle de protecteur des arts. Peut-ĂŞtre de façon d’autant plus fervente qu’il tient Ă eux de s’installer sur l’ĂŠchiquier social. Les exemples se trouvent en Italie, avec la famille des MĂŠdicis, marchands et banquiers, initialement apothicaires, de Florence, qui ĂŠmerge au XVème siècle. Jusqu’au XVIIIème, elle jouera un rĂ´le primordial pour cette ville et la Toscane, mais elle aura aussi un impact politique et artistique europĂŠen. Au nord de l’Europe, les FĂźgger, drapiers au XIVème siècle, se tranforment en fins commerçants, et deviennent les banquiers des empereurs Habsbourg. Leur position politique acquise, ils s’affirment ĂŠgalement protecteurs des arts et collectionnent les oeuvres tout comme les MĂŠdicis Ă Florence.
Ces nouveaux collectionneurs sont demandeurs d’un renouvellement des sujets d’inspiration des artistes protĂŠgĂŠs. Si bien qu’en parallèle de ce qui restera la source d’inspiration unifiante, la religion, des thèmes artistiques profanes apparaissent alors.
L’art comme moyen d’imprimer une specificite
Au XVIIème siècle, la condition des artistes ĂŠvolue. Les peintres bĂŠnĂŠficient de commandes multiples, puisqu’elles s’ĂŠtendent des demandes de la part des ĂŠglises et couvents, aux commandes officielles de cours ou aux commandes individuelles de portraits. Le Titien, Le Tintoret, Velasquez, El Greco… vivent de leur art et bien que l’aura de leur oeuvre traverse les frontières, leur style sera identifiĂŠ Ă leur pays d’appartenance. Ainsi El Greco, influencĂŠ par le byzantinisme dans un premier temps, a-t-il ĂŠtĂŠ l’ĂŠlève du Titien avant de s’installer en Espagne. Les peintres, fort de leur succès, sont invitĂŠs Ă voyager Ă travers l’Europe. Les ĂŠcrivains, quant Ă eux, ne bĂŠnĂŠficient au mieux que d’une pension, et sont astreints Ă occuper des postes plus « alimentaires » s’ils ne sont protĂŠgĂŠs par quelques mĂŠcènes. Enfin, les musiciens ne doivent leur salut qu’Ă l’obtention de postes officiels tels que maĂŽtre de chapelle, organiste, premier violon…
La diversification du mĂŠcĂŠnat et une certaine auto-glorification.
Ă partir du XVIème siècle, le commerce se dĂŠveloppe vers des contrĂŠes nouvellement dĂŠcouvertes. L’AmĂŠrique permet d’enrichir fortement l’Europe en remplissant les caisses des rois de l’Espagne et du Portugal. Les multiplications d’expĂŠditions permettent non seulement l’exploration de nouveaux territoires, mais aussi le dĂŠveloppement des routes maritimes commerciales. Ces missions sont organisĂŠes par des compagnies de commerce et de navigation rassemblant les armateurs, et qui bĂŠnĂŠficient de droits et privilèges. Leur rĂ´le, in fine, n’est pas seulement commercial mais ĂŠgalement diplomatique et dispose d’un pouvoir militaire. Ce sont ces compagnies qui, les premières, organisent l’exploitation des nouveaux territoires. Ainsi, la Compagnie de la Nouvelle France, crĂŠĂŠe en 1627, dispose du territoire du Canada et le dĂŠveloppement attendu du commerce des fourrures implique une colonisation humaine. Des Compagnies privĂŠes anglaises mieux organisĂŠes vont dĂŠpasser celle-ci en Virginie ou dans le futur Massachusetts. En parallèle de ces organismes de transport, des comptoirs sont installĂŠs le long des cĂ´tes des diffĂŠrents continent. Les Flandres surtout voient ĂŠmerger les plus florissantes de ces compagnies. La Compagnie hollandaise des Indes occidentales, dispose du monopole commercial sur les cĂ´tes africaines et amĂŠricaines, ce qui sera Ă la base de la colonisation de la future Afrique du Sud ou encore de la crĂŠation de Neuwe Amsterdam future New York. La Compagnie hollandaise des Indes orientales, quant Ă elle, est en relation exclusive avec l’IndonĂŠsie pour le commerce des ĂŠpices. Ces compagnies monopolisantes s’enrichissent, dĂŠveloppent une première forme de capitalisme et permettent l’essor des ĂŠconomies nationales par leur effet dynamisant. Grâce Ă la dĂŠcouverte de la machine Ă vapeur, les capitaux dĂŠjĂ amassĂŠs, mais aussi l’ĂŠvolution des techniques agraires, la RĂŠvolution industrielle est amorcĂŠe Ă la fin du XVIIIème siècle Ă partir de l’Angleterre. La bourgeoisie s’impose comme nouvelle catĂŠgorie sociale dominante. Cet essor de la bourgeoisie a des rĂŠpercussions sur la production artistique alors qu’une nouvelle pratique de cabinets d’objet d’art se dĂŠveloppe au XVIème et XVIIème siècle parmi les collectionneurs. Ce nouvel espace des habitats cossus permet d’exposer ses possessions artistiques aussi bien que d’autres objets de curiositĂŠ. ÂŤ Chambre d’art et de merveilles Âť[13], le cabinet forme un microcosme de la contemplation, aĂŻeul du musĂŠe public. Mazarin, la reine Christine de Suède, ÂŤ Jabach le banquier Âť, directeur de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, sont de grands collectionneurs de peinture, mais la sculpture assure ĂŠgalement le succès de ses crĂŠateurs. Au grĂŠ des fortunes et des ruines, les oeuvres d’art passent entre les mains de diffĂŠrents collectionneurs, alors qu’un intĂŠrĂŞt se dĂŠcouvre ĂŠgalement pour les crĂŠations d’artistes morts. L’art devient une valeur en soi, et, le marchĂŠ se dĂŠplaçant du sud vers le nord de l’Europe, Anvers se transforme en premier marchĂŠ de l’art.
br>Politiquement, c’est avec Louis XIV que l’on voit s’imposer la bourgeoisie dans les dĂŠcisions nationales. Et ce alors que l’aristocratie française est confinĂŠe dans le palais de Versailles. Parallèlement celui-ci est le symbole de l’utilisation de l’art pour la mise en valeur nationale.
L’art comme revendication religieuse mais aussi politique
De la mĂŞme façon que le classicisme Ă travers Versailles est un enjeu politique, le baroque ĂŠtait le style d’un enjeu religieux. Apparu au XVIème siècle, il correspond Ă la nĂŠcessitĂŠ pour l’Ăglise catholique de manifester la splendeur divine, contrant la recherche d’austĂŠritĂŠ prĂ´nĂŠe par Luther et le mouvement de la RĂŠforme. En provenance de la pĂŠninsule ibĂŠrique, son exubĂŠrance se rĂŠpand Ă travers toute l’Europe dĂŠfensive de la catholicitĂŠ et se retrouve jusque dans les colonies d’AmĂŠrique latine. Saint Pierre de Rome, ĂŠglises des Flandres en sont les premiers exemples architecturaux, le mouvement suivi en Allemagne mĂŠridionale ou Autriche et Bohème, donne un nouvel essor Ă cette crĂŠativitĂŠ au XVIIème siècle. La peinture de la contre-RĂŠforme flamboie Ă travers les compositions dramatiques et triomphales du peintre flamand Rubens. Dans la musique, des compositeurs tels Monteverdi donnent une dimension passionnĂŠe Ă une musicalitĂŠ renouvelĂŠe avec des modulations enrichies. Le baroque correspond par ailleurs Ă l’ĂŠmergence de l’ordre des JĂŠsuites.
Versailles poursuit l’intĂŠrĂŞt pour l’architecture qui ĂŠtait apparu avec le style Baroque. Il devient un ĂŠlĂŠment dĂŠterminant dans la politique de prestige voulue par Louis XIV. AjoutĂŠ Ă un sens de la thÊâtralitĂŠ issu des cours espagnoles depuis Charles Quint, Versailles, dont les travaux dĂŠbutent en 1661, relève d’une volontĂŠ de dominer et garder autour du roi la cour, mais, surtout, d’imposer auprès des autres nations europĂŠennes la France comme nation prĂŠĂŠminente. Plaisir de l’oeil autant que dĂŠmonstration politique et ĂŠconomique, cette crĂŠation du plus pur classicisme français est imitĂŠe Ă travers l’Europe par ses souverains.
Ă partir du XIXème siècle, la revendication politique devient propre Ă certains artistes. On assiste alors Ă l’immixtion de l’artiste, de sa rĂŠflexion, dans son oeuvre. Dès le XVIIème, VĂŠlasquez donnait son propre regard posĂŠ sur les sujets reprĂŠsentĂŠs. Il n’hĂŠsitait pas Ă rompre avec les conventions de solennitĂŠ des portraits de cour, et se reprĂŠsentait dans l’oeuvre des MĂŠnines (1656), imposant par-lĂ mĂŞme une rĂŠflexion sur le problème complexe de la reprĂŠsentation qui implique le peintre, le modèle et le spectateur. Mais c’est avec Goya qu’ĂŠclate la volontĂŠ d’autonomie de l’artiste. L’inspiration du peintre est plus libre et il n’hĂŠsite pas Ă attaquer fĂŠrocement la bĂŞtise humaine Ă travers la deuxième partie de son oeuvre, alors mĂŞme que ses tableaux sont des portraits officiels. Sa sĂŠvĂŠritĂŠ vis-Ă -vis de la rĂŠalitĂŠ est contrebalancĂŠe par son approche tardive du fantastique. Proche des milieux intellectuels, Goya n’hĂŠsitera pas Ă proclamer son attachement nationaliste lors des insurrections espagnoles contre l’arrivĂŠe des armĂŠes napolĂŠoniennes (Le 2 mai, le 3 mai 1808), tout en dĂŠnonçant avec violence les atrocitĂŠs de la guerre par des eaux-fortes. Acte politique s’il en est, Goya critique ouvertement ses dirigeants et dĂŠnonce une occupation nationale. Se marque alors les dĂŠbuts de l’art moderne par la libertĂŠ et l’approche sociale de l’oeuvre de Goya. Par ailleurs, plus tard mais de la mĂŞme manière libre, le romantisme lui-mĂŞme s’attachera Ă diffĂŠrentes inspirations d’ordre nationaliste.
Signe ĂŠconomique, l’art permet l’ĂŠmergence concrète de la bourgeoisie Ă partir du XVIIIème siècle par la reprĂŠsentation de scènes bucoliques annonciatrices du romantisme avec Bouchet ou Fragonard. Cette lĂŠgèretĂŠ mĂŞlĂŠe Ă une certaine sensibilitĂŠ se retrouve de la mĂŞme façon dans un certain nombre d’oeuvres littĂŠraires faisant suite Ă la prĂŠciositĂŠ du XVIIème siècle, qui pourrait correspondre Ă l’esthĂŠtique baroque. PrĂŠmices du romantisme, cette lĂŠgèretĂŠ dans l’inspiration artistique ne met que mieux en valeur les idĂŠes nouvelles de ce siècle des Lumières philosophiques.
Enjeu religieux, signe politique, voire nationaliste, l’art se pose comme signe symbolique de la sociĂŠtĂŠ europĂŠenne dans son ensemble et de son ĂŠvolution au cours des siècles. Il rĂŠvèle une avancĂŠe parallèle des diffĂŠrents Ătats. Pourtant, ces derniers, bien que d’ĂŠvolution historique proches, multiplient au cours des siècles les spĂŠcificitĂŠs nationales.
_______________
Bien que ses positions soient Ă prendre avec circonspection, Paul ValĂŠry a apportĂŠ un intĂŠrĂŞt certain Ă la dĂŠfinition de l’Europe en constatant qu’: ÂŤ [ . . . ] aucune partie du monde n’a possĂŠdĂŠ cette singulière propriĂŠtĂŠ physique : le plus intense pouvoir ĂŠmissif uni au plus intense pouvoir absorbant Âť. Mis Ă part l’enthousiasme qui aurait tendance Ă favoriser chez l’auteur un certain ethnocentrisme, voire europĂŠocentrisme, force est de constater avec lui une certaine capacitĂŠ de ce continent, dans son histoire Ă s’enrichir des connaissances qu’il est amenĂŠ Ă rencontrer . Bien que cette histoire soit pour l’essentielle marquĂŠe de conflits et contradictions internes, elle a permis Ă l’Europe de former sa cohĂŠrente hĂŠtĂŠrogĂŠnĂŠitĂŠ. C’est en puisant aux sources les plus diverses que l’Europe a pu, et a su forger son identitĂŠ.
L’Europe a notamment beaucoup reçu des diffĂŠrentes strates ethniques qui se sont historiquement installĂŠes sur ce territoire faisant par lĂ mĂŞme ĂŠvoluer sa pensĂŠe et sa culture. En contradiction pourtant avec cette ĂŠvolution positive, on ne peut nier une capacitĂŠ ĂŠgalement dĂŠveloppĂŠe Ă l’opposĂŠ, celle du refus de l’autre et de sa mise en minoritĂŠ de façon tout aussi puissante que celle dĂŠveloppĂŠe pour l’absorption de l’autre.
Ces phĂŠnomènes ont, de toute façon, favorisĂŠ la formation, lente et inĂŠgale dans le temps, d’une ÂŤ communautĂŠ de destin Âť europĂŠenne.
Quant Ă la capacitĂŠ de s’exporter, lĂ encore le constat est ambigu. Ce qui fut un ensemble de colonies anglaises s’est transformĂŠ en Etats-Unis d’AmĂŠrique, au dĂŠtriment des autochtones amĂŠrindiens, par un transfert de populations avec leurs spĂŠcificitĂŠs au delĂ de l’OcĂŠan Atlantique.
Deux leçons historiques se retrouvent là . La culture europÊenne a forcÊ sa transmission par le biais des colonies, au mÊpris des cultures rencontrÊes, considÊrÊes comme infÊrieures. Mais cette allusion aux Etats-Unis nous met face à un autre problème, celui de diffÊrencier la culture europÊenne de la civilisation occidentale.
L’Europe n’a un avenir qu’Ă ces deux conditions, la mise en valeur d’une spĂŠcificitĂŠ culturelle europĂŠenne, et surtout une capacitĂŠ au dialogue, forte de sa diffĂŠrence face Ă un gĂŠant tel que les Etats-Unis.
Eglise, Etat, Famille, ont chacun une part de responsabilitĂŠ, en tant qu’acteurs sociaux des sociĂŠtĂŠs europĂŠennes, dans son ĂŠvolution au cours des quatre pĂŠriodes historiques de l’Europe. Ces pĂŠriodes sont l’AntiquitĂŠ, le Moyen-Ăge, les Temps Modernes et la pĂŠriode contemporaine. Chaque pĂŠriode, par le jeu des institutions et des acteurs sociaux, contient les prĂŠmices de centrifugation des europĂŠens dans le temps unitaire, et rĂŠciproquement des efforts centripètes dans les moments conflictuels. Pourtant, il existe une pĂŠriode historique au cours de laquelle on peut observer une identitĂŠ culturelle europĂŠenne, en reconnaissant le rĂ´le que la religion chrĂŠtienne, de par la cosmogonie qu’elle implique y a tenu.
De fait, le Moyen-Ăge, en suivant Jacques Le Goff, a sans doute ĂŠtĂŠ une pĂŠriode bĂŠnie dans l’histoire de l’Europe pour l’ĂŠmergence de son identitĂŠ culturelle. PĂŠriode d’unitĂŠ linguistique et religieuse oĂš la fĂŠodalitĂŠ, dĂŠsorganisation politique en comparaison de nos systèmes politiques qualifiĂŠs de lĂŠgalo-rĂŠgaliens par Max Weber, permet de valider l’idĂŠe d’une richesse culturelle dans le dĂŠtail.
La cohĂŠrence de l’Europe apparaĂŽt par le biais de systèmes transversaux aux Etats-nations. CohĂŠrence des rĂŠseaux interuniversitaires, mais aussi de systèmes politiques Ă petite ĂŠchelle.
Cette constatation est Ă mettre en rapport avec le dĂŠveloppement des connections entre universitĂŠs aujourd’hui. Un dĂŠveloppement certainement tardif par rapport Ă la prioritĂŠ qui a ĂŠtĂŠ donnĂŠe Ă l’ĂŠconomique lors du dĂŠveloppement de la CommunautĂŠ EuropĂŠenne; choix qui aurait ĂŠtĂŠ regrettĂŠ par Jean Monnet, qui dĂŠclarait « S’il fallait tout recommencer, je commencerais par la culture ». Des programmes tels qu’ Erasmus – parmi les plus connus – sont en effet des occasions de rencontres d’ĂŠtudiants, mais aussi de mise en rapport d’enseignements et de confrontations de systèmes de fonctionnement.
De la mĂŞme manière, on peut regretter la limitation des ĂŠchanges entre villes jumelĂŠes Ă un nombre relativement faible d’opĂŠrations. Mais c’est lĂ sans doute un domaine qui rejoint l’Europe des rĂŠgions autre sujet de questionnements pour les dĂŠcideurs de l’Europe[14].
L’Europe est diverse, et il convient de la considĂŠrer comme telle. Son histoire suit le mĂŞme parcours global, mais elle laisse apparaĂŽtre une multiplicitĂŠ qui fait sa richesse. C’est par la transmission et l’acceptation de cette particularitĂŠ culturelle que l’Union EuropĂŠenne avancera auprès des populations concernĂŠes.
Johanna O’BYRNE
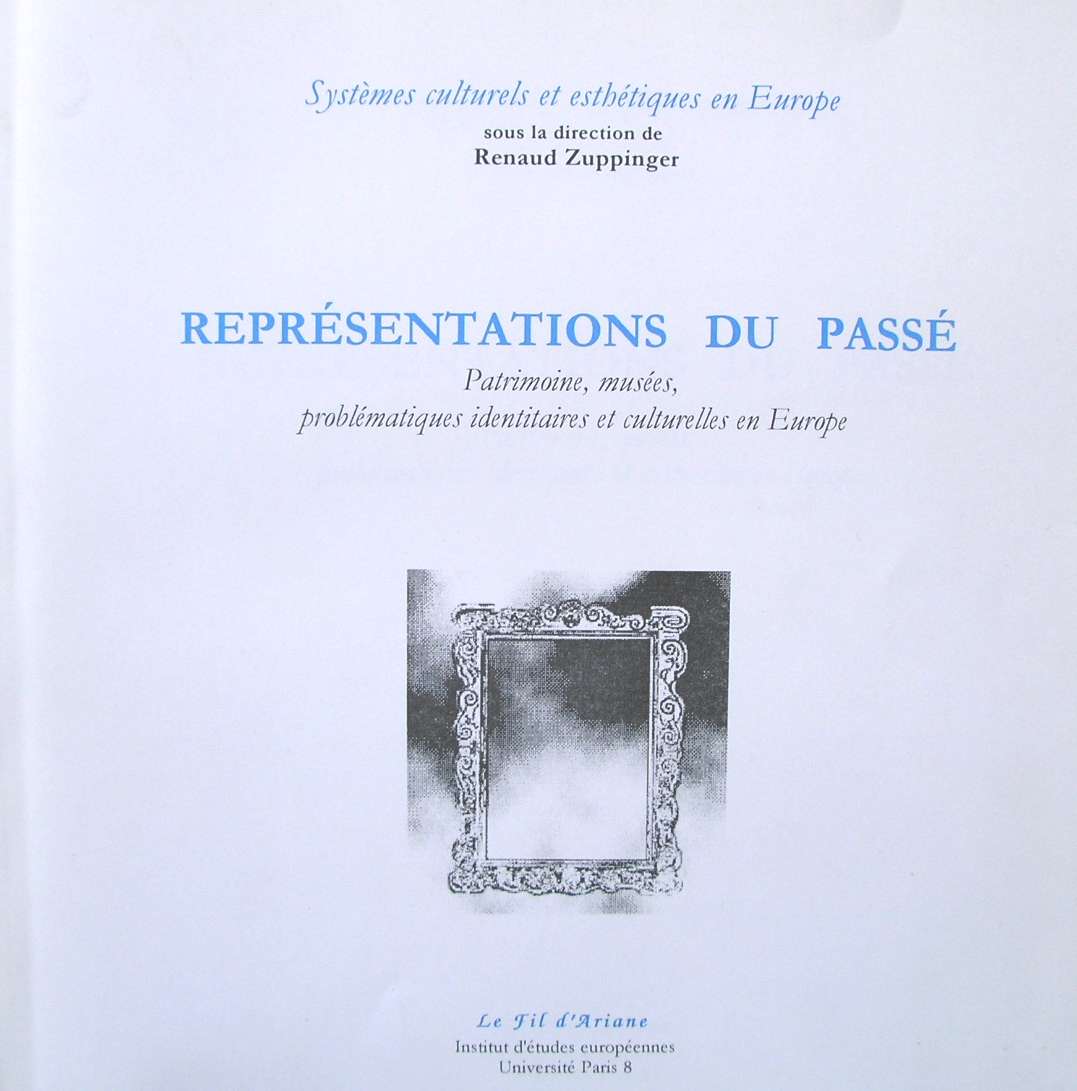

 mythe-imaginaire-sociĂŠtĂŠ
-
mythe-imaginaire-sociĂŠtĂŠ
-