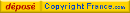Astrid ROSTAING
L’irrûˋvûˋrence dans l’art contemporain : un systû´me esthûˋtique ?
Introduction
Selon les cas, lãart contemporain peut susciter passion, perplexitûˋ, intûˋrûˆt, mûˋpris. Depuis le dûˋbut des annûˋes 1990, on assiste û nombre de dûˋbats et forums ayant pour thû´mes « Oû¿ va lãart ? », ou encore « Tout lãart contemporain est-il nul ? ».
Ainsi lãart contemporain est-il en crise. Jamais il nãy a eu autant de diffûˋrends au sujet de la reprûˋsentation de lãart. Les polûˋmiques, entourant la lûˋgitimitûˋ de lãart contemporain, tournent au jeu dãinvectives. Les uns parlent dãun art « officiel », les autres dãun art rûˋtrograde et dûˋpassûˋ, mais tous sãinterrogent sur la faûÏon dont se fixe la valeur des éuvres contemporaines. De fait on ne peut plus se rûˋfûˋrer aux critû´res esthûˋtiques traditionnels afin dãanalyser, reconnaûÛtre et qualifier lãart contemporain. û tel point quãon tend û dûˋplorer la mort de lãart. On sãaperûÏoit û ce propos quãen fait, lãart contemporain semble exister û travers le « discours sur », cãest-û -dire û travers un terrorisme intellectuel persistant rûˋvûˋlant que finalement ce qui est en crise est le discours sur lãart contemporain et non lãart contemporain seul. En effet, malgrûˋ les rumeurs concernant la disparition de lãart, les peintres peignent, les sculpteurs sculptent, les installateurs installent et les concepteurs conûÏoivent. Il reste quãaujourdãhui lãart est pluriel et de ce pluralisme dûˋcoulent des difficultûˋs en matiû´re dãesthûˋtique. Il sãagit donc ici de relancer le dûˋbat sur lãart contemporain, de lãenrichir sans prûˋtendre y mettre un terme, en se concentrant sur un axe commun, un aspect qui, malgrûˋ leur pluralisme, rassemble les éuvres contemporaines entre elles : lãirrûˋvûˋrence.
Procûˋdons û une dûˋfinition des termes utilisûˋs. Par art contemporain, son nom lãindique et lãexpression « histoire contemporaine » le dit, on entend dãabord lãart du moment, quelle que soit sa forme, et que celle-ci prûˋtende û la nouveautûˋ ou y renonce. Dans le domaine de lãart, au contraire, lãadjectif « contemporain » vient spûˋcifier lãart qui û la fois hûˋrite de la tradition dite classique (en tant quãexpression de la culture cultivûˋe) et rompt avec elle par diffûˋrentes mises en cause de sa dûˋfinition. Cette nouvelle direction est apparue dû´s lãaprû´s seconde guerre mondiale avec comme prûˋcurseur Marcel Duchamp. Aujourdãhui, cette catûˋgorie des arts visuels repose sur la transgression systûˋmatique des critû´res artistiques, propres aussi bien û la tradition classique quãû la tradition moderne mais aussi contemporaine. En outre, lãart contemporain repose essentiellement sur lãexpûˋrimentation de toutes les formes de rupture, de mise û distance avec ce qui prûˋcû´de. Lãart contemporain ne signifie donc pas forcûˋment art actuel, ou art dãaujourdãhui. Nûˋanmoins, je parlerai ici de lãart contemporain dans sa forme actuelle.
Lãesthûˋtique, en tant que rûˋflexion philosophique sur lãart et sur les relations que lãhomme entretient avec les éuvres, est bousculûˋe par ce dûˋtachement persistant que reprûˋsente lãart contemporain. En effet, comment rûˋpondre aux questions telles : « Quãest-ce que lãart ? Quand y a-t-il art ? Comment juger de lãart ? » face û un art qui a pour principe lãinvestissement de voies inûˋdites et la pûˋremption de ce qui les prûˋcû´de.
Lãirrûˋvûˋrence est synonyme dãirrespect, rûˋvolte, curiositûˋ, doute, libertûˋ, rire, ironie, cãest-û -dire de toutes les expressions de lãesprit de distance. Par irrûˋvûˋrence, on entend « ne se suffire de rien », « se dissocier », « se rûˋapproprier ». Au lieu de vivre le monde, les acteurs dãirrûˋvûˋrence le mettent û distance, le dûˋmystifient, le nient ou le dûˋnigrent. Ils se nourrissent de questions et non de rûˋponses. Ils privilûˋgient le dûˋsir de connaissance contre le dûˋsir de sûˋcuritûˋ, lãinquiûˋtude contre la paix de lãesprit. Ils aperûÏoivent en face dãeux un monde qui sãabandonne, et ils sãen retirent, le dûˋfinissent comme un objet, lãanalysent, le critiquent, en dûˋgagent les contradictions, et cherchent û le changer. Ainsi lãirrûˋvûˋrence apparaûÛt-elle comme le principe fondateur de lãart contemporain, comme ce qui le spûˋcifie. Mais est-elle un critû´re esthûˋtique ? Est-ce vûˋritablement ce qui va donner de la valeur û lãart contemporain ?
Lãirrûˋvûˋrence reprûˋsente par consûˋquent un moyen de questionner lãart contemporain au regard de lãesthûˋtique : est-elle ce qui discrûˋdite lãart contemporain ? Est-elle ce qui lui donne sens ? Lãirrûˋvûˋrence permet-elle de renouer lãart contemporain û la rûˋflexion esthûˋtique, et non û une analyse discursive incessante et absurde ? Avant dãaborder la question de lãesthûˋtique contemporaine et des interrogations quãelle soulû´ve, il semble tout dãabord judicieux de prûˋsenter les positions du dûˋbat sur lãirrûˋvûˋrence dans lãart contemporain, avec, dãun cûÇtûˋ, ses dûˋtracteurs considûˋrant que lãirrûˋvûˋrence disqualifie lãart contemporain ; de lãautre, ses dûˋfenseurs qui soutiennent lãirrûˋvûˋrence comme systû´me lûˋgitimant lãart contemporain.
Lãirrûˋvûˋrence comme discrûˋdit de lãart contemporain
Lãart contemporain ne se rûˋfû´re ni û la perfection dãun mûˋtier, comme dans lãart classique, ni û la dûˋcouverte de beautûˋs nouvelles, comme dans lãart moderne. Pour ses dûˋtracteurs, cette conception de la crûˋation est fondûˋe seulement sur lãextase narcissique et le rejet de toute exigence. Les artistes contemporains travailleraient donc sur ce quãil y a de plus incongru, tel, le dûˋchet, lãabject, le dûˋgoû£t ou encore le porno, et rûˋutiliseraient ce qui a dûˋjû ûˋtûˋ fait, par simple provocation ou parce quãils considû´rent ûˆtre arrivûˋs au bout de toutes les possibilitûˋs. Cãest ainsi quãapparaissent diffûˋrentes formes dãirrûˋvûˋrence (lãirrûˋvûˋrence envers le public, ou encore lãirrûˋvûˋrence envers les institutions telle la religion) qui, selon ses dûˋtracteurs, renferment chacune une initiation û la nullitûˋ. Non seulement les artistes travaillent sur du rûˋsidu, du rien, mais ils revendiquent la banalitûˋ et lãinsignifiance. En outre, la pensûˋe dominante et « politiquement correcte » semble ûˆtre: « Je parle le dûˋchet, je transcris la nullitûˋ ». Cet art contemporain, aussi controversûˋ soit-il, est en effet profondûˋment soutenu par lãûtat et la majeure partie du monde de lãart.
Jean Baudrillard : « C’est û la fois la mode et le discours mondain de lãart, et les artistes travaillent dans un monde qui en effet est peut-ûˆtre devenu insignifiant mais ils le font dãune faûÏon insignifiante aussi, ce qui est ennuyeux. »
Parmi les éuvres dûˋroutantes et choquantes û lãûˋgard du public, on trouve celles de Damien Hirst qui reprûˋsentent des animaux morts placûˋs dans des aquariums remplis de formol ; ou une de Kiki Smith composûˋe dãune sûˋrie de grosses bouteilles en verre argentûˋ avec des ûˋtiquettes sur lesquelles on peut lire : « vomi, salive, sperme, sang, diarrhûˋe, pus, lait, larmes ». Lãirrûˋvûˋrence envers les institutions peut ûˆtre relevûˋe dans les éuvres les plus rûˋcentes de Gilbert et George qui, utilisant une imagerie multiculturelle dãemblû´mes religieux et superstitieux, exposent les symboliques de lãislam, du catholicisme, du judaû₤sme, de la franc-maûÏonnerie cûÇte û cûÇte avec des amulettes folkloriques, des fers û cheval, des mûˋdailles de priû´re ou encore des lutins.
Par ailleurs, lãart est devenu citation, rûˋappropriation, et donne lãimpression dãune rûˋanimation indûˋfinie de ses propres formes. La plupart des artistes travaillent aujourdãhui dans un systû´me perpûˋtuel consistant û refaire ce qui a ûˋtûˋ fait, û remixer les formes passûˋes. Cãest le cas de Wim Delvoye qui, en utilisant un urinoir surmontûˋ de la photo du roi de Belgique, peut ûˆtre considûˋrûˋ comme faisant preuve dãirrûˋvûˋrence envers lã « art-institution », cãest-û -dire notamment envers le ready-made de Marcel Duchamp. Selon les dûˋtracteurs, cet art de la rûˋappropriation nãest plus û proprement parler de lãart. Ils dûˋnoncent un territoire de lãart post-Duchamp anesthûˋsiûˋ et dûˋsensibilisûˋ qui sãest dûˋveloppûˋ û la faveur des institutions franûÏaises et internationales. Il sãagit, selon eux, dãun art du contenant plutûÇt que du contenu, un art de la dûˋrision de lãart, un art du mûˋpris de lãart, un art de ceux qui revendiquent le non-sens pour mieux cacher leur incapacitûˋ û saisir le sens.
Pierre Souchaud : « Un espace de vide ûˋthique, esthûˋtique, juridique, oû¿ tout ce qui est faux, honteux, odieux, absurde, disqualifiant et dûˋshonorant dans tout autre domaine de la vie sociale, deviendrait miraculeusement ici, objet de culte, de promotion, de publicitûˋ, de reconnaissance, de commerce, dãenjeu culturel majeur. »
Les ûˋlites sãenthousiasment pour les crûˋations obscures quãils considû´rent comme signes de progressisme. En outre, rien nãest demandûˋ û lãartiste que lãaffirmation de lui-mûˆme, transformant sa personne mûˆme en éuvre dãart. Les dûˋtracteurs de lãirrûˋvûˋrence dans lãart contemporain dûˋnoncent û cet ûˋgard un art prûˋtentieux qui exclut le public. Car, selon eux, les arts plastiques ne sont pas la manifestation dãun gûˋnie surgissant on ne sait pourquoi. Cãest lãapprentissage, le rûˋsultat dãun certain nombre de techniques permettant de sãexprimer de la faûÏon la plus cohûˋrente et la plus puissante qui soit.
Jean Clair : « Je ne vois pas pourquoi on refuse aux arts plastiques les idûˋes de mûˋtier et de maûÛtrise, que lãon accepte tout û fait spontanûˋment dans dãautres domaines du savoir et de la crûˋation, le cinûˋma par exemple. »
En effet, selon les dûˋtracteurs, lãûtat admet que lãart ne soit quãune expression de lãindividu dans la sociûˋtûˋ. Ainsi une maladie mortelle, une fausse-couche, un album de photos de famille peuvent-ils accûˋder û lãûˋternitûˋ esthûˋtique sans passer par lãexigence de la sublimation et de lãimagination. En outre, lãexhibitionniste conceptuel, ou encore le compositeur de bruit pour rien prûˋtendent expliquer chaque ûˋtape de leur travail. Mais en fait le conservatisme auquel ils croient sãopposer demeure utile pour oublier que cette irrûˋvûˋrence, vidûˋe de toute substance, ne cherche finalement quãû se conserver elle-mûˆme, et donc û ne pas ûˋvoluer.
BenoûÛt Duteurtre : « Leur art nãest pas censurûˋ par le pouvoir et interdit aux foules ; il est encensûˋ par le pouvoir et il ennuie les foules. »
Lãirrûˋvûˋrence comme lûˋgitimation de lãart contemporain
Si cet art semble ûˋloignûˋ du public, ce nãest, dãaprû´s les dûˋfenseurs de lãart contemporain irrûˋvûˋrencieux, quãen apparence. En effet, cet art est, selon eux, profondûˋment concernûˋ par le public dans la mesure oû¿ il lãaide et lãincite û prendre du recul sur la sociûˋtûˋ, qui lãinquiû´te et le dûˋboussole, afin de mieux la critiquer. En ce sens, les dûˋfenseurs prûÇnent lãidûˋe de choquer pour rûˋsister, et lãutilisation de la bûˆtise, de lãironie pour susciter des rûˋactions. » Irrûˋvûˋrer » les institutions, les politiques ; se dûˋfaire, se dissocier, le dûˋtachement permettant ensuite lãappropriation. Cãest ainsi que lãirrûˋvûˋrence joue comme dûˋmystification, comme piraterie ou dûˋtournement dãéuvres dûˋjû existantes, dûˋconstruisant ainsi le mythe conformiste de lãoriginalitûˋ qui sûˋvit dans le monde actuel. û cet ûˋgard, la rûˋappropriation de lãart-institution ne serait pas un mûˋpris de lãart, comme le pensent nombre de dûˋtracteurs, mais bien plutûÇt un hommage, un geste artistique liûˋ û la notion de rûˋfûˋrence. Ces deux types dãirrûˋvûˋrence (lãirrûˋvûˋrence comme rûˋvolte envers la sociûˋtûˋ, les institutions, et lãirrûˋvûˋrence comme dûˋmystification) peuvent ûˆtre relevûˋs dans lãoeuvre de Martin Kippenberger qui traite sans pitiûˋ des thû´mes politiques datant de la Guerre Froide; critique la petite bourgeoisie ; et dûˋlû´gue lãacte de peindre û dãautres, dûˋmantelant ainsi le mythe de lãauthenticitûˋ dans lãart. Cãest ûˋgalement le cas de lãartiste Banksy qui dûˋtourne les symboles de la royautûˋ britannique ; inscrit sur des monuments cûˋlû´bres : « ceci ne vaut pas la peine dãûˆtre photographiûˋ » ; accroche une de ses éuvres dans des grands musûˋes nationaux tels que le Louvre ou le MOMA de New York ; et rûˋcupû´re des éuvres cûˋlû´bres tel le jardin de Giverny (ûtang aux nymphûˋas, harmonie verte) de Claude Monet dans lequel il ajoute des caddies.
Pour le dûˋtracteur, Kostas Mavrakis, cette conception de lãart actuel est le rûˋsultat dãun « cycle ouvert au dûˋbut du XXû´me siû´cle par lãexplosion de nihilisme que reprûˋsentaient lãabstraction, le cubisme, le futurisme, le dadaû₤sme ». Il regroupe ainsi dans les mûˆmes concepts fourre-tout plusieurs gûˋnûˋrations de type dãart. Que lãurinoir de Duchamp et le monochrome de Malevitch aient acquis une pleine reconnaissance esthûˋtique, et quãil existe depuis un quart de siû´cle un acadûˋmisme en faveur du contemporain, on ne peut en douter. Mais, pour les dûˋfenseurs de lãart contemporain, ces ûˋvidences nãautorisent pas û prononcer des dûˋnonciations rûˋtrospectives si gûˋnûˋrales quãelles nãont plus aucun sens, plus aucune portûˋe.
Philippe Dagen : « Ces condamnations relû´vent de lãincantation ou de la dûˋploration, pas de lãanalyse historique. Cãest lû le point trû´s faible de ces discours : leurs auteurs ne vont pas au-delû de la plainte ou de lãinsulte. Ils fuient le pourquoi. »
Ainsi lãirrûˋvûˋrence serait-elle ûˋgalement la manifestation dãune colû´re face û une ûˋpoque incroyablement vidûˋe, nûˋantisûˋe par la surenchû´re dãimages et de cadavres mûˋdiatiques. Il sãagit alors, selon ses dûˋfenseurs, dãaffirmer quãûˆtre contemporain, cãest non seulement sãinscrire dans une distance mais aussi et forcûˋment se placer û lãavant-poste de lãhistoire, pour la libertûˋ. Ce qui est nommûˋ lãirrûˋvûˋrent serait donc la manifestation sensible de ce travail de rûˋvolution, dûˋmolition, ûˋcart, et « rûˋflexion sur ».
Pour les dûˋfenseurs, il est nûˋcessaire dãaffirmer quãil est bien plus irrûˋvûˋrent, rûˋvoltant, fin de lãart, de sãen tenir û la beautûˋ ancienne, immobile, et contemplûˋe. Selon eux, la rûˋaction contre le nouveau et le diffûˋrent est toujours la mûˆme. Et avoir beau ûˆtre pour ou contre, on nãy change rien : le mouvement, la fuite en avant existe. Les mûˋtamorphoses de lãart, ses transformations et adaptations, entravûˋes par les obstacles de la rûˋaction, sont inûˋvitables. Lãirrûˋvûˋrence apparaûÛtrait alors comme forme esthûˋtique, comme maniû´re contemporaine de lãexpression dans ce monde, maniû´re dãavoir prise sur lui. En ce sens, lãirrûˋvûˋrence serait un moyen, si ce nãest le seul, de faire avancer lãart aujourdãhui.
Si les positions sont aussi tranchûˋes, cãest que le public et le monde de lãart sont dûˋpourvus de critû´res esthûˋtiques pour qualifier tous les paradigmes de lãart contemporain. Dãoû¿ la « crise de lãart contemporain ». Lãirrûˋvûˋrence ûˋtant ce qui spûˋcifie le mieux lãart contemporain, il paraûÛt donc utile de se poser la question de savoir si lãon peut trouver, û travers elle, un systû´me esthûˋtique de lãart contemporain, ou bien si lãirrûˋvûˋrence est ce qui empûˆche une esthûˋtique contemporaine de fonctionner. En dãautres termes, lãirrûˋvûˋrence dãune oeuvre peut-elle permettre de dire si oui ou non telle éuvre est de lãart ou non ? Pour tenter dãy rûˋpondre, il semble nûˋcessaire dãaborder les questions que soulû´ve lãesthûˋtique contemporaine, avant dãûˋlaborer des propositions.
Tendances et enjeux de lãesthûˋtique contemporaine
Il nãy a plus aujourdãhui une seule dûˋfinition de ce que sont ou doivent ûˆtre les arts plastiques, mais plusieurs. Les diffûˋrentes faûÏons de faire lãart ne sãûˋchelonnent plus sur un axe unique, hiûˋrarchisûˋes entre pûÇle infûˋrieur et supûˋrieur, mais sur plusieurs axes. Les querelles nãengagent plus seulement, dû´s lors, des questions esthûˋtiques dãûˋvaluation (cãest plus ou moins « beau » ou « bien fait ») et de goû£t (on « aime » plus ou moins), mais des questions cognitives de classification (cãest ou ce nãest pas de lãart ; cãest de lãart « authentique » ou de la « foutaise », du « nãimporte quoi ») et dãintûˋgration/exclusion (on accepte ou non telle proposition au titre dãéuvre dãart ; on subventionne ou non telle ou telle proposition).
Par ailleurs, la difficultûˋ û accepter lãart contemporain est dãautant plus difficile que celui-ci tend û dûˋplacer sa valeur artistique vers lãensemble des mûˋdiations entre lãartiste et le spectateur. Rûˋcit de la fabrication de lãéuvre, lûˋgendes biographiques, discours entourant lãéuvre contribuent ainsi tout autant, sinon plus, û faire lãéuvre, que la matûˋrialitûˋ mûˆme de lãobjet. On peut donc û juste titre parler aussi dãune « crise de lãesthûˋtique contemporaine ».
La philosophie analytique de lãart, dãinspiration anglo-saxonne, apparaûÛt dans les annûˋes 1990 comme tentative de rûˋponse û cette crise. Elle regroupe un ensemble de thûˋories qui renoncent û dûˋfinir lãessence de lãart et privilûˋgient la description des éuvres. Tout dãabord, la « thûˋorie des symboles » de Nelson Goodman qui consiste û substituer û la question classique de lãesthûˋtique, « Quãest-ce que lãart ? », une question plus fondamentale, selon lui : « Quand y a-t-il art ? ». Cãest-û -dire, quand peut-on dire dãune chose quãelle fonctionne symboliquement comme éuvre dãart, sachant quãelle peut fonctionner û certains moments comme éuvre dãart et pas û dãautres ? Cette faûÏon de raisonner peut sãappliquer pour les ready-mades qui fonctionnent comme éuvre dãart par lãintermûˋdiaire de la galerie ou du catalogue dãexposition. Cependant, si un tableau de Rembrandt cesse dãexister comme éuvre dãart lorsquãil est utilisûˋ pour boucher une vitre cassûˋe, il nãen demeure pas moins un chef dãéuvre.
Lãidûˋe de la « thûˋorie institutionnelle de lãart » de George Dickie est quãun monde de lãart, ou une institution (comprenant artistes, philosophes de lãart, historiens dãart, critiques dãart, amateurs avertis) est nûˋcessaire pour confûˋrer û un objet le statut dãéuvre dãart. Mais il y a des inconvûˋnients : en « acceptant » lãobjet, lãinstitution dûˋsamorce sa force subversive ; la lûˋgitimitûˋ de ce « monde de lãart » pose problû´me ; on assiste û un effet de cercle : cãest lãinstitution qui fait lãéuvre, mais cãest aussi lãéuvre qui fait lãinstitution ; il existe un risque de conformisme rûˋsultant dãune application stricte des conventions de lãinstitution qui tendrait û exclure une grande partie de lãart contemporain, notamment les artistes rebelles û toute classification.
Arthur Danto tente dãanalyser ce qui transfigure la banalitûˋ en éuvre dãart. Selon lui, seuls les initiûˋs, experts, marchands dãart, collectionneurs, critiques sont capables dãidentifier ce que le regard ne perûÏoit pas immûˋdiatement. Mais Danto est victime dãun cercle vicieux : pour pouvoir reconnaûÛtre, sur un plan esthûˋtique, la diffûˋrence dãidentitûˋ entre un objet banal et une éuvre dãart, il faut dûˋjû quãon sache faire la diffûˋrence entre ce qui est de lãart et ce qui nãen est pas. En outre, il dûˋlû´gue au monde de lãart le soin de livrer la seule interprûˋtation valide dãune éuvre, renforûÏant de la sorte la frontiû´re qui sûˋpare une ûˋlite, compûˋtente et informûˋe, et le public profane.
Gûˋrard Genette prûˋcise la question « Quand y a-t-il art ? » en ajoutant que le principal est de savoir quand un objet est reûÏu par « moi », cãest-û -dire par un sujet, comme éuvre dãart. Seul le sujet est capable dãapprûˋcier, de faûÏon positive ou nûˋgative, si telle éuvre, ou tel aspect dãune éuvre lui plaûÛt ou lui dûˋplaûÛt au moment oû¿ il la voit. En outre, lãhistoire de lãart est alors conûÏue comme ûˋtude objective des processus dãinnovation artistique. Le mûˋrite dãune telle conception est de libûˋrer lãesthûˋtique des apprûˋciations douteuses et des interprûˋtations contradictoires. Mais on ne peut faire abstraction et enrayer les dûˋbats critiques et nûˋcessairement ûˋvaluatifs sur une éuvre.
Yves Michaud prûÇne des « esthûˋtiques du pluralisme », adaptûˋs û la diversitûˋ artistique actuelle. Selon lui, chacun est libre dãaimer ou de dûˋtester ce que bon lui semble dans une totale indiffûˋrence envers les jugements et les prûˋfûˋrences dãautrui. Mais un tel relativisme esthûˋtique, qui affirme quãon ne peut disputer des goû£ts et des couleurs, est prûˋcisûˋment ce que Kant a tentûˋ de surmonter. La thûˋorie de Michaud tend ainsi û oublier que la naissance de lãesthûˋtique au XVIIIû´me siû´cle impliquait une « triple conquûˆte », celle du sujet autonome (regard du spectateur), celle de lãesprit critique et celle de lãespace public (jugement de goû£t prûˋtendant û lãuniversalitûˋ).
û lãheure actuelle, aucune thûˋorie esthûˋtique ne semble donc pouvoir rûˋsoudre la crise de lûˋgitimation de lãart contemporain. Pourtant on ne saurait conclure û une disqualification de lãart actuel dans ce quãil a dãirrûˋvûˋrent. Si lãart contemporain fait preuve de pluralisme, de rupture et dãûˋvolution, il devrait en ûˆtre de mûˆme avec lãesthûˋtique. En sãefforûÏant de trouver dãautres rûˋponses, aussi multiples et complexes soient-elles, celle-ci en ressortirait dãautant plus grandie et en phase avec le contemporain quãelle aura rûˋflûˋchi sur ce qui finalement semble ûˆtre la cause de la crise de lãart contemporain : lãirrûˋvûˋrence. Ainsi, pour tenter de rûˋpondre û la question de savoir si lãirrûˋvûˋrence est une ingûˋrence ou un systû´me esthûˋtique û part entiû´re, il sãagit de lever le voile sur les paradoxes, et de sãinterroger encore davantage afin dãenrichir au mieux le dûˋbat.
Lãirrûˋvûˋrence : ingûˋrence ou systû´me esthûˋtique û part entiû´re
Si lãirrûˋvûˋrence se veut une rûˋvolte envers les institutions ou acadûˋmismes en gûˋnûˋral, il nãen demeure pas moins quãaujourdãhui cet anti-acadûˋmisme est, pour la majeure partie, plûˋbiscitûˋ par les institutions et le monde de lãart. La pensûˋe artistique dominante est pour cet art contemporain, dans ce quãil a dãirrûˋvûˋrent.
Nathalie Heinich : « Tout se passe finalement comme si lãaide institutionnelle û lãart contemporain instaurait une sorte de « paradoxe permissif », permettant aux artistes dãûˆtre hors normes en normalisant cette transgression des normes. »
De fait, la crûˋation artistique jouit aujourdãhui de conditions favorables. De nombreuses institutions, dûˋfinies par leur esprit rigoureusement « non acadûˋmique », sont û lãûˋcoute des artistes, et organisûˋes pour les soutenir. Lãûtat, les collectivitûˋs locales, les entreprises publiques et privûˋes « aiment » lãart. Tout ce qui est anti-acadûˋmique a droit de parole.
BenoûÛt Duteurtre : « Lã ãanti-acadûˋmisme acadûˋmisûˋã est, de fait, le principe qui prûˋside, depuis prû´s dãun demi-siû´cle, û la production et la consommation artistique, en France comme dans la plus grande partie de lãEurope occidentale. »
En fait, notre ûˋpoque semble mettre au 1er rang de ses prûˋoccupations le statut de lãart plutûÇt que lãart lui-mûˆme. En outre, le vûˋritable inconvûˋnient est que, sû£re de ses choix, la sociûˋtûˋ passe allû´grement û cûÇte de tout ce qui nãentre pas dans ses tiroirs. Avec ce vaste interventionnisme dãûtat, on assiste en effet û une montûˋe de conformismes dans lãart contemporain (conformisme de libertûˋ, dãindûˋpendance, dãoriginalitûˋ) qui tendent û exclure une grande partie de cet art, notamment les artistes rebelles û toute classification et toute ûˋtiquette, et qui sont finalement peut-ûˆtre les plus intûˋressants car les plus intû´gres. û tel point que cette culture institutionnelle est considûˋrûˋe comme instaurant une fausse subversion de lãart contemporain.
Cependant, il va de soi que lãaide de lãûtat est indispensable pour faire reconnaûÛtre les oeuvres et leurs artistes, par consûˋquent pour faire vivre lãart. En outre, il est difficile pour les institutions, et le monde de lãart, de choisir des oeuvres sans tomber dans des conformismes. Cãest tout le problû´me de lãhistoire contemporaine qui ne permet pas de prendre du recul avant dãopter pour telle ou telle dûˋcision. Il faudrait donc aspirer û un systû´me institutionnel qui sãouvre sur toutes les facettes de lãart contemporain, y compris les plus rebelles, sans contraindre ces derniû´res û « entrer dans le moule », mais en leur proposant leurs services de communication, de reconnaissance publiques. En outre, il sãagit dãûˆtre ouvert û toute forme dãart actuel irrûˋvûˋrencieux sans pour autant tout accepter, et de prendre en compte le regard du public. Cãest lû quãinterviennent les historiens, philosophes, et critiques dãart qui, û travers leur jugement de goû£t, de diffûˋrenciation, et dãûˋvaluation esthûˋtiques, devraient ûˆtre lû non seulement pour ûˋviter tout risque de conformisme mais aussi pour guider le public.
Aujourdãhui, de nombreux acteurs du monde de lãart dûˋplorent en effet lãabsence rûˋelle de mûˋdiation entre lãartiste, lãéuvre et le public. Les controverses sur la validitûˋ de lãart contemporain, les critû´res dãûˋvaluation esthûˋtique et le rûÇle de lãûtat, ont omis, pour la plupart, de se pencher sur la qualitûˋ des rûˋalisations, en donnant lãimpression que lãon pouvait parler dãart et des artistes sans parler des éuvres elles-mûˆmes.
Ainsi la critique dãart tend-elle û se dûˋtourner de lãanalyse des éuvres proprement dites. Nicolas Bourriaud, ancien codirecteur du Palais de Tokyo, ripostant dans Beaux Arts magazine aux critiques dãart de deux journalistes de Libûˋration : « Comment descendre une exposition collective sans ûˋvoquer les éuvres dãart qui la composent ?(ãÎ) le discours des critiques, adaptûˋ tant bien que mal au nouvel ordre capitaliste, ne repose plus sur aucun systû´me de valeurs crûˋdible. »
Cãest ainsi que le paradoxe de la situation actuelle rûˋside dans le dûˋcalage entre un art vivant sans risque de censure acadûˋmique mais en quûˆte de sens auprû´s du public, et un discours esthûˋtique gûˋnûˋral qui refuse une confrontation directe aux éuvres. Face û cela, les mûˋdiateurs (historiens, philosophes mais surtout critiques dãart) devraient instaurer un rûˋel dûˋbat critique sur les éuvres contemporaines irrûˋvûˋrencieuses. Lãirrûˋvûˋrence signifiant critique, prise de distance, ironie, le discours sur lãart contemporain devrait en faire de mûˆme.
Pour ce qui est de lãart irrûˋvûˋrencieux comme aspiration û un changement du monde, de nombreux dûˋtracteurs estiment que ce nãest pas le moyen le plus apte û rûˋvolutionner la sociûˋtûˋ. Ses incidences sont trop incertaines et trop ambiguû¨s. Selon eux, û force de frustrer le public de toute satisfaction, il nãexerce plus aucun effet libûˋrateur.
Rainer Rochlitz : « La tentative pour traduire lãart dans la vie au moyen de la dûˋsublimation des formes ou de la politisation des contenus ne fait que priver les éuvres de toute force esthûˋtique. »
Par ailleurs, la subversion des codes esthûˋtiques constitue un projet originel de lãart, prûˋalable û lãesthûˋtique. Nûˋanmoins, elle est û lãorigine des dûˋbats houleux sur lãart contemporain. Se pose alors la question de savoir si cette subversion est encore souhaitable dans lãart dãaujourdãhui. Lãart actuel ne devrait-il pas sãen sûˋparer et passer û autre chose ? Mais comment lãart peut-il, au sein de notre culture de lãinformation, continuer û exister sans la subversion ?
Si lãesthûˋtique contemporaine ne peut rûˋpondre û la question de savoir si lãirrûˋvûˋrence de lãart contemporain est une ingûˋrence ou un systû´me esthûˋtique û part entiû´re, on peut nûˋanmoins penser que la production artistique actuelle nãest pas moins lûˋgitime que lãart du passûˋ. En effet, on ne peut lui imputer un dûˋsarroi qui vient surtout de lãincapacitûˋ de nombreux discours û prendre en charge des éuvres qui perturbent nos modes de pensûˋe. Les excentricitûˋs de lãart contemporain ainsi que les audaces plus ou moins choquantes des artistes dãaujourdãhui ne peuvent concurrencer en absurditûˋ et en atrocitûˋ ce que le quotidien est capable de produire et dãexposer, notamment û travers les mûˋdias.
Il serait donc incongru de conclure û une mort imminente de lãart, et û une dissolution et rûˋinvention prochaines de lãesthûˋtique. De fait, il est toujours possible de croire dans le pouvoir des artistes sur le public. Toute éuvre dãart aussi irrûˋvûˋrencieuse soit-elle exige aussi bien des gestes secrets, insolvables, quãune communication collective. En ce sens, la rûˋflexion esthûˋtique sera toujours le lieu de passage obligûˋ entre cette éuvre ûˋnigmatique et le public.
Conclusion
Lãart ne se rûˋduit pas une question de goû£t, ni û une philosophie de lãart, parce quãil aboutit, comme on lãa vu, nûˋcessairement û une impasse. Il faudrait ainsi peut-ûˆtre aujourdãhui penser une ûˋvolution de lãesthûˋtique vers quelque chose qui ûˋlargisse la question du goû£t. Certains en appellent û un retour aux origines de lãart qui implique la libertûˋ, lãironie, le danger et la cruautûˋ. Selon eux, il paraûÛt temps de mettre en pratique ce que Nietzsche a ûˋnoncûˋ: » … sãil nous faut encore un art û nous autres convalescents, cãest un art moqueur, lûˋger, fluide, divinement libre et divinement artificiel. Un art pour les artistes, pour les artistes uniquement. »
Il sãagirait donc de redonner lãart aux artistes, sans pour autant exclure le public ; de revalider lãesthûˋtique avec les artistes, sinon lãart risque de nãûˆtre plus que de lã « entertainment » dictûˋ par un marchûˋ tout-puissant. Lãhistorien de lãart Ernst Gombritch dit dãailleurs de lãart quãil nãexiste pas, quãil nãy a que des artistes. Il faudrait ainsi parvenir û sortir de la dialectique du « oui ou non lãirrûˋvûˋrence lûˋgitime/discrûˋdite-t-elle lãart contemporain ? », et explorer le « oui et non lãirrûˋvûˋrence lûˋgitime/discrûˋdite lãart contemporain ». Ne plus penser le monde selon des principes dãopposition mais selon la logique du flux permanent. Il sãagirait alors dãopter pour un art du dûˋplacement perpûˋtuel, au-delû du paradoxe. Lãartiste ne serait plus ni critique, ni moderne, mais justement artiste.
Par ailleurs, un autre moyen de remûˋdier û la crise de lûˋgitimation de lãart actuel irrûˋvûˋrencieux, serait, notamment selon lãartiste Thomas Hirschhorn, non pas de faire un art politique, mais de le faire politiquement. Lãart a, de fait, û voir avec la citûˋ, la communautûˋ politique, lãûˋducation, la vie commune, le travail, et les loisirs. Nûˋanmoins, parce que lãart contemporain dans son irrûˋvûˋrence est souvent inintelligible, il entraûÛne le rejet du public qui le perûÏoit alors comme ûˋlitiste. Il faudrait donc affirmer lãimportance dãun rapport communicatif entre les artistes, leurs éuvres, et le public ; souligner la nûˋcessitûˋ dãune interactivitûˋ, qui pourrait se matûˋrialiser û travers des rencontres entre artiste et spectateurs, des rûˋcits explicatifs, des lûˋgendes descriptives, ou encore des ateliers de sensibilisation û lãirrûˋvûˋrence dans lãart contemporain. Il sãagirait ainsi de rendre lãart comprûˋhensible au public.
Enfin, quoi quãon en dise, il demeure avant tout nûˋcessaire de laisser libre cours û toutes les formes, tous les concepts dãart possibles, et ainsi dãaffirmer un pluralisme de lãart contemporain. Cãest en effet cette diversification qui nourrit lãart. En outre, lãart quel quãil soit est un moyen dãavoir un autre regard sur la reprûˋsentation du monde. En ce sens, lãart contemporain, dans sa transgression, permet de voir autre chose sans forcûˋment ûˆtre novateur ; dãouvrir les yeux sur le monde, de prendre du recul sur celui-ci, ce qui ne signifie pas quãil rûˋussit toujours û le faire. Cãest û cet effet quãil apparaûÛt fondamental de toujours conserver un esprit critique. Ainsi pourrait-on aller jusquãû se poser la question de savoir sãil ne faudrait pas abolir le discours sur lãart contemporain pour enfin affronter dãun éil critique cet art pour ce quãil est : irrûˋvûˋrencieux. Car, sans des discernements, sans une manifestation de lãesprit de distance face û cet art, on peut parler de « contemporain », mais cãest û peine sãil sãagit dãart. Autrement dit, comment parler dãart contemporain si aucune conscience de lãartistique nãintervient, si on se limite û un constat dãûˋchec face û la crise de lãesthûˋtique contemporaine, et si on ne fait pas preuve dãirrûˋvûˋrence envers cet art irrûˋvûˋrencieux ?
Dominique ChûÂteau : « La philosophie de lãart nãa pas pour but de penser lãart en tant quãil est contemporain. Son but est (ãÎ) de chercher û comprendre lãart contemporain (entre autres) en tant quãil est art, ce qui implique û la fois la mûˋmoire de ce quãil fut, la conscience de ses mûˋtamorphoses et la confiance dans son futur. »


 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-