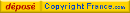Michelle van WEEREN
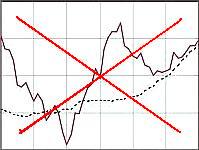 Sur lãûÛle de Bensalem, dûˋcrire par Francis Bacon dans La Nouvelle Atlantide en 1624, des marins naufragûˋs dûˋcouvrent une sociûˋtûˋ entiû´rement organisûˋe autour de la science et lãinnovation. Les sages quãils y rencontrent leur confient les secrets de lãaccumulation du savoirô et des diverses maniû´res dont ils manipulent leur environnement naturel pour en tirer le meilleur bûˋnûˋfice pour les humains, souvent grûÂce aux artifices techniques. Certains des exemples donnûˋs, qui devraient dans lãûˋpoque de Bacon ûˆtre considûˋrûˋs comme des miracles, comme la possibilitûˋ de manipuler les espû´ces vûˋgûˋtales pour ô¨ô faire en sorte quãelles croissent et portent des fruits plus vite quãil ne leur est natureô ô£ (Bacon, 1624, p. 122), sont devenues des rûˋalitûˋs banales aujourdãhui.
Sur lãûÛle de Bensalem, dûˋcrire par Francis Bacon dans La Nouvelle Atlantide en 1624, des marins naufragûˋs dûˋcouvrent une sociûˋtûˋ entiû´rement organisûˋe autour de la science et lãinnovation. Les sages quãils y rencontrent leur confient les secrets de lãaccumulation du savoirô et des diverses maniû´res dont ils manipulent leur environnement naturel pour en tirer le meilleur bûˋnûˋfice pour les humains, souvent grûÂce aux artifices techniques. Certains des exemples donnûˋs, qui devraient dans lãûˋpoque de Bacon ûˆtre considûˋrûˋs comme des miracles, comme la possibilitûˋ de manipuler les espû´ces vûˋgûˋtales pour ô¨ô faire en sorte quãelles croissent et portent des fruits plus vite quãil ne leur est natureô ô£ (Bacon, 1624, p. 122), sont devenues des rûˋalitûˋs banales aujourdãhui.
Bacon ûˋtait le premier û utiliser la notion de ô¨ô progrû´sô ô£ dans une conception temporelle et non plus spatiale. Avant, le terme progressus indiquait lãavancûˋe dãune armûˋe, mais Bacon lãemploie pour la premiû´re fois pour indiquer le cumul des savoirs. Avec dãautres auteurs comme Renûˋ Descartes, Bacon a donc ûˋtûˋ un fondateur de lãûˋpoque moderne, et un inspirateur de lãidûˋe selon laquelle on peut amûˋliorer la condition humaine grûÂce û un travail collectif de cumul des savoirs et des connaissances. La recherche de la nouveautûˋ est au céur de la sociûˋtûˋ des savants quãil dûˋcrit, oû¿ les inventeurs se voient ûˋriger des statuts (Bacon, 1624, p. 131 – 132).
Conformûˋment û ce qui se passe sur lãûÛle imaginaire de Bensalem, les Europûˋens commencent, û partir de la naissance de lãûˋpoque moderne au XVIIe siû´cle, û effectuer des opûˋrations relevant dãun nouvel ûˋtat dãesprit : gagner du temps, rûˋtrûˋcir lãespace, accroûÛtre lãûˋnergie, multiplier les biens, sãaffranchir des normes naturelles, dominer et manipuler les organismes vivants, etc. (Illich, 1957, p. 57). Les techniques sont les artifices par excellence pour amûˋliorer lãefficacitûˋ de ces pratiques. Aujourdãhui encore, nous nous trouvons toujours dans la parfaite prolongation de la pensûˋe amorcûˋe par Bacon au XVIIe siû´cle. En ce qui concerne le progrû´s technique, cette pensûˋe est dominûˋe par trois croyances fondamentalesô : le progrû´s technique est indispensable au progrû´s humain, la technique va rûˋsoudre tous nos problû´mes, et tout ce qui peut ûˆtre inventûˋ, doit ûˆtre inventûˋ.
Le progrû´s technique est indispensable au progrû´s humain
Le premier de ces mythes consiste donc û croire que le progrû´s technique est la condition sine qua non du progrû´s humain. Nombreuses sont les discussions autour de la dûˋfinition du progrû´s humain. On propose ici de retenir la dûˋfinition dãAmartya Sen, pour qui le progrû´s est la voie vers la prospûˋritûˋ. Celle-ci se base, dans la vision de Sen, sur les possibilitûˋs dãûˋpanouissement des ûˆtres humains, cãest-û -dire la capacitûˋ des gens û bien ô¨ô fonctionnerô ô£ – vivre en bonne santûˋ, avoir un emploi satisfaisant, participer û la vie de sociûˋtûˋ, etc. -ô aujourdãhui et û lãavenir (in Jackson, 2010, p. 57). Si on veut affirmer que le progrû´s technique est indispensable au progrû´s humain, il doit donc contribuer aux capabilitûˋs des humains û sãûˋpanouir, maintenant mais aussi dans le futur.
Pourquoi croit-on que ce but peut ûˆtre atteint grûÂce au progrû´s techniqueô ? Ce dernier est gûˋnûˋralement associûˋ û trois ûˋlûˋments que lãon croit positifs pour le progrû´s humain : lãinnovation, la productivitûˋ et la croissance. Lãinnovation qui pousse le progrû´s technique en avant aide û accroûÛtre la productivitûˋ des entreprises, ce qui contribue û entretenir la croissance ûˋconomique.
Lãinnovation est souvent considûˋrûˋe comme le progrû´s û court terme. Avec la productivitûˋ, elle est au céur de la croissance de lãûˋconomie. Dans un contexte de crise et de rûˋcession ûˋconomique dans les pays occidentaux, toutes les institutions, politiques, mûˋdias et industriels appellent û plus dãinnovation. Puisquãon est convaincus que le progrû´s technique nous guide dans notre dûˋveloppement en tant quãespû´ce, on cherche continuellement û dûˋterminer quelle sera la prochaine innovation technique rûˋvolutionnaire. Depuis la naissance dãInternet nous nãavons plus vraiment eu de telle innovation, donc nous continuons û chercher. Aujourdãhui, quãil sãagisse des nanotechnologies, de la biotechnologie ou de lãimpression 3D, tous se rûˋclament porteurs de la ô¨ô prochaine rûˋvolution industrielleô ô£.
Lãhistoire des innovations techniques sãest pendant longtemps uniquement intûˋressûˋe aux rûˋussites et aux dûˋcouvertes gûˋniales. Lãoptimisme progressiste et technophile dissimule dans sa reprûˋsentation de lãhistoire des inventions les incertitudes technologiques ainsi que les trajectoires alternatives. Car cette histoire nãest pas si linûˋaire quãon aurait tendance û croire. Les innovations qui lãemportent ne sont pas toujours les solutions optimales, mais le deviennent parce quãelles sãimposent. Un exemple bien connu est celui du clavier Qwerty et sa version franûÏaise Azerty, qui sont un hûˋritage des anciennes machines û ûˋcrire. Pour minimiser le risque de contact entre deux tiges de frappe sur ces machines, les lettres susceptibles dãûˆtre utilisûˋes lãune aprû´s lãautre devaient ûˆtre ûˋloignûˋes sur le clavier. Evidemment, depuis lãarrivûˋe de lãordinateur, cette contrainte nãest plus dãactualitûˋ et il a ûˋtûˋ dûˋmontrûˋ quãune autre rûˋpartition des lettres sur le clavier serait plus ergonomique et donc plus efficace. Mais nous avons gardûˋ les claviers Qwerty et Azerty, et puisque les utilisateurs sãy sont habituûˋs, ils sont devenus ô¨ô la meilleure solutionô ô£.
Lãhistoire des innovations techniques nãest donc pas une succession de rûˋussites et celles qui sont sûˋlectionnûˋes ne sont pas toujours les plus efficaces. Pourtant, lãinnovation technique est assimilûˋe û lãaugmentation de la productivitûˋ, deuxiû´me ûˋlûˋment majeur associûˋ au progrû´s technique qui est, elle aussi, devenue une vûˋritable institution et un objectif activement recherchûˋ par les pouvoirs publics. Mais la recherche continue de la productivitûˋ ûˋconomique a des zones dãombre. Une sociûˋtûˋ organisûˋe autour de la maximisation de la production place lãûˋconomie au centre, accûˋlû´re le rythme de la vie quotidienne et diminue le temps et les ressources disponibles û consacrer û la famille, aux activitûˋs sociales, aux arts, brefô : toutes ces choses qui dûˋterminent, pour beaucoup, le sens de la vie. Il faut ûˆtre productif pour ô¨ô mûˋriterô ô£ sa place dans la sociûˋtûˋ, et ceux qui perdent leur emploi voient non seulement leurs ressources financiû´res en diminution, mais dans beaucoup de cas ûˋgalement leur capital social et leur estime de soi. Donc si lãaugmentation de la productivitûˋ suite au progrû´s technique effectue dans certains cas de vûˋritables amûˋliorations sur le plan matûˋriel, il reste un prix û payer : les adaptations sur le plan social et psychologique que demande lãapplication optimale de la technique.
Le progrû´s technique est souvent pensûˋ comme un processus qui dûˋtecte les besoins qui existent dans la sociûˋtûˋ et y trouve des rûˋponses adûˋquates. Mais parfois, il est plutûÇt nûˋ dãun besoin de relancer la croissance ûˋconomique. PlutûÇt que dãûˆtre une solution û un problû´me, les techniques sont souvent des ô¨ô solutions qui cherchent un problû´meô ô£. Ainsi, le 29 octobre 1979, Le Figaro ûˋcrivait û propos des ordinateurs personnels : ô¨ô Nous ne savons pas quels usages assigner aux ordinateurs domestiques, mais nous pensons quãil y a un marchûˋ parce que les mûˋnages ont pratiquement fini de sãûˋquiper en tûˋlûˋ-couleur. Il faut trouver un produit-relais qui perpûˋtue les habitudes dãachatô ô£ (Iozard citûˋ par Jarrige, 2014, p. 296). Evidemment, lãordinateur personnel nãest pas vraiment un exemple dãun ûˋchec du progrû´s technique. Or, comme le montre ûˋgalement le rapport de Simon Nora et Alain Minc sur lãinformatisation de la sociûˋtûˋô (1978, citûˋ par Jarrige, 2014, p. 296), le tout-informatique, loin dãûˆtre une rûˋponse û un besoin de la sociûˋtûˋ, ûˋtait plutûÇt un moyen employûˋ par les Etats pour sortir de la crise ûˋconomique (Jarrige, 2014).
Nous voilû arrivûˋ au troisiû´me ûˋlûˋment habituellement pensûˋ en relation au progrû´s technique : la croissance ûˋconomique. Dãaprû´s la thûˋorie ûˋconomique classique, le progrû´s technique est le principal facteur de la croissance qui crûˋera la prospûˋritûˋ matûˋrielle et le bien-ûˆtre. Or, au-delû du problû´me fondamental dãincompatibilitûˋ entre croissance ûˋconomique infinie et ressources naturelles limitûˋes, dûˋjû dûˋmontrûˋ par le Club de Rome en 1972, nous insistons ici sur le fait que plus de croissance nãûˋgale pas toujours plus de bien-ûˆtre. Se basant sur des donnûˋes statistiques du Worldwatch Institute, Tim Jackson a en effet dûˋmontrûˋ quãen rûˋalitûˋ, il y a un dûˋcrochage entre bien-ûˆtre et prospûˋritûˋ matûˋrielle : dans les pays dits dûˋveloppûˋs, au-delû dãun certain seuil, la hausse des revenus ne correspond plus û une hausse du bien-ûˆtre perûÏu (Jackson, 2010). De plus, comme le met en avant Illich, la croissance du PIB – indicateur ûˋconomique de la mesure de la production et souvent assimilûˋ au niveau de ô¨ dûˋveloppementô ô£ des pays – suite û une activitûˋ technique reprûˋsente souvent une valeur dûˋduite au lieu dãune valeur ajoutûˋe. Ainsi, les activitûˋs de dûˋpollution (dûˋcrites par les ûˋconomistes comme des dûˋpenses ô¨ô dûˋfensivesô ô£, car elles rûˋsultent du besoin de se ô¨ô dûˋfendreô ô£ contre les consûˋquences nûˋgatives dãactivitûˋs se dûˋveloppant ailleurs dans lãûˋconomie (Jackson, 2010, p. 54)) correspondent bien û une augmentation du PIB, mais nullement û une augmentation du bien-ûˆtre. Elles se bornent û rûˋcupûˋrer un bien-ûˆtre qui existait auparavant (Illich, 1973, p. 375). Un autre problû´me majeur avec le PIB est quãil nãintû´gre pas la dûˋgradation des ûˋcosystû´mes et donc nos possibilitûˋs futures de progrû´s humain (Jackson, 2010, p. 54).
La relation entre progrû´s humain et progrû´s technique, dans le sens oû¿ il entraûÛne lãinnovation, la productivitûˋ et la croissance, nãest donc pas automatique et si elle nãest pas univoquement nûˋgative, elle est pour le moins ambigû¥e. Examinons maintenant une autre croyance trû´s rûˋpandue sur le progrû´s technique, surtout chez les adeptes de lãinterprûˋtation ô¨ô technicienneô ô£ du dûˋveloppement durableô : le progrû´s technique nous apportera la rûˋponse û nos problû´mes ûˋcologiques.
Le progrû´s technique va rûˋsoudre nos problû´mes ûˋcologiques
Dans le paradigme moderne, la rationalitûˋ technique et scientifique est vue comme la base pour rûˋsoudre tous les problû´mes. Puisque la technique est considûˋrûˋe comme le moyen par excellence pour accroûÛtre notre emprise sur et notre comprûˋhension du monde, on a tendance û analyser des problû´mes de nature politique, sociale, humaine, ûˋcologique, etc., de faûÏon û ce quãils deviennent des problû´mes techniques, pour que la technique soit lãinstrument adûˋquat pour y trouver une solution (Ellul, 1988, p. 68). Cãest pourquoi ce quãon appelle le dûˋveloppement durable comporte souvent des solutions techniques. On appelle ô¨ô techno-fixô ô£ la tentative de rûˋsoudre des problû´mes causûˋs par des technologies (pollution, changement climatique, perte de la biodiversitûˋ û cause de lãagriculture intensive, etc.) par dãautres technologies. Face aux dûˋfis que posent le changement climatique, la croissance de la population et la rarûˋfaction des ressources, on compte sur les technologies vertes, la capture de CO2, lãingûˋnierie climatique, les nanotechnologies et les biotechnologies pour nous apporter des rûˋponses. Les solutions techniques que la vision orthodoxe du dûˋveloppement durable cherche û apporter aux problû´mes ûˋcologiques sont donc profondûˋment ancrûˋes dans les causes de ces problû´mes.
Or, la recherche scientifique et les techniques qui en rûˋsultent se basent sur une vision rûˋduite et simplifiûˋe du monde, ce qui fait que les techniques qui ûˋtaient censûˋes rûˋsoudre certains problû´mes en causent parfois dãautres. Par exemple, un projet de mitigation face au changement climatique consiste û dissûˋminer des algues artificielles capables de capturer du CO2 sur les ocûˋans. En revanche, puisque nous ne connaissons pas totalement le fonctionnement des ûˋcosystû´mes marins, nous ne pouvons pas prûˋdire les consûˋquences de lãintroduction de ces algues sur leur ûˋquilibre (Huesemann et Huesemann, 2011, p. 48).
Lãidûˋe de dûˋcouplage est au céur de la vision technique du dûˋveloppement durable et a abondamment ûˋtûˋ traitûˋ dans la littûˋrature (voir par exemple Jackson, 2010ô ; Mûˋda, 2013). Lãidûˋe est de dûˋcoupler, par un accroissement de lãefficacitûˋ suite au progrû´s technique, les impacts environnementaux de la croissance ûˋconomique et ainsi de faire face au problû´me dãune croissance infinie sur une planû´te finie. Par la dûˋmatûˋrialisation progressive de lãûˋconomie suite au dûˋveloppement du numûˋrique, le remplacement des voitures polluantes par des vûˋhicules ûˋlectriques, lãamûˋlioration des processus de production afin dãextraire de moins en moins de matiû´res premiû´res etc., nous serions capables de continuer û croûÛtre sans nous heurter aux problû´mes de pollution ou dãûˋpuisement de ressources. Tim Jackson a dûˋmontrûˋ les limites de cette idûˋe qui est au céur de la stratûˋgie de dûˋveloppement durable de nombreuses institutions officielles (en 2011, lãUNEP a ô publiûˋ un rapport intitulûˋ Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth). Tout dãabord, il pointe du doigt lãimportance de la distinction entre dûˋcouplage relatif et dûˋcouplage absolu, souvent source de confusion. Le dûˋcouplage relatif consiste û diminuer lãintensitûˋ ûˋnergûˋtique dãune unitûˋ produiteô ; il sãagit de faire plus avec moins. Cette forme de dûˋcouplage rûˋsulte souvent en un effet-rebond : les ûˋconomies dãûˋnergie rûˋalisûˋes dans la production dãun bien sont compensûˋes ou mûˆme dûˋpassûˋes (dans ces cas-lû on parle de backfire) par lãutilisation quãon en fait, ou par des dûˋpenses dans dãautres domaines (Jackson, 2010, p. 103). On a tendance û faire plus de kilomû´tres avec une voiture moins consommatrice en carburant, ou bien on utilise lãargent ûˋconomisûˋ pour partir en vacances en avion. Pour rûˋaliser un dûˋcouplage relatif, il suffit que le PIB croisse suffisamment pour compenser les dûˋgûÂts environnementaux causûˋs afin dãavoir une rûˋduction de ces dûˋgûÂts par unitûˋ produite.
Ce quãil nous faut pour rendre possible un dûˋveloppement vûˋritablement durable, cãest un dûˋcouplage absolu : la baisse de lãimpact sur les ûˋcosystû´mes en termes absolus, indûˋpendamment de la croissance du PIB. Se basant sur des donnûˋes de lãAgence europûˋenne de lãEnergie, Jackson montre que si le dûˋcouplage relatif a ûˋtûˋ rûˋalisûˋ dans la plupart des pays de lãOCDE au cours des derniû´res dûˋcennies, le dûˋcouplage absolu est loin de se produire (Jackson, 2010, p. 76 – 86). Cette observation rend peu optimiste quant û la possibilitûˋ du dûˋcouplage absolu sur lãûˋchelle planûˋtaire, oû¿ les populations en croissance des pays en dûˋveloppement continuent û aspirer un niveau de prospûˋritûˋ matûˋrielle comparable û celui des pays dûˋveloppûˋs (Jackson, 2010, p. 86 – 91). Jackson conclut que le dûˋcouplage suite û lãamûˋlioration de lãefficacitûˋ grûÂce au progrû´s technique, bien que nûˋcessaire, ne suffira probablement pas û rûˋaliser un dûˋveloppement vûˋritablement durable.
La vision technicienne du dûˋveloppement durable, qui part du principe que les techniques vont apporter la solution û nos problû´mes ûˋcologiques, prûˋsente donc des failles. Premiû´rement, les solutions techniques nãarrivent pas û tenir compte de la complexitûˋ et de lãinter-connectivitûˋ du monde, ce qui contribue û causer de nouveaux problû´mes. Deuxiû´mement, les techniques seules ne semblent pas capables de rûˋaliser un dûˋcouplage absolu entre croissance ûˋconomique et impacts ûˋcologiques. Cela nãempûˆche pas que la technique et lãinnovation sont toujours, de maniû´re gûˋnûˋrale, cûˋlûˋbrûˋes comme les outils phares de lãhumanitûˋ, ce qui nous distingue des animaux et dont le potentiel doit par consûˋquence ûˆtre pleinement rûˋalisûˋ. Le mythe de lãimpûˋratif technique sãinscrit parfaitement dans cette croyance.
Tout ce qui peut ûˆtre inventûˋ, doit ûˆtre inventûˋ
ô¨ô Notre Fondation a pour fin de connaûÛtre des causes, et le mouvement secret des choses ; et de reculer les bornes de lãEmpire Humain en vue de rûˋaliser toutes les choses possiblesô ô£.
Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide
Lãidûˋe de lãillimitûˋ des possibilitûˋs de lãhomme, qui doit pleinement dûˋvelopper ses pouvoirs afin de rûˋaliser ô¨ô toutes les choses possiblesô ô£, rûˋsonne dans ce quãon appelle lãimpûˋratif technologique. Celui-ci repose sur la croyance que tout ce qui est techniquement possible, doit ûˆtre rûˋalisûˋ. On retrouve cet ûˋtat dãesprit chez une grande partie des entreprises innovantes. Il est particuliû´rement prûˋsent dans les nouveaux secteurs ûˋconomiques comme lãinformatique, la biologie de synthû´se ou les nanotechnologies. Comme le disait Bill Gates û propos de la discipline ûˋmergente de la bio-informatique, cette discipline qui cherche û cartographier les informations gûˋnûˋtiques mais aussi û crûˋer des molûˋcules nouvelles : ô¨ô Cãest lãû´re de lãinformation, et lãinformation biologique est probablement la plus intûˋressante û dûˋchiffrer et û essayer de changer. La seule question, cãest comment – pas si nous allons le faire ou nonô ô£ (Gates citûˋ par Rifkin, 2014, p. 259).
Dans ces secteurs, des entreprises cherchent û se positionner sur des nouveaux marchûˋs avec des produits dont elles ne maûÛtrisent souvent pas totalement les consûˋquences. Parfois, des voix critiques se lû´vent. Catherine Bourgain, chargûˋe de recherche en gûˋnûˋtique humaine û lãInserm (Institut national de la santûˋ et de la recherche mûˋdicale), plaide mûˆme pour lãarrûˆt du dûˋveloppement de la biologie de synthû´se. Elle souligne les risques de dissûˋmination quãon ne contrûÇle pas, ou encore le creusement des inûˋgalitûˋs mondiales û cause de la destruction dãemplois de ceux qui cultivent des plantes pour lesquelles les pays riches seront dûˋsormais capables de fabriquer des substituts artificiels (Bourgain citûˋ par Laurent, Socialter, fûˋvrier – mars 2015). Mais ces hûˋsitations sont marginalisûˋes dans le grand courant des innovations. Pourtant, lãimpûˋratif technologique peut ûˆtre dangereuxô : il est souvent utilisûˋ comme une excuse pour ûˋviter dãentamer un vrai dialogue et une prise de dûˋcision ûˋthique sur les nouvelles techniques. Il reprûˋsente celles-ci comme inûˋvitables, mûˆme si elles ne servent pas directement un quelconque intûˋrûˆt (û part ceux de lãentreprise qui les a dûˋveloppûˋes) et favorise ainsi une acceptation passive des nouvelles technologies, û la fois de la part des utilisateurs et des pouvoirs publics (Huesemann et Huesemann, 2010).
Donc, contrairement aux croyances modernes, le progrû´s technique ne contribue pas automatiquement au progrû´s humain, nãapporte pas toujours des rûˋponses adûˋquates û nos problû´mes ûˋcologiques et tout ce qui est techniquement possible ne doit surtout pas ûˆtre rûˋalisûˋ aveuglûˋment. Les techniques ûˋtendent le domaine des possibles û une vitesse phûˋnomûˋnale et intensifient lãimpact de nos choix sur le moyen et long terme. Les postulats modernes sur le progrû´s technique dûˋcrits plus haut freinent la prise de recul critique û lãûˋgard des innovations. Le rûˋsultat est une espû´ce de culte de lãinnovation qui garde les entreprises prisonniû´res dãune course effrûˋnûˋe û la nouveautûˋ, cause lãobsolescence et le gaspillage et favorise la prise de risques dûˋmesurûˋs.
Le rapport de lãentreprise moderne û lãinnovation
Le rapport de lãentreprise moderne û lãinnovation est caractûˋrisûˋ par la destruction crûˋatrice : le processus dãûˋmergence de nouvelles formes dãactivitûˋ ûˋconomique qui en dûˋtruisent dãautres. En effet, dans la thûˋorie de Schumpeter, ce nãest pas û travers les prix que les entreprises mû´nent leur compûˋtition, mais û travers de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Une guerre des prix tirerait le profit vers le bas, cãest pourquoi les entreprises cherchent û ûˋviter cette forme de compûˋtition pour tenter plutûÇt de sãaccaparer des nouvelles niches de marchûˋ par lãinnovation technologique et y ûˋtablir un monopole. Avec le dûˋsir de la nouveautûˋ du cûÇtûˋ des consommateurs, le processus de destruction crûˋatrice constitue le moteur de lãûˋconomie moderne. En effet, lorsque la majoritûˋ a une dûˋfinition matûˋrielle de la vie bonne, lãactivitûˋ du consommateur est caractûˋrisûˋe par la recherche de produits nouveaux et amûˋliorûˋs, ce qui correspond miraculeusement û lãentreprise en quûˆte du monopole par lãinnovation technologique. Ces deux dynamiques se renforcent mutuellement et poussent ensemble la croissance ûˋconomique en avant (Jackson, 2010).
La consûˋquence de ce processus pour les entreprises innovantes est quãelles doivent constamment ûˆtre sur leur qui-vive et dûˋvelopper rapidement de nouveaux produits pour dûˋfendre leur espace compûˋtitif. Elles se trouvent donc dans une position ambiguû¨ vis-û -vis de lãinnovation techniqueô : dãune part, ce sont elles qui impulsent les changements, dûˋveloppent et maûÛtrisent les nouvelles technologies et dûˋterminent la direction que prend lãinnovation, dãautre part, elles sont prisonniû´res de cette course û la nouveautûˋ ainsi que de la concurrence, et elles doivent sãadapter en permanence pour survivre. Soumises û cette pression, nombreuses sont les entreprises qui ont ô¨ô loupûˋ le cocheô ô£ et doivent lutter pour leur existence sur des marchûˋs oû¿ elles occupaient jadis une position dominante, û lãimage de Kodak qui ûˋtait leader sur le marchûˋ des appareils photo argentiques, mais nãa pas rûˋussi û sauvegarder cette position dominante lorsque lãappareil photo numûˋrique sãest dûˋveloppûˋ.
Aujourdãhui, cãest surtout le dûˋveloppement rapide du numûˋrique qui pose des dûˋfis aux entreprises traditionnellesô : des plateformes de mise en relation entre particuliers comme Uber ou Airbnb dûˋfient les secteurs traditionnels des transports et de lãhûÇtellerie, lãimpression 3D est susceptible de bouleverser la chaûÛne de valeur et de redistribuer la production dans la plasturgie, etc. Les nouvelles technologies numûˋriques crûˋent donc de nouvelles opportunitûˋs pour les entreprises, mais les contraignent aussi û sãadapter de plus en plus rapidement aux transformations des marchûˋs. Dans une ûˋtude rûˋcente rûˋalisûˋe par la BPI sur les effets disruptifs de la croissance dãInternet, les PME franûÏaises sont appelûˋes û ûˆtre ô¨ô agiles et rûˋactivesô ô£ (Bpifrance, 2015, p. 47), par exemple en crûˋant leurs propres plateformes en ligne afin dãanticiper les effets perturbateurs du numûˋrique. ô¨ô Disrupter ou ûˆtre disruptûˋ, tel est bien (…) le dilemme de notre ûˋpoqueô ô£ (Bpifrance, 2015, p. 51). Dans le contexte compûˋtitif qui caractûˋrise le capitalisme, la seule maniû´re de survivre lãaccûˋlûˋration des processus de destruction crûˋatrice par lãinnovation technologique est dãaller encore plus vite que ses concurrents.
Les entreprises doivent donc courir plus vite pour rester dans le jeu. Mais les consûˋquences nûˋgatives du rapport moderne û lãinnovation concernent aussi la sociûˋtûˋ au sens plus large. Deux problû´mes majeurs semblent sãassocier û la compûˋtition accûˋlûˋrûˋe sur les marchûˋs de produits techniquesô : dãune part, la rûˋduction des cycles de renouvellement des produits, et dãautre part, le manque de recul face aux technologies risquûˋes.
Obsolescence et gaspillage
Pour Jacques Ellul, ce premier problû´me est nûˋ dãune inversion radicale entre le temps de lãusage et le temps de lãûˋlimination. Encore au XIXû´me, un objet ûˋtait fait pour durer. Aujourdãhui, le temps dãusage est instantanûˋ pour beaucoup de produits, et de trû´s brû´ve durûˋe pour tous : chaque appareil devient obsolû´te trû´s rapidement et sera remplacûˋ par un objet plus efficace ou plus sophistiquûˋ (Ellul, 1988, p. 122). Cette dynamique est la plus ûˋvidente sur le marchûˋ des appareils ûˋlectroniquesô : en 2012, plus de 130 millions de tûˋlûˋphones portables en ûˋtat de marche ont ûˋtûˋ mis au rebut aux Etats-Unis (chiffrûˋs citûˋs par Latouche, 2012, p. 118). Comment expliquer ce gaspillageô ?
Il sãagit en fait dãune consûˋquence logique des interactions entre les deux dynamiques complûˋmentaires de lãûˋconomie moderneô : les dûˋsirs du consommateur dãune part et les objectifs du producteur dãautre part. La pensûˋe moderne sur le progrû´s technique se caractûˋrise par la croyance que les innovations dans les produits techniques sont toujours nûˋcessaires et utiles. Les anciennes versions ne sont plus fabriquûˋes, tout comme leurs piû´ces dûˋtachûˋes. Pour les consommateurs, cela a pour consûˋquence quãil faut se dûˋtacher de en plus en plus rapidement de ses anciens appareils. Le lien presque affectueux quãon pouvait jadis avoir avec un objet dãusage a disparu chez la quasi-totalitûˋ des consommateurs, du moins pour les produits ûˋlectroniques. Leur comportement se caractûˋrise dûˋsormais par la recherche des objets les plus sophistiquûˋs possible pour le meilleur prix. On ne peut pas vraiment leur en vouloirô : il est souvent plus rentable dãacheter un nouvel appareil que de garder lãancien, mûˆme sãil aurait encore pu fonctionner parfaitement pendant longtemps sãil avait pu ûˆtre rûˋparûˋ.
Du point de vue de lãentreprise, dans le contexte du capitalisme du marchûˋ et lorsque la finalitûˋ est de maximiser le profit, le but est dãimpulser les ventes de ses produits. Plus le produit est viable et durable, plus le cycle dãachat rûˋpûˋtûˋ sera long et plus la croissance des ventes sera lente (Vidalenc et Meunier, 2014). Cãest pourquoi les entreprises cherchent û dûˋvelopper des produits nouveaux qui peuvent remplacer des anciens produits par des nouvelles versions, voire û ûˋcourter la durûˋe de vie de ces produits pour pousser les clients û effectuer des achats rûˋpûˋtûˋs.
De ces deux dynamiques qui se complû´tent, la recherche de nouveautûˋ du cûÇtûˋ du consommateur et la recherche de lãinnovation par lãentreprise, rûˋsulte ce quãon appelle lãobsolescence. Dãaprû´s Latouche (2012), il existe plusieurs types dãobsolescenceô :
-ô ô ô ô ô ô ô ô ô technique : le dûˋclassement des machines dû£ au progrû´s technique, qui introduit une amûˋlioration fonctionnelle des produits par lãajout de nouvelles propriûˋtûˋs ou par lãamûˋlioration des propriûˋtûˋs existantes (ajout dãun appareil photo û un tûˋlûˋphone, rûˋduction du poids dãun ordinateur portable, etc.)ô ;
-ô ô ô ô ô ô ô ô ô psychologique : la dûˋsuûˋtude provoquûˋe par la publicitûˋ et la modeô ;
-ô ô ô ô ô ô ô ô ô programmûˋe : lãusure ou la dûˋfectuositûˋ artificielle.
Lãobsolescence programmûˋe est sans doute la forme qui provoque le plus de rûˋsistance. Malheureusement, elle est plus courante que lãon croit et difficile û dûˋtecter. Les rûˋductions de qualitûˋ des produits sont souvent si subtiles quãelles ne sont presque pas perceptibles pour le consommateur. Les associations de dûˋfense des droits des consommateurs pratiquent certes des comparaisons entre produits de la mûˆme catûˋgorie, mais non dãun mûˆme produit sur une pûˋriode plus longue, ce qui rend le constat dãobsolescence programmûˋe presque impossible. Sãajoute û cela que dans le contexte actuel, la plupart des marchûˋs dans les pays industrialisûˋs ont une tendance û la surcapacitûˋ, lãinfluence des marchûˋs financiers nãa jamais ûˋtûˋ aussi importante et la recherche de profit supplante toute considûˋration ûˋthique sur la qualitûˋ des produits. En bref, toutes les conditions sont rûˋunies pour que lãobsolescence soit pratiquûˋe û grande ûˋchelle.
Quãil sãagisse de lãobsolescence programmûˋe, technique ou psychologique, la rûˋduction progressive de la durûˋe de vie des objets techniques a des consûˋquences sociales et environnementales trû´s graves. La production des appareils ûˋlectroniques demande beaucoup de matiû´res premiû´res prûˋcieuses, comme des mûˋtaux rares, qui se trouvent le plus souvent dans des mines dans des zones û conflit dans les pays du Sud. Sãajoute û cela que ces anciens appareils frappûˋs par lãobsolescence et mis û la poubelle contiennent des fortes concentrations de toxines biologiques, comme lãarsenic, le cadmium, le plomb, le nickel ou le zinc. Les dûˋchets ûˋlectroniques sont souvent transportûˋs des pays industrialisûˋs vers les pays en dûˋveloppement, oû¿ ils sont ô¨ô recyclûˋsô ô£ par des populations dûˋfavorisûˋes dans des conditions dangereuses[1].
Donc, si le progrû´s technique peut ûˆtre bûˋnûˋfique, dans le cadre de lãobsolescence psychologique, technique ou programmûˋe des produits, les mûˋrites des nouveaux produits ne semblent pas toujours valoir le coû£t pour lãenvironnement ou la sociûˋtûˋ (Guiltinan, 2008).
Risques et incertitudes
Le deuxiû´me problû´me que nous observons se situe au niveau des technologies incertaines ou risquûˋes et des controverses sociotechniques qui en dûˋcoulent. Mûˆme souvent porteuses dãamûˋliorations, plus les technologies sont complexes et leur application massive, moins nous sommes capables de prûˋvoir leurs consûˋquences ûˋventuelles. Le paradigme moderne, caractûˋrisûˋ par la rationalitûˋ scientifico-technique et par la spûˋcialisation progressive des mûˋtiers, nãest pas toujours capable de prendre en compte ces effets qui sãûˋtendent dans des domaines trû´s divers. Lãimplantation dãun centre de recherche sur les nanotechnologies dans la rûˋgion grenobloise par exemple a, au-delû des effets ûˋconomiques ou techniques recherchûˋs, aussi eu des consûˋquences sociales qui nãont pas ûˋtûˋ prises en compte par les initiateurs du projet, comme lãûˋmergence du groupe de rûˋsistance Piû´ces et Main dãéuvre, qui critique depuis 2000 les dûˋrives du ô¨ô systû´me technicienô ô£ (www.piecesetmaindoeuvre.com). Le cas grenoblois est typique de ce que Callon (2001) appelle les ô¨ô dûˋbordementsô ô£ ou les ô¨ô controverses sociotechniquesô ô£. Ces controverses, qui naissent lorsque certains groupes dans la population sãopposent û lãapplication de telle ou telle technique, se multiplient tant que les techniques incertaines ou û risque continuent de se dûˋvelopper.
Or, dans lãûˋconomie capitaliste, le progrû´s technique est intrinsû´quement liûˋ au profit financier et û la croissance ûˋconomique. Pour tirer nos ûˋconomies europûˋennes de la rûˋcession et du chûÇmage, les pouvoirs publics comptent sur les capacitûˋs dãinnovation de leurs industries. Cãest pourquoi ils sont peu enclins û freiner les dynamiques de recherche et dûˋveloppement, mûˆme quand il sãagit des domaines incertains ou û risque, comme la biologie de synthû´se, les nanotechnologies ou le nuclûˋaire. Les entreprises, pour leur part, ne sont pas non plus prûˆtes û prendre en compte un ûˋventuel risque technologique en plus du risque commercial. Les contraintes de la destruction crûˋatrice les forcent û accûˋlûˋrer leurs activitûˋs, en particulier les processus dãinnovation. Cette accûˋlûˋration implique souvent une prise de risque dûˋmesurûˋe qui peut entraûÛner des consûˋquences nûˋgatives pour lãenvironnement social ou humain. Dans les thûˋories de lãûˋconomie de lãenvironnement, les consûˋquences nûˋgatives des innovations technologiques sont classûˋes dans la catûˋgorie des externalitûˋs. Ceux û qui ces externalitûˋs causent des dommages ne sont pas pris en compte car ils ne participent pas aux transactions ûˋconomiques des entreprises. Monsanto ou Novartis ne se prûˋoccupent pas des effets de lãûˋventuelle dissûˋmination de gû´nes de rûˋsistance ou des consûˋquences de la gûˋnûˋralisation des plantes transgûˋniques sur les relations nord-sud, puisque ceux que ces problû´mes concernent nãont pas suffisamment de pouvoir sur ces entreprises pour ûˆtre entendus.
Un exemple de lãinteraction entre accûˋlûˋration de lãinnovation et prise de risque peut ûˆtre observûˋ dans le marchûˋ des tûˋlûˋcommunications. Depuis les annûˋes 80, ce secteur a connu une restructuration profonde en Europe : la plupart des pays de lãOCDE ont procûˋdûˋ û la libûˋration totale ou partielle des marchûˋs. Les opûˋrateurs publics ont ainsi ûˋtûˋ remplacûˋs par une multitude dãopûˋrateurs privûˋs qui sont dûˋsormais pris dans des dynamiques de concurrence de plus en plus acharnûˋes (Boylaud et Nicolette, 2001). Sãappuyant sur la technologie de la 4G, les opûˋrateurs essaient de sûˋduire les clients avec des connexions toujours plus rapides û prix bas.
Or, il sãagit dãun secteur qui se base sur des technologies porteuses dãincertitudes. Les publications sur le risque sanitaire de lãexposition aux ondes ûˋlectromagnûˋtiques se multiplient, tout comme le nombre dãassociations de lanceurs dãalerte, comme Robin des Toits (www.robindestoits.org/)ô et Priartem (www.priartem.fr/), qui font du lobbying auprû´s des dûˋcideurs pour encadrer le dûˋveloppement de ces technologies et du rûˋseau dãantennes-relais. Cette technologie a mûˆme causûˋ lãûˋmergence dãune nouvelle identitûˋô : celle des ûˋlectro-hypersensibles. Chez ces personnes, lãexposition aux ondes entraûÛne des gûˆnes ou des douleurs physiques.
En bref, les entreprises innovantes, soumises aux pressions concurrentielles de la destruction crûˋatrice, cherchent û accûˋlûˋrer les cycles de remplacement des produits techniques ainsi que les processus dãinnovation, y compris pour des technologies risquûˋes ou aux effets incertains. Dãune part, ceci entraûÛne le gaspillage des matiû´res premiû´res et la prolifûˋration des dûˋchets ûˋlectroniques suite û lãobsolescence. Dãautre part, comme le montre le cas des ondes ûˋlectroniques, le manque de recul face au risque peut causerô lãûˋmergence de controverses sociotechniques.
Lãinnovation technique, dans sa forme accûˋlûˋrûˋe, peu rûˋflûˋchie et contrûÇlûˋe par une poignûˋe de personnes non-reprûˋsentatives de lãensemble de la population, est-elle vraiment la maniû´re la plus sensûˋe de donner forme û notre ûˋconomie, de satisfaire nos consommateurs et de dûˋterminer le comportement de nos entreprisesô ?
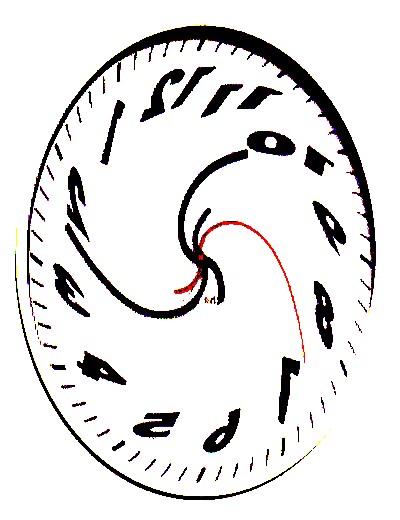

 mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-
mythe-imaginaire-sociûˋtûˋ
-